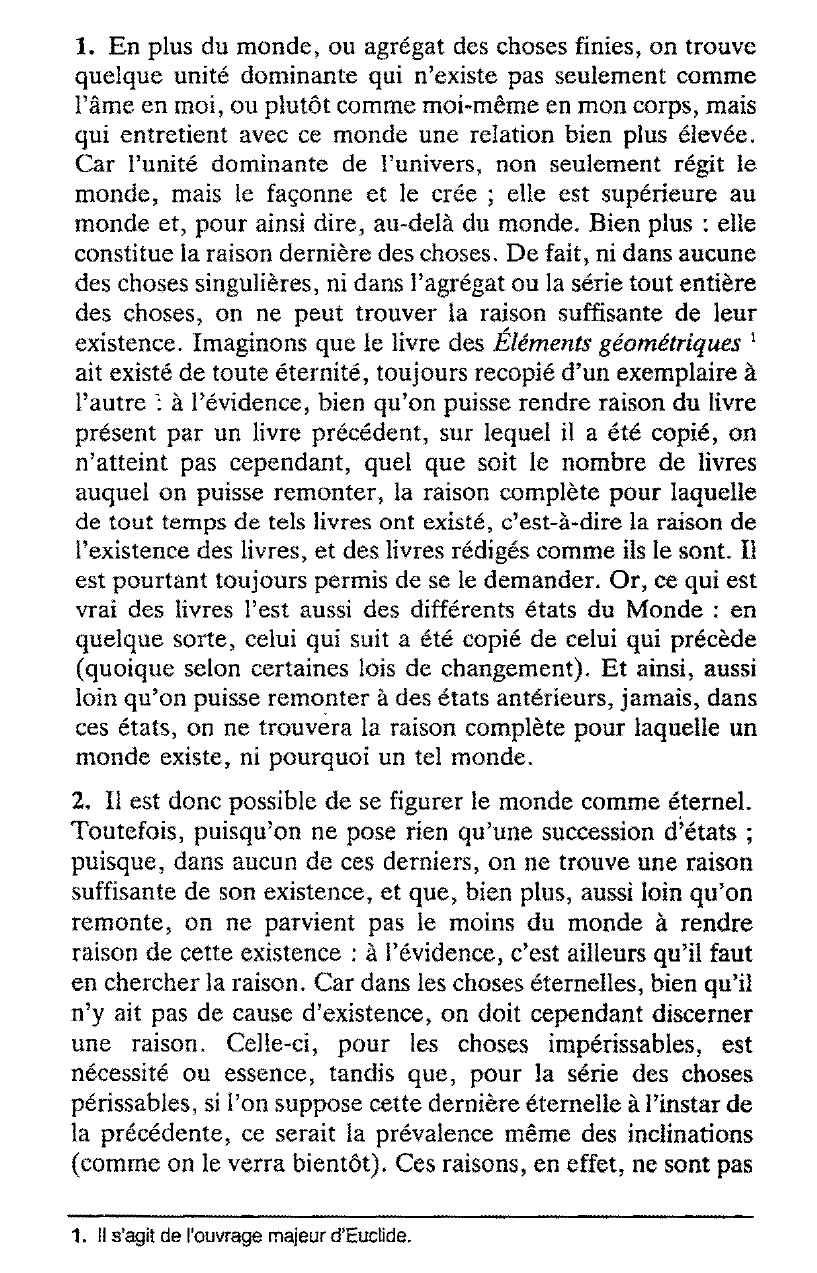Sur l’origine radicale des choses (1697) de Leibniz
Publié le 16/01/2020

Extrait du document

14. Quant à la partie qui, pour inharmonieuse qu’elle soit, peut, dans un ensemble, s’avérer parfaitement harmonieuse, il ne faut pas interpréter ce que nous en avons dit comme si nous ne tenions aucun compte des parties, et qu’il suffisait que le monde fût parfait en tous ses constituants, alors qu’il pourrait se faire que le genre humain connaisse le malheur, ou qu’il pourrait n’y avoir dans l’univers aucun souci de justice, ni y être tenu aucun compte de nous, comme le pensent certains qui ne jugent pas assez bien de l’ensemble des choses. Car, tout comme dans une république dotée d’une excellente Constitution on fait en sorte que chaque individu ait sa part de bonheur dans la mesure du possible, il faut savoir que l’univers sera d’autant plus parfait qu’on y prendra soin de chacun dans le respect de l’harmonie universelle. Et on n’a pu trouver aucune appréciation meilleure de cet état de fait que la loi même de la justice, qui ordonne que chacun obtienne une part de la perfection universelle, et que sa félicité personnelle soit en proportion de sa vertu propre et de la bonne volonté qu’il porte à la communauté. A cela se ramène ce que nous appelons charité ou amour de Dieu ; en cela aussi consistent la force et la puissance de la religion chrétienne, selon le jugement de savants théologiens. Nous ne devons pas non plus nous étonner de ce que les esprits soient l’objet de tant de sollicitude dans l’univers, puisqu’ils reflètent très fidèlement l’image de son suprême Auteur, et que leur rapport à lui n’est pas tant celui de la machine au constructeur (c’est le cas de toutes les autres choses), que celui des citoyens à leur prince. Il faut dire également que les esprits dureront autant que l’univers lui-même, qu’ils expriment et concentrent en quelque façon le Tout en eux-mêmes, si bien qu’on pourrait dire qu’ils sont des parties totales.
15. En ce qui concerne les malheurs, et surtout ceux qui frappent les gens de bien, il faut tenir pour certain qu’ils se transforment en un bien plus grand à leur avantage, et ceci est vrai non seulement d’un point de vue théologique, mais aussi d’un point de vue physique : le grain jeté en terre souffre avant de porter des fruits, et on peut dire qu’en général les malheurs sont des maux provisoires, mais qu’ils finissent par être des biens, puisqu’ils constituent des voies abrégées vers la plus grande perfection. Ainsi, en physique, les solutions qui fermentent lentement, s’améliorent aussi plus lentement, tandis que celles dans lesquelles on trouve un ferment plus puissant, repoussent leurs éléments vers l’extérieur avec plus de force, et se clarifient ainsi plus rapidement. A cette occasion, on peut dire qu’on recule pour mieux sauter. Il convient donc de considérer ces propos comme étant non seulement agréables et consolants, mais encore parfaitement véridiques. M’est avis qu’il n’y a rien dans l’univers de plus vrai que le bonheur, et de plus agréable et doux que la vérité.
16. Il faut reconnaître qu’il y a une progression continue et très libre de l’univers tout entier vers le plus haut degré de beauté et de perfection des œuvres divines, de telle sorte que l’univers progresse toujours vers une forme supérieure de civilisation. De même, maintenant, une grande partie de notre terre est cultivée et cette partie s’étendra de plus en plus. Et bien qu’on ne puisse nier que, parfois, des terres redeviennent sauvages ou que certains endroits soient détruits ou dégradés, il faut néanmoins comprendre ceci, comme nous venons d’interpréter le malheur : cette destruction ou cette dégradation servent à quelque chose de meilleur, de telle sorte que nous tirions d’une certaine façon profit de ce dommage.
17. On pourrait objecter qu’à ce compte, le monde aurait dû depuis longtemps devenir un paradis. Ma réponse est toute prête : bien que de nouvelles substances soient déjà parvenues à une grande perfection, la divisibilité à l’infini du continu fait que des parties demeurent toujours assoupies dans les abysses des choses, qu’il faut encore réveiller, développer, améliorer, et, pour ainsi dire, promouvoir à un stade supérieur d’évolution. Ainsi donc jamais le progrès ne sera achevé.
1. En plus du monde, ou agrégat des choses finies, on trouve quelque unité dominante qui n’existe pas seulement comme l’âme en moi, ou plutôt comme moi-même en mon corps, mais qui entretient avec ce monde une relation bien plus élevée. Car l'unité dominante de l’univers, non seulement régit le monde, mais le façonne et le crée ; elle est supérieure au monde et, pour ainsi dire, au-delà du monde. Bien plus : elle constitue la raison dernière des choses. De fait, ni dans aucune des choses singulières, ni dans l’agrégat ou la série tout entière des choses, on ne peut trouver la raison suffisante de leur existence. Imaginons que le livre des Éléments géométriques 1 ait existé de toute éternité, toujours recopié d’un exemplaire à l’autre : à l’évidence, bien qu’on puisse rendre raison du livre présent par un livre précédent, sur lequel il a été copié, on n’atteint pas cependant, quel que soit le nombre de livres auquel on puisse remonter, la raison complète pour laquelle de tout temps de tels livres ont existé, c’est-à-dire la raison de l’existence des livres, et des livres rédigés comme ils le sont. Il est pourtant toujours permis de se le demander. Or, ce qui est vrai des livres l’est aussi des différents états du Monde : en quelque sorte, celui qui suit a été copié de celui qui précède (quoique selon certaines lois de changement). Et ainsi, aussi loin qu’on puisse remonter à des états antérieurs, jamais, dans ces états, on ne trouvera la raison complète pour laquelle un monde existe, ni pourquoi un tel monde.
2. Il est donc possible de se figurer le monde comme étemel. Toutefois, puisqu’on ne pose rien qu’une succession d’états ; puisque, dans aucun de ces derniers, on ne trouve une raison suffisante de son existence, et que, bien plus, aussi loin qu’on remonte, on ne parvient pas le moins du monde à rendre raison de cette existence : à l’évidence, c’est ailleurs qu’il faut en chercher la raison. Car dans les choses éternelles, bien qu’il n’y ait pas de cause d’existence, on doit cependant discerner une raison. Celle-ci, pour les choses impérissables, est nécessité ou essence, tandis que, pour la série des choses périssables, si l’on suppose cette dernière éternelle à l’instar de la précédente, ce serait la prévalence même des inclinations (comme on le verra bientôt). Ces raisons, en effet, ne sont pas nécessitantes (au sens où la nécessité absolue ou métaphysique suppose que son contraire implique contradiction), mais inclinantes. D’où il ressort à l’évidence, qu’à supposer l’éternité du monde, on ne peut se soustraire à l’idée que la raison dernière des choses est au-delà du monde, qu’elle est Dieu.
3. Les raisons de l’existence du monde sont donc cachées en quelque être au-delà du monde, distinct de la chaîne des états ou de la série des choses dont l’agrégat constitue le monde. Et ainsi, d’une nécessité physique ou hypothétique qui détermine les réalités postérieures du monde à partir des réalités antérieures, il faut en venir à quelque chose qui relève d’une nécessité absolue ou métaphysique, telle qu’on ne puisse en rendre raison. Car le monde présent, pour nécessaire qu’il soit d’un point de vue physique ou hypothétique, ne l’est pas d’un point de vue absolu ou métaphysique. A supposer, n’est-ce pas, qu’il soit dans un état déterminé, il s’ensuit logiquement que d’autres états identiques se produiront par la suite. Ainsi donc, puisque la racine dernière du monde doit se trouver dans quelque chose qui relève d’une nécessité métaphysique, et que la raison de ce qui existe ne s’explique que par ce qui existe, il faut, par conséquent, qu’existe un Être unique, métaphysiquement nécessaire, c’est-à-dire de l’essence duquel découle l’existence, et, qu’en outre, existe quelque chose de différent de la pluralité des êtres ou du monde dont nous sommes convenus, et dont nous avons montré qu’il ne relevait pas d’une nécessité métaphysique.
4. Et pour expliquer un peu plus clairement comment, à partir de vérités éternelles, essentielles ou métaphysiques, naissent des vérités temporelles, contingentes ou physiques, il nous faut d’abord admettre, du fait même qu’il existe quelque chose plutôt que rien, qu’il y a dans les choses possibles, dans la possibilité elle-même ou essence, une exigence d’existence ou, pour ainsi dire, une prétention à l’existence ; en un mot, que l’essence tend par elle-même à l’existence. D’où il résulte enfin que toutes les choses possibles, celles qui expriment une essence ou une réalité possible, tendent à égalité de droit à l’existence, proportionnellement à leur quantité d’essence, de réalité, ou proportionnellement à leur degré de perfection. Car la perfection n’est rien d’autre que la quantité d’essence.

«
1.
En plus du monde, ou agrégat des choses finies, on trouve
quelque unité dominante qui n'existe pas seulement comme
l'âme en moi, ou plutôt comme moi-même en mon corps, mais
qui entretient avec ce monde une relation bien plus élevée.
Car l'unité dominante de l'univers, non seulement régit le
monde, mais le façonne et le crée ; elle est supérieure au
monde et, pour ainsi dire, au-delà du monde.
Bien plus : elle
constitue la raison dernière des choses.
De fait, ni dans aucune
des choses singulières, ni dans l'agrégat ou la série tout entière
des choses, on ne peut trouver la raison suffisante de leur
existence.
Imaginons que le livre des Éléments géométriques 1
ait existé de toute éternité, toujours recopié d'un exemplaire à
l'autre : à l'évidence, bien qu'on puisse rendre raison du livre
présent par un livre précédent, sur lequel il a été copié, on
n'atteint pas cependant, quel que soit le nombre de livres
auquel on puisse remonter, la raison complète pour laquelle
de tout temps de tels livres ont existé, c'est-à-dire la raison de
l'existence des livres, et des livres rédigés comme ils le sont.
Il
est pourtant toujours permis de se le demander.
Or, ce qui est
vrai des livres l'est aussi des différents états du Monde : en
quelque sorte, celui qui suit a été copié de celui qui précède
(quoique selon certaines lois de changement).
Et ainsi, aussi
loin qu'on puisse remonter à des états antérieurs, jamais, dans
ces états, on ne trouvèra la raison complète pour laquelle un
monde existe, ni pourquoi un tel monde.
2.
Il est donc possible de se figurer Je monde comme éternel.
Toutefois, puisqu'on ne pose rien qu'une succession d'états ;
puisque, dans aucun de ces derniers, on ne trouve une raison
suffisante de son existence, et que, bien plus, aussi loin qu'on
remonte, on ne parvient pas le moins du monde à rendre
raison de cette existence : à l'évidence, c'est ailleurs qu'il faut
en chercher la raison.
Car dans les choses éternelles, bien qu'il
n'y ait pas de cause d'existence, on doit cependant discerner
une raison.
Celle-ci, pour les choses impérissables, est
nécessité ou essence, tandis que, pour la série des choses
périssables, si l'on suppose cette dernière éternelle à l'instar de
la précédente, ce serait la prévalence même des inclinations
(comme on le verra bientôt).
Ces raisons, en effet, ne sont pas
1.
Il s'agit de l'ouvrage majeur d'Euclide.
42.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Leibniz : Sur l'origine radicale des choses de Leibniz
- ORIGINE RADICALE DES CHOSES (SUR L’), Gottfried Wilhelm Leibniz - résumé de l'oeuvre
- Sur l’origine radicale des choses
- ESSAIS DE THÉODICÉE SUR LA BONTÉ DE DIEU, LA LIBERTÉ DE L’HOMME ET L’ORIGINE DU MAL, 1710. Gottfried Wilhelm Leibniz
- La raison, cause de notre jugement ou cause dans les choses ? G. W. LEIBNIZ