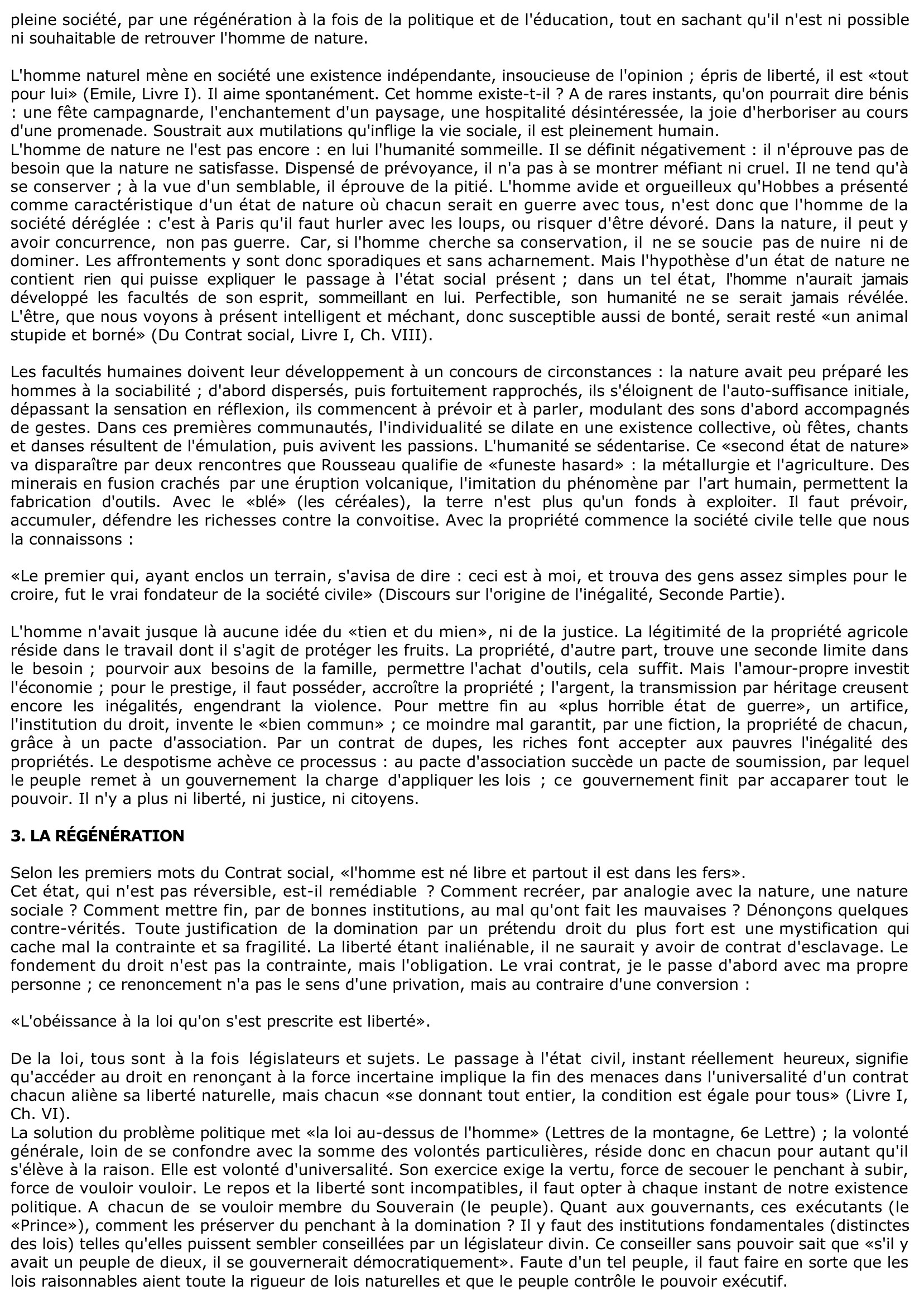Tout savoir sur Jean-Jacques ROUSSEAU…
Publié le 08/07/2009

Extrait du document

La vie de Jean-Jacques Rousseau fut difficile et vagabonde ; il naît à Genève le 28 juin 1712. Sa mère meurt quelques jours plus tard ; jusqu'à dix ans il vit avec son père, horloger, qui lui fait lire Plutarque. L'artisan devant quitter Genève à la suite d'une rixe, Jean-Jacques est placé en pension chez un pasteur ; trois années d'apprentissage, chez un greffier, puis chez un graveur, lui révèlent l'injustice et la brutalité. A seize ans, il s'enfuit et, muni d'une lettre de recommandation, se présente à Madame de Warens, à Annecy. Il se convertit au catholicisme et exerce divers emplois (de laquais, de précepteur). Chez Madame de Warens, aux Charmettes (près de Chambéry), il étudie le latin, la musique et lit les philosophes. C'est la période la plus heureuse de sa vie. En 1741, à Paris, il lit devant l'Académie des Sciences le projet d'une nouvelle notation musicale. Secrétaire d'ambassade à Venise, il découvre l'admirable musique italienne. Après une rupture avec l'ambassadeur qui lui doit ses appointements, Rousseau rentre à Paris ; il se lie avec une lingère, Thérèse Levasseur, dont il a des enfants, déposés à l'Hospice des Enfants-Trouvés. Il donnera plusieurs explications de cette faute, dont le remords le poursuit. En 1749, il rédige pour l'Encyclopédie les articles consacrés à la musique. Rendant visite à Diderot emprisonné au donjon de Vincennes, il lit le sujet mis au concours par l'Académie de Dijon «Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs«. Il prend le contre-pied de la confiance que ses contemporains placent dans le progrès des «Lumières«. Le Discours sur les sciences et les arts est couronné en 1750. Le 18 Octobre 1752, Le Devin du village, intermède musical en un acte représenté à Fontainebleau devant le roi, remporte un grand succès.
L'ouvrage est repris à l'Opéra en 1753, mais la Lettre sur la musique française attire à l'auteur l'hostilité des milieux musicaux. En 1754 paraît le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Rousseau réintègre la religion calviniste et la citoyenneté genevoise. Il réplique à d'Alembert qui réprouve l'interdiction des théâtres à Genève (Lettre sur les spectacles). Rousseau se retire à l'Ermitage, près de Montmorency, chez Madame d'Épinay. Il y écrit La Nouvelle Héloïse (publiée en 1761). En 1762, la publication du Contrat social et de l'Émile est suivie de condamnations à Paris et à Genève. Commence une vie errante (en Angleterre, Rousseau est, un moment, l'hôte de David Hume (1766). Hanté par la crainte que sa mémoire ne soit calomniée et ses papiers détruits, il consacre quatre années (1766-1770) à la rédaction des Confessions. Malgré la pensée d'un complot acharné à le perdre, il s'adonne à la botanique. De 1776 à 1778, il compose les Rêveries du promeneur solitaire. En mai 1778, il accepte l'hospitalité du Marquis de Girardin à Ermenonville. Il meurt le 2 Juillet. Soupçonné par les musiciens d'ignorer la musique pour en avoir écrit sans leur permission, condamné par l'archevêque de Paris pour avoir soutenu une foi qui se passe du témoignage humain, raillé par Voltaire, qui entend se réserver l'usage de l'irrespect, l'écrivain a raconté sa vie dans le souci de n'en rien dissimuler. Le philosophe a tenu cette suite d'épreuves pour exemplaire de l'énigme humaine.

«
pleine société, par une régénération à la fois de la politique et de l'éducation, tout en sachant qu'il n'est ni possibleni souhaitable de retrouver l'homme de nature.
L'homme naturel mène en société une existence indépendante, insoucieuse de l'opinion ; épris de liberté, il est «toutpour lui» (Emile, Livre I).
Il aime spontanément.
Cet homme existe-t-il ? A de rares instants, qu'on pourrait dire bénis: une fête campagnarde, l'enchantement d'un paysage, une hospitalité désintéressée, la joie d'herboriser au coursd'une promenade.
Soustrait aux mutilations qu'inflige la vie sociale, il est pleinement humain.L'homme de nature ne l'est pas encore : en lui l'humanité sommeille.
Il se définit négativement : il n'éprouve pas debesoin que la nature ne satisfasse.
Dispensé de prévoyance, il n'a pas à se montrer méfiant ni cruel.
Il ne tend qu'àse conserver ; à la vue d'un semblable, il éprouve de la pitié.
L'homme avide et orgueilleux qu'Hobbes a présentécomme caractéristique d'un état de nature où chacun serait en guerre avec tous, n'est donc que l'homme de lasociété déréglée : c'est à Paris qu'il faut hurler avec les loups, ou risquer d'être dévoré.
Dans la nature, il peut yavoir concurrence, non pas guerre.
Car, si l'homme cherche sa conservation, il ne se soucie pas de nuire ni dedominer.
Les affrontements y sont donc sporadiques et sans acharnement.
Mais l'hypothèse d'un état de nature necontient rien qui puisse expliquer le passage à l'état social présent ; dans un tel état, l'homme n'aurait jamaisdéveloppé les facultés de son esprit, sommeillant en lui.
Perfectible, son humanité ne se serait jamais révélée.L'être, que nous voyons à présent intelligent et méchant, donc susceptible aussi de bonté, serait resté «un animalstupide et borné» (Du Contrat social, Livre I, Ch.
VIII).
Les facultés humaines doivent leur développement à un concours de circonstances : la nature avait peu préparé leshommes à la sociabilité ; d'abord dispersés, puis fortuitement rapprochés, ils s'éloignent de l'auto-suffisance initiale,dépassant la sensation en réflexion, ils commencent à prévoir et à parler, modulant des sons d'abord accompagnésde gestes.
Dans ces premières communautés, l'individualité se dilate en une existence collective, où fêtes, chantset danses résultent de l'émulation, puis avivent les passions.
L'humanité se sédentarise.
Ce «second état de nature»va disparaître par deux rencontres que Rousseau qualifie de «funeste hasard» : la métallurgie et l'agriculture.
Desminerais en fusion crachés par une éruption volcanique, l'imitation du phénomène par l'art humain, permettent lafabrication d'outils.
Avec le «blé» (les céréales), la terre n'est plus qu'un fonds à exploiter.
Il faut prévoir,accumuler, défendre les richesses contre la convoitise.
Avec la propriété commence la société civile telle que nousla connaissons :
«Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour lecroire, fut le vrai fondateur de la société civile» (Discours sur l'origine de l'inégalité, Seconde Partie).
L'homme n'avait jusque là aucune idée du «tien et du mien», ni de la justice.
La légitimité de la propriété agricoleréside dans le travail dont il s'agit de protéger les fruits.
La propriété, d'autre part, trouve une seconde limite dansle besoin ; pourvoir aux besoins de la famille, permettre l'achat d'outils, cela suffit.
Mais l'amour-propre investitl'économie ; pour le prestige, il faut posséder, accroître la propriété ; l'argent, la transmission par héritage creusentencore les inégalités, engendrant la violence.
Pour mettre fin au «plus horrible état de guerre», un artifice,l'institution du droit, invente le «bien commun» ; ce moindre mal garantit, par une fiction, la propriété de chacun,grâce à un pacte d'association.
Par un contrat de dupes, les riches font accepter aux pauvres l'inégalité despropriétés.
Le despotisme achève ce processus : au pacte d'association succède un pacte de soumission, par lequelle peuple remet à un gouvernement la charge d'appliquer les lois ; ce gouvernement finit par accaparer tout lepouvoir.
Il n'y a plus ni liberté, ni justice, ni citoyens.
3.
LA RÉGÉNÉRATION
Selon les premiers mots du Contrat social, «l'homme est né libre et partout il est dans les fers».Cet état, qui n'est pas réversible, est-il remédiable ? Comment recréer, par analogie avec la nature, une naturesociale ? Comment mettre fin, par de bonnes institutions, au mal qu'ont fait les mauvaises ? Dénonçons quelquescontre-vérités.
Toute justification de la domination par un prétendu droit du plus fort est une mystification quicache mal la contrainte et sa fragilité.
La liberté étant inaliénable, il ne saurait y avoir de contrat d'esclavage.
Lefondement du droit n'est pas la contrainte, mais l'obligation.
Le vrai contrat, je le passe d'abord avec ma proprepersonne ; ce renoncement n'a pas le sens d'une privation, mais au contraire d'une conversion :
«L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté».
De la loi, tous sont à la fois législateurs et sujets.
Le passage à l'état civil, instant réellement heureux, signifiequ'accéder au droit en renonçant à la force incertaine implique la fin des menaces dans l'universalité d'un contratchacun aliène sa liberté naturelle, mais chacun «se donnant tout entier, la condition est égale pour tous» (Livre I,Ch.
VI).La solution du problème politique met «la loi au-dessus de l'homme» (Lettres de la montagne, 6e Lettre) ; la volontégénérale, loin de se confondre avec la somme des volontés particulières, réside donc en chacun pour autant qu'ils'élève à la raison.
Elle est volonté d'universalité.
Son exercice exige la vertu, force de secouer le penchant à subir,force de vouloir vouloir.
Le repos et la liberté sont incompatibles, il faut opter à chaque instant de notre existencepolitique.
A chacun de se vouloir membre du Souverain (le peuple).
Quant aux gouvernants, ces exécutants (le«Prince»), comment les préserver du penchant à la domination ? Il y faut des institutions fondamentales (distinctesdes lois) telles qu'elles puissent sembler conseillées par un législateur divin.
Ce conseiller sans pouvoir sait que «s'il yavait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement».
Faute d'un tel peuple, il faut faire en sorte que leslois raisonnables aient toute la rigueur de lois naturelles et que le peuple contrôle le pouvoir exécutif..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- Le due memorie di Jean-Jacques Rousseau
- Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau
- DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS, 1750. Jean-Jacques Rousseau - résumé de l'œuvre
- Confessions (les) de jean-Jacques Rousseau (résume et analyse complète)