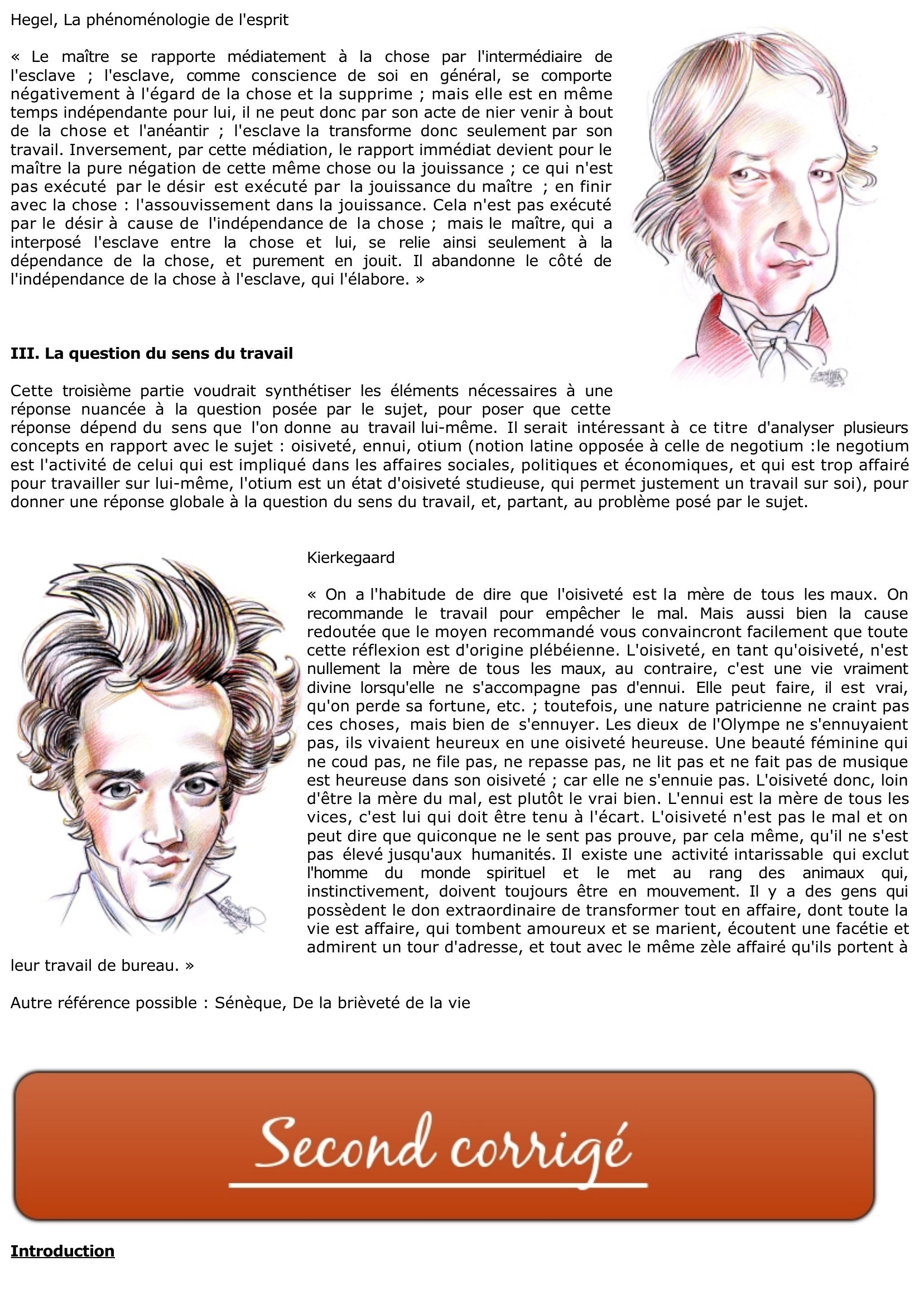Travailler moins est-ce mieux vivre ?
Publié le 27/02/2005

Extrait du document
Travailler, c’est exercer une certaine activité dans le but de produire quelque chose et/ou de gagner de l’argent pour vivre, de « gagner sa vie «. Cette alternative laisse entendre qu’il y a deux manières de concevoir le travail : ou bien on le considère comme une réalisation (d’une chose, ou même de soi), ou bien on l’envisage comme une activité à laquelle la société nous contraint, mais à laquelle nous sommes soumis. Les débats actuels sur la diminution du temps de travail penchent nettement pour la seconde alternative, et défendent l’idée d’un travail diminué dans le but d’une vie meilleure, avec plus de temps libre et une plus grande part accordée à la vie privée. Pourtant il faut savoir ce que l’on appelle « mieux vivre « : est-ce vivre avec plus de temps pour soi, ou plus de moyens financiers qui permettraient de vivre dans un confort matériel plus grand, ou bien est-ce réaliser plus de choses, se réaliser plus pleinement, et dans ce cas le travail et la vie meilleure seraient associés. Il faut envisager ces différentes positions, dans le but de répondre à la question en prenant en compte les différents aspects possibles du travail.
«
Hegel, La phénoménologie de l'esprit
« Le maître se rapporte médiatement à la chose par l'intermédiaire del'esclave ; l'esclave, comme conscience de soi en général, se comportenégativement à l'égard de la chose et la supprime ; mais elle est en mêmetemps indépendante pour lui, il ne peut donc par son acte de nier venir à boutde la chose et l'anéantir ; l'esclave la transforme donc seulement par sontravail.
Inversement, par cette médiation, le rapport immédiat devient pour lemaître la pure négation de cette même chose ou la jouissance ; ce qui n'estpas exécuté par le désir est exécuté par la jouissance du maître ; en finiravec la chose : l'assouvissement dans la jouissance.
Cela n'est pas exécutépar le désir à cause de l'indépendance de la chose ; mais le maître, qui ainterposé l'esclave entre la chose et lui, se relie ainsi seulement à ladépendance de la chose, et purement en jouit.
Il abandonne le côté del'indépendance de la chose à l'esclave, qui l'élabore.
»
III.
La question du sens du travail
Cette troisième partie voudrait synthétiser les éléments nécessaires à uneréponse nuancée à la question posée par le sujet, pour poser que cetteréponse dépend du sens que l'on donne au travail lui-même.
Il serait intéressant à ce titre d'analyser plusieursconcepts en rapport avec le sujet : oisiveté, ennui, otium (notion latine opposée à celle de negotium :le negotiumest l'activité de celui qui est impliqué dans les affaires sociales, politiques et économiques, et qui est trop affairépour travailler sur lui-même, l'otium est un état d'oisiveté studieuse, qui permet justement un travail sur soi), pourdonner une réponse globale à la question du sens du travail, et, partant, au problème posé par le sujet.
Kierkegaard
« On a l'habitude de dire que l'oisiveté est la mère de tous les maux.
Onrecommande le travail pour empêcher le mal.
Mais aussi bien la causeredoutée que le moyen recommandé vous convaincront facilement que toutecette réflexion est d'origine plébéienne.
L'oisiveté, en tant qu'oisiveté, n'estnullement la mère de tous les maux, au contraire, c'est une vie vraimentdivine lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'ennui.
Elle peut faire, il est vrai,qu'on perde sa fortune, etc.
; toutefois, une nature patricienne ne craint pasces choses, mais bien de s'ennuyer.
Les dieux de l'Olympe ne s'ennuyaientpas, ils vivaient heureux en une oisiveté heureuse.
Une beauté féminine quine coud pas, ne file pas, ne repasse pas, ne lit pas et ne fait pas de musiqueest heureuse dans son oisiveté ; car elle ne s'ennuie pas.
L'oisiveté donc, loind'être la mère du mal, est plutôt le vrai bien.
L'ennui est la mère de tous lesvices, c'est lui qui doit être tenu à l'écart.
L'oisiveté n'est pas le mal et onpeut dire que quiconque ne le sent pas prouve, par cela même, qu'il ne s'estpas élevé jusqu'aux humanités.
Il existe une activité intarissable qui exclutl'homme du monde spirituel et le met au rang des animaux qui,instinctivement, doivent toujours être en mouvement.
Il y a des gens quipossèdent le don extraordinaire de transformer tout en affaire, dont toute lavie est affaire, qui tombent amoureux et se marient, écoutent une facétie etadmirent un tour d'adresse, et tout avec le même zèle affairé qu'ils portent à leur travail de bureau.
»
Autre référence possible : Sénèque, De la brièveté de la vie
Introduction.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il travailler moins pour vivre mieux ?
- Travailler moins est-ce vivre mieux
- Travailler moins est-ce vivre mieux ?
- Mieux vivre est-ce travailler moins ?
- Travailler moins est-ce mieux vivre ?