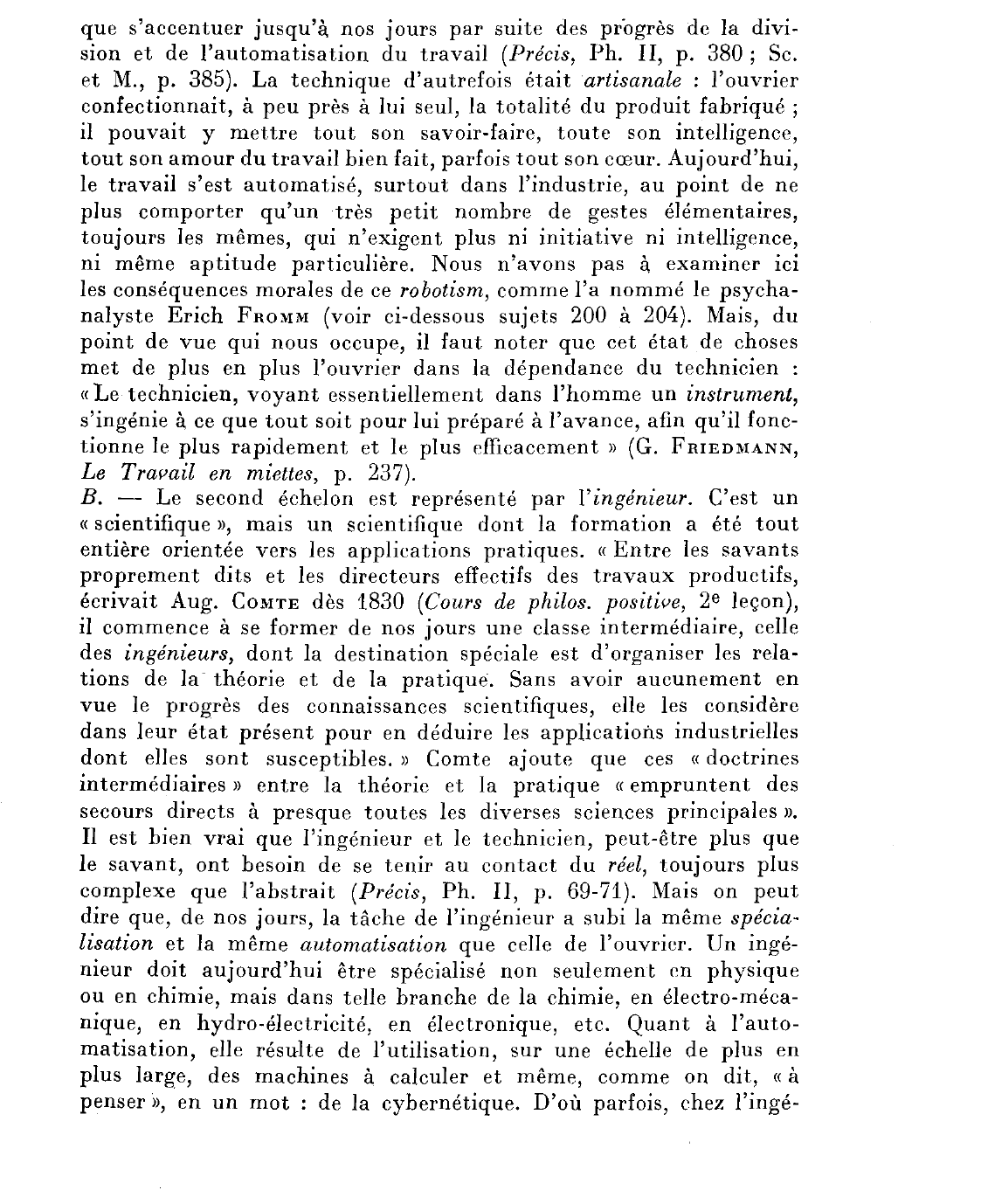Une civilisation industrielle n'a-t-elle besoin que de techniciens et doit-elle proscrire toute culture désintéressée ?
Publié le 12/10/2013

Extrait du document

Ajoutons que, si l'ouvrier d'aujourd'hui ne peut plus rien sans l'ingénieur et le technicien, ceux-ci réciproquement ne sauraient se passer, quel que soit le développement pris par les machines, de la main qui exécute. CI. DERNARD l'avait déjà dit : <

«
que s'accentuer jusqu'à, nos jours par suite des pr.ogrès de la divi
sion et de !'automatisation du travail (Précis, Ph.
II, p.
380; Sc.
et M., p.
385).
La technique d'autrefois était artisanale : l'ouvrier
confectionnait, à peu près à lui seul, la totalité du produit fabriqué ;
il
pouvait y mettre tout son savoir-faire, toute son intelligence,
tout son amour du travail bien fait, parfois tout son cœur.
Aujourd'hui,
le travail s'est automatisé, surtout dans l'industrie, au point de ne
plus comporter qu'un très petit nombre de gestes élémentaires,
toujours les mêmes, qui n'exigent plus ni initiative ni intelligence,
ni même aptitude particulière.
Nous n'avons pas à examiner ici
les
conséquences morales de ce robotism, comme l'a nommé le psycha
nalyste Erich FROMM (voir ci-dessous sujets 200 à 204).
Mais, du
point de vue qui nous occupe, il faut noter que cet état de choses
met de plus en plus l'ouvrier dans la dépendance du technicien :
cc Le technicien, voyant essentiellement dans l'homme un instrument,
s'ingénie à, ce que tout soit pour lui préparé à l'avance, afin qu'il fonc
tionne le plus rapidement et le plus dficacement >> (G.
FRIEDMANN,
Le Travail en miettes, p.
237).
B.
- Le second échelon est représenté par l'ingénieur.
C'est un
cc scientifique ))' mais un scientifique dont la formation a été tout
entière orientée vers les applications pratiques.
cc Entre les savants
proprement dits et les directeurs effectifs des travaux productifs,
écrivait Aug.
COMTE dès 1830 (Cours de philos.
positive, 2e leçon),
il
commence à se former de nos jours une classe intermédiaire, celle
des ingénieurs, dont la destination spéciale est d'organiser les rela
tions de la théorie et de la pratique.
Sans avoir aucunement en
vue le progrès des connaissances scientifiques, elle les considère
dans leur état présent pour en déduire les applications industrielles
dont elles sont susceptibles.
>> Comte ajoute que ces cc doctrines
intermédiaires >> entre la théorie et la pratique cc empruntent des
secours directs à presque toutes les diverses sciences principales >>.
Il est bien vrai que l'ingénieur et le technicien, peut-être plus que
le savant, ont besoin de se tenir au contact du réel, toujours plus
complexe que l'abstrait (Précis, Ph.
II, p.
69-71).
Mais on peut
dire que, de nos jours, la tâche de l'ingénieur a subi la même spécia
lisation et la même automatisation que celle de l'ouvrier.
Un ingé
nieur doit aujourd'hui être spécialisé non seulement en physique
ou en chimie, mais dans telle branche de la chimie, en électro-méca
nique, en hydro-électricité, en électronique, etc.
Quant à l'auto
matisation, elle résulte de l'utilisation, sur une échelle de plus en
plus large, des machines à calculer et même, comme on dit, cc à
penser))' en un mot : de la cybernétique.
D'où parfois, chez l'ingé-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Une civilisation industrielle n'a-t-elle besoin que de techniciens et doit-elle proscrire toute culture désintéressée ?
- Une civilisation industrielle n'a-t-elle besoin que de techniciens et doit-elle proscrire toute culture désintéressée ?
- Quels traits essentiels caractérisent une civilisation scientifique ? Pensez-vous qu'une forte culture scientifique suffit au technicien qui entend dominer complètement son métier ?
- Commentez et discutez le texte suivant : « Notre époque technique n'a fait qu'augmenter le besoin d'une culture générale solide... De plus en plus, les grands industriels et même les purs scientifiques, tendent à recruter des collaborateurs cultivés de préférence à des collaborateurs avertis : les se-conds, bien souvent, ne progressent guère au-delà de leur succès initial, alors que les premiers sont sus-ceptibles d'apprendre. » « La culture générale n'est nullement cette culture vaine
- Montaigne dit : « J'aime mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. » Cette phrase s'adressait à la formation désintéressée d'un public qui ne visait qu'à la culture générale. Vous paraît-elle aussi convenir à l'instruction d'un technicien ?