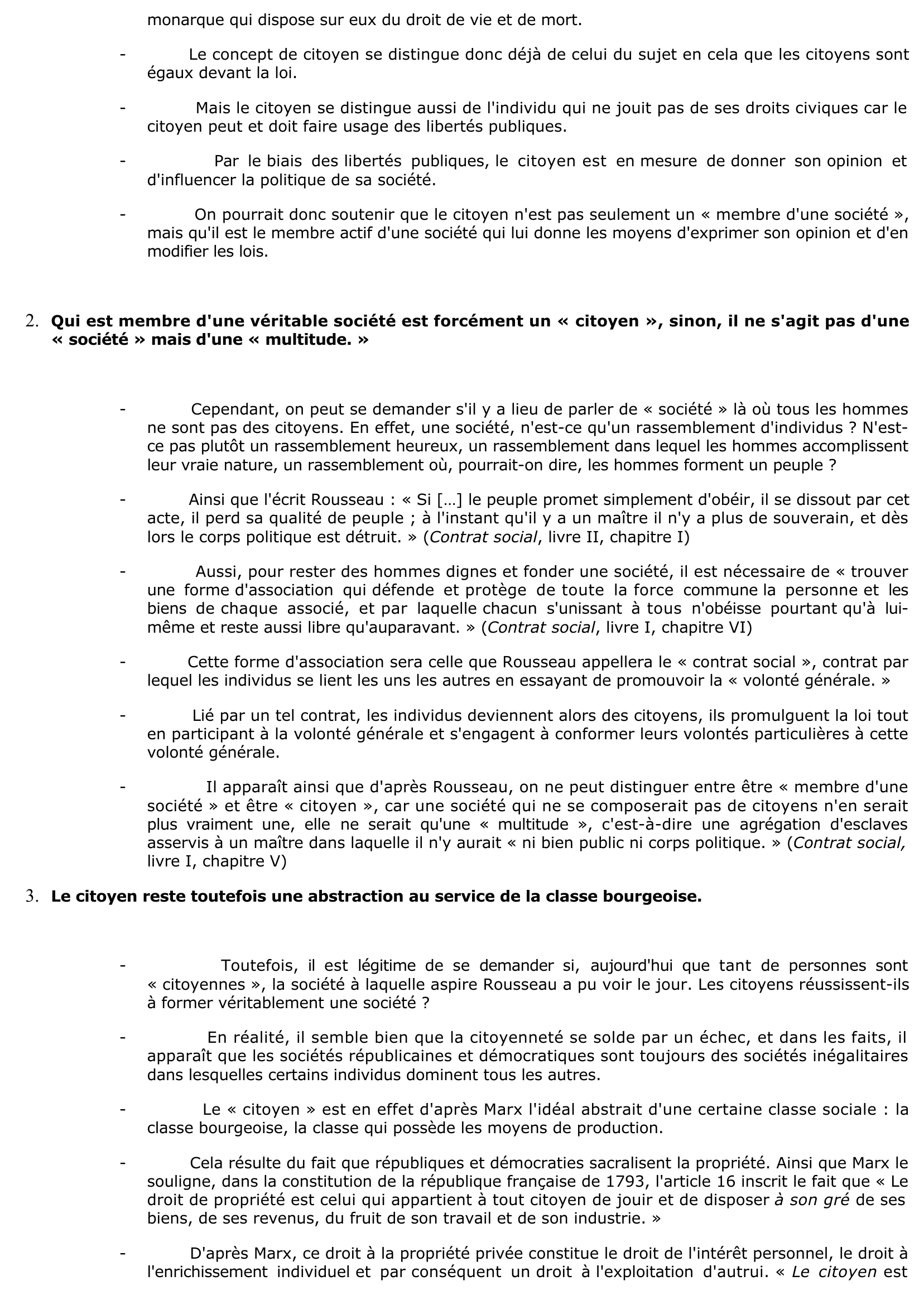Y a-t-il une différence entre être membre d'une société et être citoyen ?
Publié le 24/03/2004

Extrait du document
De prime abord, il semble évident qu’une différence existe entre « être membre d’une société « et « être citoyen «, car on sait bien qu’il existe des sociétés sans citoyens. Cependant, cette différence peut s’atténuer si l’on adopte un point de vue particulier sur la notion de « société «. En effet, si l’on considère que la société est une forme de vie en communauté dans laquelle l’individu se réalise pleinement, on aura facilement tendance à penser que les membres d’une telle « société « seront nécessairement des « citoyens «. Le problème consistera donc plutôt à savoir si la citoyenneté constitue l’élément fondamental de toute communauté heureuse.
«
monarque qui dispose sur eux du droit de vie et de mort.
- Le concept de citoyen se distingue donc déjà de celui du sujet en cela que les citoyens sont égaux devant la loi.
- Mais le citoyen se distingue aussi de l'individu qui ne jouit pas de ses droits civiques car le citoyen peut et doit faire usage des libertés publiques.
- Par le biais des libertés publiques, le citoyen est en mesure de donner son opinion et d'influencer la politique de sa société.
- On pourrait donc soutenir que le citoyen n'est pas seulement un « membre d'une société », mais qu'il est le membre actif d'une société qui lui donne les moyens d'exprimer son opinion et d'enmodifier les lois.
Qui est membre d'une véritable société est forcément un « citoyen », sinon, il ne s'agit pas d'une« société » mais d'une « multitude.
» 2.
- Cependant, on peut se demander s'il y a lieu de parler de « société » là où tous les hommes ne sont pas des citoyens.
En effet, une société, n'est-ce qu'un rassemblement d'individus ? N'est-ce pas plutôt un rassemblement heureux, un rassemblement dans lequel les hommes accomplissentleur vraie nature, un rassemblement où, pourrait-on dire, les hommes forment un peuple ?
- Ainsi que l'écrit Rousseau : « Si […] le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l'instant qu'il y a un maître il n'y a plus de souverain, et dèslors le corps politique est détruit.
» ( Contrat social , livre II, chapitre I)
- Aussi, pour rester des hommes dignes et fonder une société, il est nécessaire de « trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et lesbiens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant.
» ( Contrat social , livre I, chapitre VI)
- Cette forme d'association sera celle que Rousseau appellera le « contrat social », contrat par lequel les individus se lient les uns les autres en essayant de promouvoir la « volonté générale.
»
- Lié par un tel contrat, les individus deviennent alors des citoyens, ils promulguent la loi tout en participant à la volonté générale et s'engagent à conformer leurs volontés particulières à cettevolonté générale.
- Il apparaît ainsi que d'après Rousseau, on ne peut distinguer entre être « membre d'une société » et être « citoyen », car une société qui ne se composerait pas de citoyens n'en seraitplus vraiment une, elle ne serait qu'une « multitude », c'est-à-dire une agrégation d'esclavesasservis à un maître dans laquelle il n'y aurait « ni bien public ni corps politique.
» ( Contrat social, livre I, chapitre V)
Le citoyen reste toutefois une abstraction au service de la classe bourgeoise. 3.
- Toutefois, il est légitime de se demander si, aujourd'hui que tant de personnes sont « citoyennes », la société à laquelle aspire Rousseau a pu voir le jour.
Les citoyens réussissent-ilsà former véritablement une société ?
- En réalité, il semble bien que la citoyenneté se solde par un échec, et dans les faits, il apparaît que les sociétés républicaines et démocratiques sont toujours des sociétés inégalitairesdans lesquelles certains individus dominent tous les autres.
- Le « citoyen » est en effet d'après Marx l'idéal abstrait d'une certaine classe sociale : la classe bourgeoise, la classe qui possède les moyens de production.
- Cela résulte du fait que républiques et démocraties sacralisent la propriété.
Ainsi que Marx le souligne, dans la constitution de la république française de 1793, l'article 16 inscrit le fait que « Ledroit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
»
- D'après Marx, ce droit à la propriété privée constitue le droit de l'intérêt personnel, le droit à l'enrichissement individuel et par conséquent un droit à l'exploitation d'autrui.
« Le citoyen est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentez cette définition des «lumières» par Kant (article «Qu'est-ce que les Lumières ?») : «Qu'est-ce que les Lumières ? La sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere
- Hobbes, du citoyen: « hors de la société civile »
- Il y a cette différence entre les devoirs que la religion nous oblige à rendre à Dieu, et ceux que la société demande que nous rendions aux autres hommes, que les principaux devoirs de la religion sont intérieurs et spirituels : parce que Dieu pénètre les c?
- Commentaire de texte de Montesquieu : De l'esprit des lois : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'à point de Constitution ». Cette disposition de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 que l'on trouve en son article 16 constitue encore de nos jours une valeur essentielle.
- Peut-on dire que la tolérance à l'égard de la différence est non seulement une attitude morale, mais aussi un comportement utile à la société ?