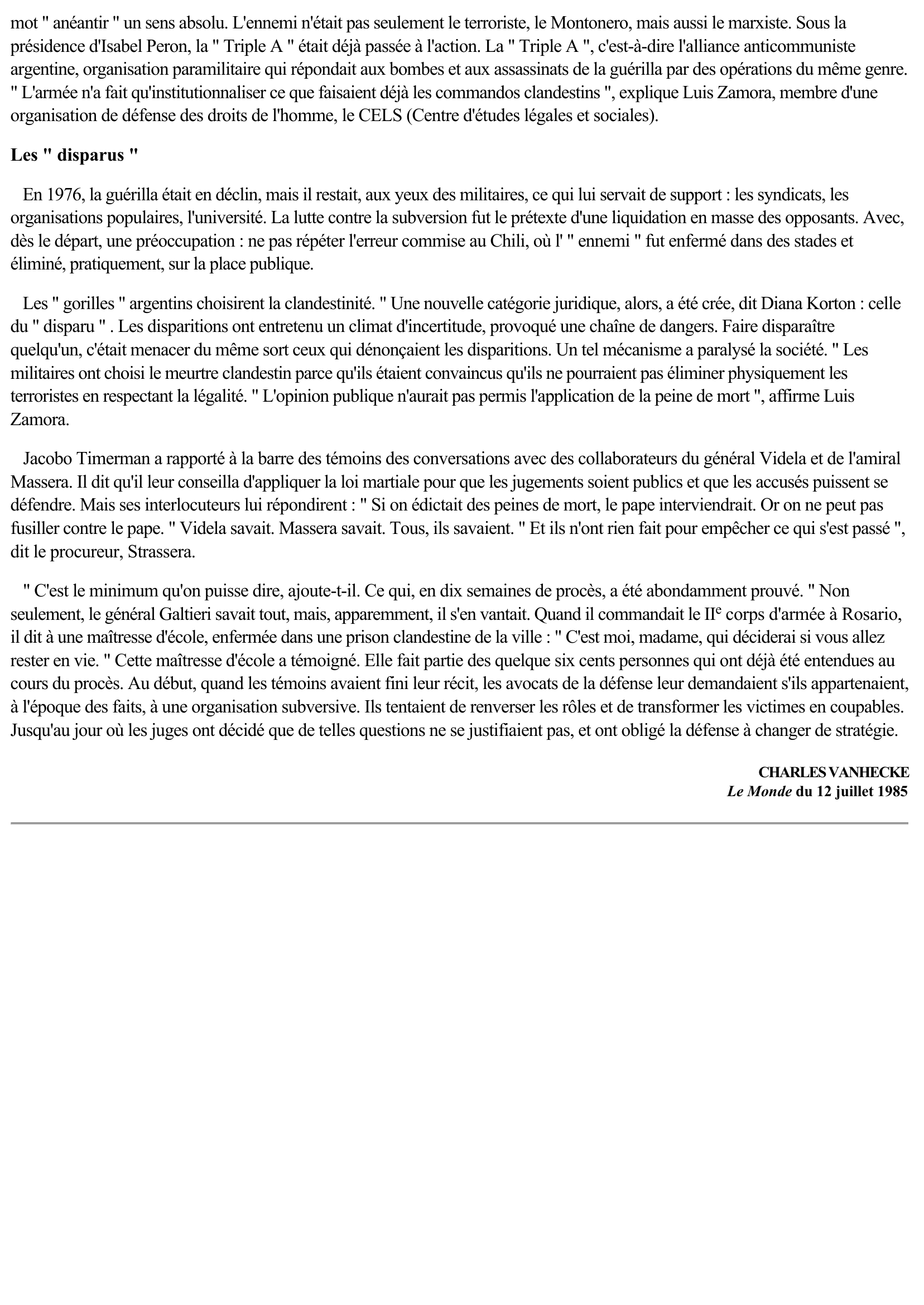Article de presse: Argentine, le procès des années de sang
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
mot " anéantir " un sens absolu.
L'ennemi n'était pas seulement le terroriste, le Montonero, mais aussi le marxiste.
Sous laprésidence d'Isabel Peron, la " Triple A " était déjà passée à l'action.
La " Triple A ", c'est-à-dire l'alliance anticommunisteargentine, organisation paramilitaire qui répondait aux bombes et aux assassinats de la guérilla par des opérations du même genre." L'armée n'a fait qu'institutionnaliser ce que faisaient déjà les commandos clandestins ", explique Luis Zamora, membre d'uneorganisation de défense des droits de l'homme, le CELS (Centre d'études légales et sociales).
Les " disparus "
En 1976, la guérilla était en déclin, mais il restait, aux yeux des militaires, ce qui lui servait de support : les syndicats, lesorganisations populaires, l'université.
La lutte contre la subversion fut le prétexte d'une liquidation en masse des opposants.
Avec,dès le départ, une préoccupation : ne pas répéter l'erreur commise au Chili, où l' " ennemi " fut enfermé dans des stades etéliminé, pratiquement, sur la place publique.
Les " gorilles " argentins choisirent la clandestinité.
" Une nouvelle catégorie juridique, alors, a été crée, dit Diana Korton : celledu " disparu " .
Les disparitions ont entretenu un climat d'incertitude, provoqué une chaîne de dangers.
Faire disparaîtrequelqu'un, c'était menacer du même sort ceux qui dénonçaient les disparitions.
Un tel mécanisme a paralysé la société.
" Lesmilitaires ont choisi le meurtre clandestin parce qu'ils étaient convaincus qu'ils ne pourraient pas éliminer physiquement lesterroristes en respectant la légalité.
" L'opinion publique n'aurait pas permis l'application de la peine de mort ", affirme LuisZamora.
Jacobo Timerman a rapporté à la barre des témoins des conversations avec des collaborateurs du général Videla et de l'amiralMassera.
Il dit qu'il leur conseilla d'appliquer la loi martiale pour que les jugements soient publics et que les accusés puissent sedéfendre.
Mais ses interlocuteurs lui répondirent : " Si on édictait des peines de mort, le pape interviendrait.
Or on ne peut pasfusiller contre le pape.
" Videla savait.
Massera savait.
Tous, ils savaient.
" Et ils n'ont rien fait pour empêcher ce qui s'est passé ",dit le procureur, Strassera.
" C'est le minimum qu'on puisse dire, ajoute-t-il.
Ce qui, en dix semaines de procès, a été abondamment prouvé.
" Nonseulement, le général Galtieri savait tout, mais, apparemment, il s'en vantait.
Quand il commandait le II e corps d'armée à Rosario, il dit à une maîtresse d'école, enfermée dans une prison clandestine de la ville : " C'est moi, madame, qui déciderai si vous allezrester en vie.
" Cette maîtresse d'école a témoigné.
Elle fait partie des quelque six cents personnes qui ont déjà été entendues aucours du procès.
Au début, quand les témoins avaient fini leur récit, les avocats de la défense leur demandaient s'ils appartenaient,à l'époque des faits, à une organisation subversive.
Ils tentaient de renverser les rôles et de transformer les victimes en coupables.Jusqu'au jour où les juges ont décidé que de telles questions ne se justifiaient pas, et ont obligé la défense à changer de stratégie.
CHARLES VANHECKE Le Monde du 12 juillet 1985.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Article de presse: Carter, quatre années d'improvisation au nom de la morale
- Article de presse: Le procès de Nuremberg
- Article de presse: RFA, les années de plomb
- ARTICLE DE PRESSE: Le procès de la section spéciale
- ARTICLE DE PRESSE: Autoroutes de l'information , le New Deal des années 90