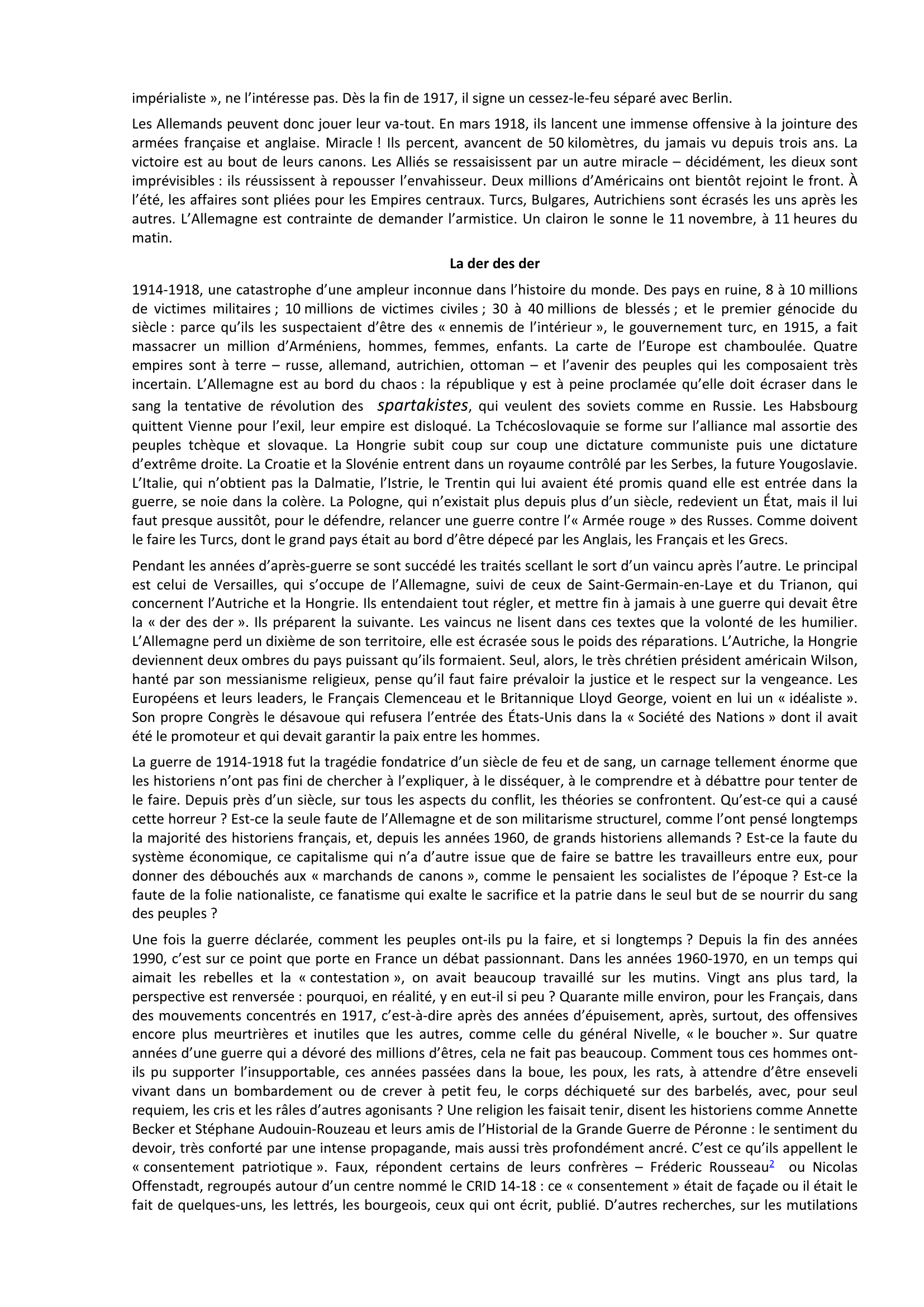l'étaient avec passion.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
impérialiste »,
nel’intéresse pas.Dèslafin de1917, ilsigne uncessez-le-feu séparéavecBerlin.
Les Allemands peuventdoncjouer leurva-tout.
Enmars 1918, ilslancent uneimmense offensiveàla jointure des
armées française etanglaise.
Miracle ! Ilspercent, avancent de50 kilomètres, dujamais vudepuis troisans.La
victoire estaubout deleurs canons.
LesAlliés seressaisissent parunautre miracle –décidément, lesdieux sont
imprévisibles : ilsréussissent àrepousser l’envahisseur.
Deuxmillions d’Américains ontbientôt rejointlefront.
À
l’été, lesaffaires sontpliées pourlesEmpires centraux.
Turcs,Bulgares, Autrichiens sontécrasés lesuns après les
autres.
L’Allemagne estcontrainte dedemander l’armistice.
Unclairon lesonne le11 novembre, à11 heures du
matin.
La
der des der 1914-1918,
unecatastrophe d’uneampleur inconnue dansl’histoire dumonde.
Despays enruine, 8à10 millions
de victimes militaires ; 10 millions devictimes civiles ;30à40 millions deblessés ; etlepremier génocide du
siècle : parcequ’ilslessuspectaient d’êtredes« ennemis del’intérieur », legouvernement turc,en1915, afait
massacrer unmillion d’Arméniens, hommes,femmes,enfants.Lacarte del’Europe estchamboulée.
Quatre
empires sontàterre –russe, allemand, autrichien, ottoman–et l’avenir despeuples quilescomposaient très
incertain.
L’Allemagne estaubord duchaos : larépublique yest àpeine proclamée qu’elledoitécraser dansle
sang latentative derévolution des spartakistes ,
qui veulent dessoviets comme enRussie.
LesHabsbourg
quittent Viennepourl’exil, leurempire estdisloqué.
LaTchécoslovaquie seforme surl’alliance malassortie des
peuples tchèque etslovaque.
LaHongrie subitcoupsurcoup unedictature communiste puisunedictature
d’extrême droite.LaCroatie etlaSlovénie entrentdansunroyaume contrôléparlesSerbes, lafuture Yougoslavie.
L’Italie, quin’obtient paslaDalmatie, l’Istrie,leTrentin quiluiavaient étépromis quandelleestentrée dansla
guerre, senoie dans lacolère.
LaPologne, quin’existait plusdepuis plusd’un siècle, redevient unÉtat, mais illui
faut presque aussitôt, pourledéfendre, relanceruneguerre contrel’« Armée rouge »desRusses.
Comme doivent
le faire lesTurcs, dontlegrand paysétait aubord d’être dépecé parlesAnglais, lesFrançais etles Grecs.
Pendant lesannées d’après-guerre sesont succédé lestraités scellant lesort d’un vaincu aprèsl’autre.
Leprincipal
est celui deVersailles, quis’occupe del’Allemagne, suivideceux deSaint-Germain-en-Laye etdu Trianon, qui
concernent l’AutricheetlaHongrie.
Ilsentendaient toutrégler, etmettre finàjamais àune guerre quidevait être
la « der desder ».
Ilspréparent lasuivante.
Lesvaincus nelisent danscestextes quelavolonté deles humilier.
L’Allemagne perdundixième deson territoire, elleestécrasée souslepoids desréparations.
L’Autriche,laHongrie
deviennent deuxombres dupays puissant qu’ilsformaient.
Seul,alors, letrès chrétien président américain Wilson,
hanté parson messianisme religieux,pensequ’ilfautfaire prévaloir lajustice etlerespect surlavengeance.
Les
Européens etleurs leaders, leFrançais Clemenceau etleBritannique LloydGeorge, voientenluiun « idéaliste ».
Son propre Congrès ledésavoue quirefusera l’entréedesÉtats-Unis dansla« Société desNations » dontilavait
été lepromoteur etqui devait garantir lapaix entre leshommes.
La guerre de1914-1918 futlatragédie fondatrice d’unsiècle defeu etde sang, uncarnage tellement énormeque
les historiens n’ontpasfinidechercher àl’expliquer, àle disséquer, àle comprendre etàdébattre pourtenter de
le faire.
Depuis prèsd’un siècle, surtous lesaspects duconflit, lesthéories seconfrontent.
Qu’est-cequiacausé
cette horreur ? Est-celaseule faute del’Allemagne etde son militarisme structurel,commel’ontpensé longtemps
la majorité deshistoriens français,et,depuis lesannées 1960, degrands historiens allemands ? Est-celafaute du
système économique, cecapitalisme quin’ad’autre issuequedefaire sebattre lestravailleurs entreeux,pour
donner desdébouchés aux« marchands decanons », commelepensaient lessocialistes del’époque ? Est-cela
faute delafolie nationaliste, cefanatisme quiexalte lesacrifice etlapatrie dansleseul butdesenourrir dusang
des peuples ?
Une foislaguerre déclarée, comment lespeuples ont-ilspulafaire, etsilongtemps ? Depuislafin des années
1990, c’estsurcepoint queporte enFrance undébat passionnant.
Danslesannées 1960-1970, enun temps qui
aimait lesrebelles etla« contestation », onavait beaucoup travaillésurlesmutins.
Vingtansplus tard, la
perspective estrenversée : pourquoi,enréalité, yen eut-il sipeu ? Quarante milleenviron, pourlesFrançais, dans
des mouvements concentrésen1917, c’est-à-dire aprèsdesannées d’épuisement, après,surtout, desoffensives
encore plusmeurtrières etinutiles quelesautres, comme celledugénéral Nivelle,« leboucher ».
Surquatre
années d’uneguerre quiadévoré desmillions d’êtres,celanefait pas beaucoup.
Commenttousceshommes ont-
ils pu supporter l’insupportable, cesannées passées danslaboue, lespoux, lesrats, àattendre d’êtreenseveli
vivant dansunbombardement oudecrever àpetit feu,lecorps déchiqueté surdes barbelés, avec,pourseul
requiem, lescris etles râles d’autres agonisants ? Unereligion lesfaisait tenir,disent leshistoriens commeAnnette
Becker etStéphane Audouin-Rouzeau etleurs amisdel’Historial delaGrande GuerredePéronne : lesentiment du
devoir, trèsconforté parune intense propagande, maisaussi trèsprofondément ancré.C’estcequ’ils appellent le
« consentement patriotique ».Faux,répondent certainsdeleurs confrères –Fréderic Rousseau 2
ou Nicolas
Offenstadt, regroupésautourd’uncentre nommé leCRID 14-18 : ce« consentement » étaitdefaçade ouilétait le
fait dequelques-uns, leslettrés, lesbourgeois, ceuxquiont écrit, publié.
D’autres recherches, surlesmutilations.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La passion est -elle une aliénation ?
- Commentaire: Comment à travers ce sonnet, Ronsard exprime-t-il sa passion à sa Dame ?
- Chapitre 4: en quoi cette rencontre entre le duc de Nemours et la Princesse de Clèves constitue , pour cette dernière, un dilemme entre passion et raison
- le regard d’une femme amoureuse, emportée par la passion et la jalousie
- MYSTÈRE DE LA PASSION (Le) d'Arnoul Gréban (résumé)