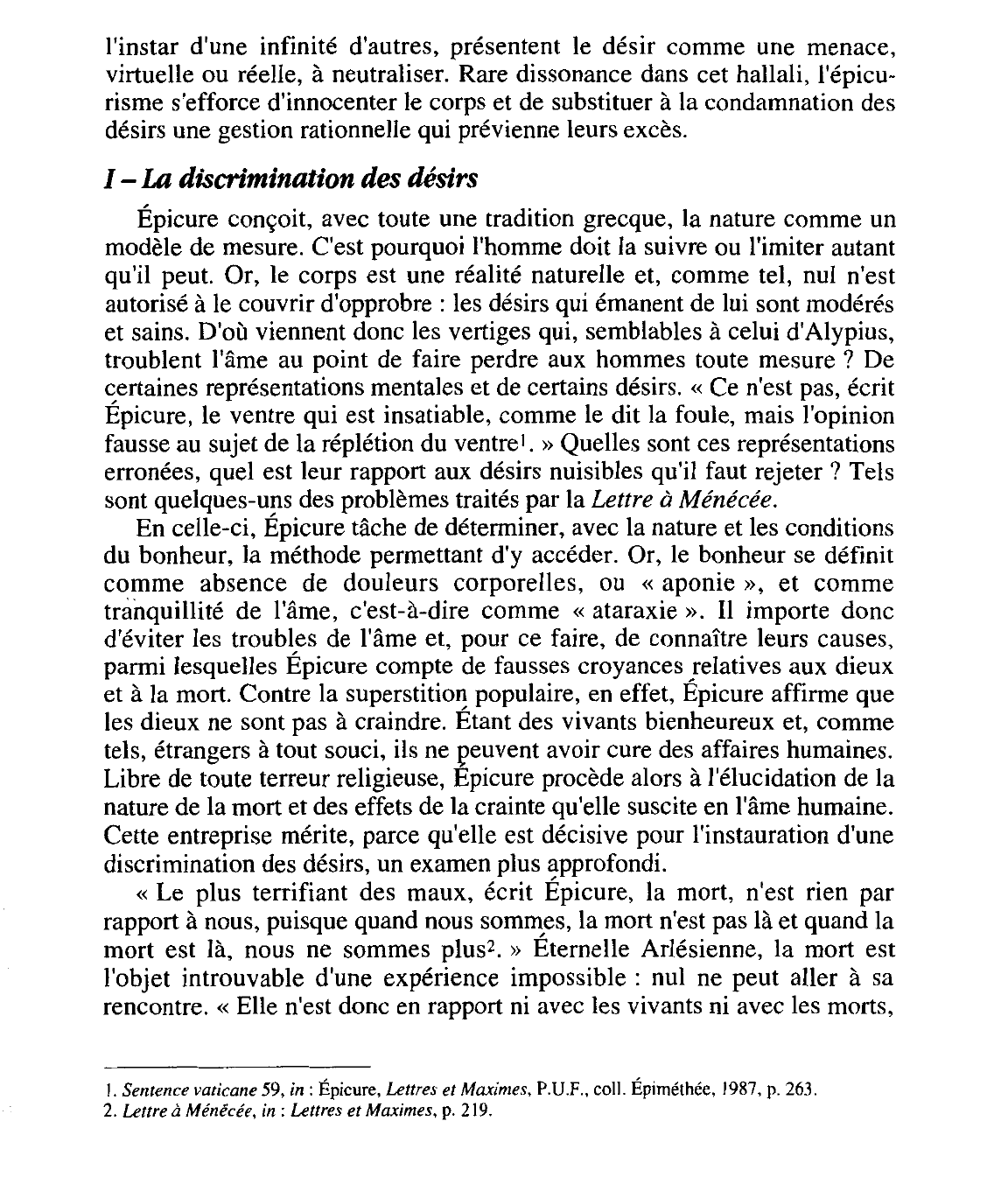Le désir (cours de philo - TL)
Publié le 20/03/2015

Extrait du document
Saint Augustin raconte, dans ses Confessions, comment la passion des jeux du cirque envoûta son ami Alypius : des camarades d'études l'emmen�rent, malgré ses protestations et ses récriminations, à l'amphithéâtre où ces jeux étaient donnés.
Alypius, en effet, qui, dans l'amphithéâtre, avait fermé les yeux, ne put s'empêcher de les rouvrir lorsque s'éleva la clameur de la foule excitée par la chute d'un gladiateur.
Il en savourait à son insu la fureur, ravi par ces luttes criminelles, ivre de sanglante volupté2.
En ce récit, l'expérience du désir équivaut à une humiliation.
Celui-ci, en effet, déjoue les plans d'Alypius en se jouant de sa résolution.
Son âme ne mord pas moins la terre que ne le fait le gladiateur touché.
Blessure, chute et ivresse évoquent tour à tour l'impuissance d'Alypius en proie à l'irrationnelle impétuosité du désir.
Et son âme encore, apr�s qu'il soit tombé, lui est enfin «ravie� ; le désir l'enl�ve, l'emporte, la transporte.
A l'humiliation succ�de alors l'aliénation.
Alypius est possédé et dépossédé, rendu comme étranger à lui-même.
Ne goûte-t-il pas un plaisir qu'en son âme et conscience, il juge dégoûtant?
Philosophes et théologiens se sont inquiétés de la faiblesse humaine illustrée par cette mésaventure.
C'est pourquoi ils ont élaboré des méthodes censées préserver ou restaurer la souveraineté de l'esprit sur le corps, source des désirs.
l'instar d'une infinité d'autres, présentent le désir comme une menace, virtuelle ou réelle, à neutraliser.
Rare dissonance dans cet hallali, l'épicurisme s'efforce d'innocenter le corps et de substituer à la condamnation des désirs une gestion rationnelle qui prévienne leurs exc�s.
I --- La discrimination des désirs Épicure conçoit, avec toute une tradition grecque, la nature comme un mod�le de mesure.
C'est pourquoi l'homme doit la suivre ou l'imiter autant qu'il peut.
Or, le corps est une réalité naturelle et, comme tel, nul n'est autorisé à le couvrir d'opprobre : les désirs qui émanent de lui sont modérés et sains.
D'où viennent donc les vertiges qui, semblables à celui d'Alypius, troublent l'âme au point de faire perdre aux hommes toute mesure?
De certaines représentations mentales et de certains désirs.
Tels sont quelques-uns des probl�mes traités par la Lettre à Ménécée.
En celle-ci, Épicure tâche de déterminer, avec la nature et les conditions du bonheur, la méthode permettant d'y accéder.
Or, le bonheur se définit comme absence de douleurs corporelles, ou «aponie�, et comme tranquillité de l'âme, c'est-à-dire comme «ataraxie�.
Il importe donc d'éviter les troubles de l'âme et, pour ce faire, de connaître leurs causes, parmi lesquelles Épicure compte de fausses croyances relatives aux dieux et à la mort.
Contre la superstition populaire, en effet, Épicure affirme que les dieux ne sont pas à craindre.
Étant des vivants bienheureux et, comme tels, étrangers à tout souci, ils ne peuvent avoir cure des affaires humaines.
Libre de toute terreur religieuse, Epicure proc�de alors à l'élucidation de la nature de la mort et des effets de la crainte qu'elle suscite en l'âme humaine.
Cette entreprise mérite, parce qu'elle est décisive pour l'instauration d'une discrimination des désirs, un examen plus approfondi.
2. Lettre à Ménécée, in : Lettres et Maximes, p. 219.
puisque, pour les uns, elle n'est pas, et que les autres ne sont plus.
� La mort n'est donc pas plus à craindre que les dieux : «tout bien --- et tout mal --- est dans la sensation : or la mort est privation de sensation;.
L'infirmation de nos fausses opinions relatives à la mort a une conséquence pratique capitale : elle nous permet d'ôter leur impétuosité aux désirs vains, que nos craintes entretiennent.
La crainte de la mort, contre-nature en ce qu'elle proc�de d'une erreur relative à une réalité naturelle, provoque la frénésie et la surench�re des désirs vains, que rien au monde ne peut satisfaire.
Les désirs vains doivent être absolument refoulés, les désirs naturels peuvent être comblés lorsqu'ils sont nécessaires --- ainsi la faim, la soif et tous les désirs dont la satisfaction maintient le bien-être du corps et de l'âme ---, mais aussi lorsqu'ils ne le sont pas --- comme le désir de varier les plaisirs culinaires, le désir sexuel et la recherche d'émotions esthétiques.
C'est pourquoi le désir est décevant : il nous fait espérer une expérience positive du plaisir, qu'en disparaissant il rend impossible.
Aussi la surench�re et l'insatiabilité ne caractérisent-elles pas seulement les désirs dévoyés par de fausses opinions ; elles appartiennent à l'essence la plus intime du désir, que Schopenhauer nomme, nous le savons, «volonté�.
La déception, en effet, au lieu d'éteindre le foyer du désir, ne fait, en r�gle générale, que l'attiser.
La deuxi�me est l'expérience morale de la pitié, laquelle nous fait saisir intuitivement, avec l'identité profonde des individus, les tortures que leur fait endurer leur soumission à la «volonté�.
L'ascétisme, ou «mortification préméditée de la volonté propre6� constitue l'ultime étape du renoncement.
Nos jugements de valeur trahissent souvent davantage nos capacités et nos carences que les qualités et les défauts des objets sur lesquels ils portent.
La véhémence des expressions qu'il trouve pour dépeindre l'état de soumission à la volonté rév�le l'indignation d'un homme trop longtemps offensé.
«
Le désir 23
l'instar d'une infinité d'autres, présentent le désir comme une menace,
virtuelle ou réelle, à neutraliser.
Rare dissonance dans cet hallali, l'épicu
risme s'efforce d'innocenter le corps
et de substituer à la condamnation des
désirs
une gestion rationnelle qui prévienne leurs excès.
I - Ltl discrimination des désirs
Épicure conçoit, avec toute une tradition grecque, la nature comme un
modèle de mesure.
C'est pourquoi l'homme doit la suivre ou l'imiter autant
qu'il peut.
Or, le corps est une réalité naturelle et, comme tel, nul n'est
autorisé à le couvrir d'opprobre : les désirs qui
émanent de lui sont modérés
et sains.
D'où viennent donc les vertiges qui, semblables à celui d'Alypius,
troublent l'âme au point de faire perdre aux hommes toute mesure ? De
certaines représentations mentales et de certains désirs.
« Ce n'est pas, écrit
Épicure, le ventre qui
est insatiable, comme le dit la foule, mais l'opinion
fausse au sujet
de la réplétion du ventrel.
»Quelles sont ces représentations
erronées, quel
est leur rapport aux désirs nuisibles qu'il faut rejeter ? Tels
sont quelques-uns des problèmes traités par la Lettre à Ménécée.
En celle-ci, Épicure tâche de déterminer, avec la nature et les conditions
du
bonheur, la méthode permettant d'y accéder.
Or, le bonheur se définit
comme absence de douleurs corporelles, ou « aponie », et comme
trànquillité de l'âme, c'est-à-dire comme « ataraxie ».
Il importe donc
d'éviter les troubles de l'âme et, pour ce faire, de connaître leurs causes,
parmi lesquelles Épicure compte de fausses croyances relatives aux dieux
et à la mort.
Contre la superstition populaire, en effet, Épicure affirme que
les dieux ne sont pas à craindre.
Étant des vivants bienheureux et, comme
tels, étrangers à tout souci, ils ne peuvent avoir cure des affaires humaines.
Libre de toute terreur religieuse, Epicure procède alors à l'élucidation
de la
nature de la mort et des effets de la crainte qu'elle suscite en l'âme humaine.
Cette entreprise mérite, parce qu'elle est décisive pour l'instauration d'une
discrimination des désirs,
un examen plus approfondi.
« Le plus terrifiant des maux, écrit Épicure, la mort, n'est rien par
rapport à nous, puisque quand nous sommes, la mort n'est pas là et quand la
mort est là, nous ne sommes plus2.
» Éternelle Arlésienne, la mort est
l'objet introuvable d'une expérience impossible : nul ne peut aller à sa
rencontre.
« Elle n'est donc en rapport ni avec les vivants ni avec les morts,
1.
Sentence vaticane 59.
in: Épicure, Lettres et Maximes, P.U.F., coll.
Épiméthée, 1987, p.
263.
2.
Lettre à Ménécée, in: Lettres et Maximes, p.
219..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- vérité - cours de philo
- Qu’est-ce qui rend le langage humain ? (cours de philo)
- cours philo Descartes contre Freud
- Cours de philo sur la culture
- cours de philo