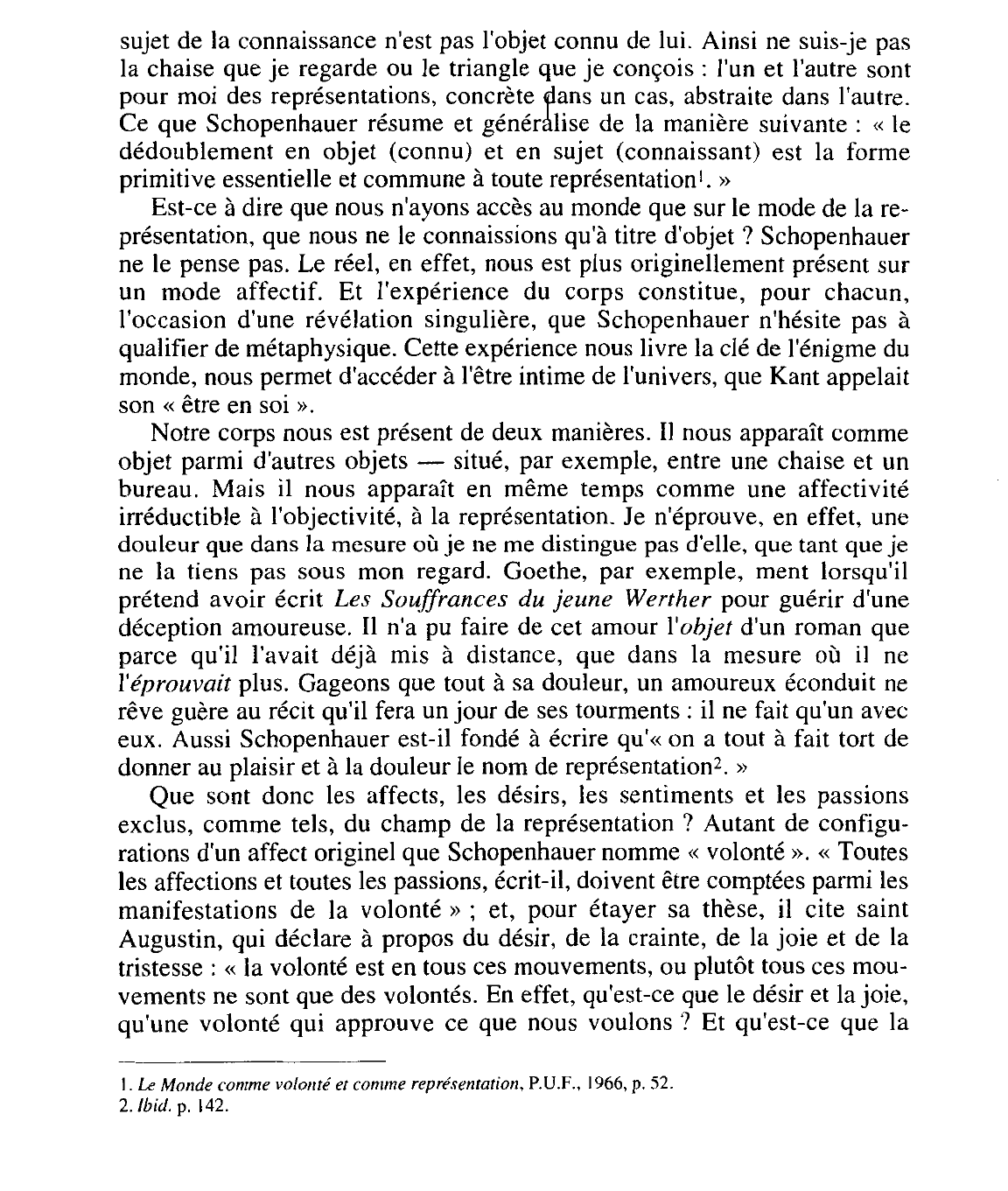L'inconscient (cours de philo - TL)
Publié le 20/03/2015

Extrait du document
En dépit de la formidable avancée réalisée au XVIIe si�cle par Spinoza, la notion d'inconscient psychique n'a été reconnue par les psychologues et n'a fait l'objet d'études systématiques qu'à partir du XIXe si�cle.
Ce préjugé, profondément ancré dans l'esprit des scientifiques, ne pouvait probablement être ébranlé que par une attaque radicale du cartésianisme.
En établissant l'existence d'une volonté inconsciente, en effet, Schopenhauer a ruiné l'idée, ch�re à Descartes, d'une volonté conçue comme manifestation la plus haute de la conscience humaine et de sa dignité.
Le I. Réponses aux secondes objections, définition I, p. 586.
Le réel, en effet, nous est plus originellement présent sur un mode affectif.
Et l'expérience du corps constitue, pour chacun, l'occasion d'une révélation singuli�re, que Schopenhauer n'hésite pas à qualifier de métaphysique.
Cette volonté, parce qu'elle ne m'apparaît clairement que dans ses actes isolés, ne m'est pas connue dans sa totalité.
Aussi resté-je ignorant de ses qualités morales et de sa mani�re de vouloir, qui constituent mon «caract�re� individuel5.
L'intellect c'est-à-dire la conscience, dans le contexte post-kantien qui est celui de Schopenhauer, loin d'être le secrétaire d'une volonté dissimulée et despotique, n'est que son ministre corvéable à merci.
Ainsi la m�re endeuillée, précédemment évoquée, peut refuser la mort de son enfant et remplacer cette vérité par un mensonge qui satisfait sa volonté.
Ce dernier a été amené à découvrir le phénom�ne du refoulement et à poser l'hypoth�se d'un inconscient psychique par un cheminement personnel tout à fait original.
Le refoulement agit contre ces désirs susceptibles de blesser l'orgueil de l'individu, parce qu'incompatibles avec son sentiment de dignité personnelle.
Malheureusement, refouler ne signifie pas neutraliser et le désir refoulé peut se manifester encore sous la forme d'un symptôme névrotique dont le sens, on l'aura deviné, demeure obscur au sujet conscient.
Essais de psychanalyse, Petite Biblioth�que Payot, 1979, p. 128.
C'est pourquoi ils subissent lors du rêve un travestissement qui leur permet de passer le barrage de la censure, reliquat des instances refoulantes agissant pleinement durant la veille.
«
L'inconscient 15
sujet de la connaissance n'est pas l'objet connu de lui.
Ainsi ne suis-je pas
la chaise que
je regarde ou le triangle que je conçois : l'un et l'autre sont
pour moi des représentations, concrète
~ans un cas, abstraite dans l'autre.
Ce que Schopenhauer résume et généralise de la manière suivante : « le
dédoublement en objet (connu) et en sujet (connaissant) est la forme
primitive essentielle et commune à toute représentation'·
»
Est-ce à dire que nous n'ayons accès au monde que sur le mode de la re
présentation, que nous ne le connaissions qu'à titre d'objet ? Schopenhauer
ne le pense pas.
Le réel, en effet, nous est plus originellement présent sur
un
mode affectif.
Et l'expérience du corps constitue, pour chacun,
l'occasion d'une révélation singulière, que Schopenhauer n'hésite pas à
qualifier de métaphysique.
Cette expérience nous livre la clé de l'énigme du
monde, nous permet d'accéder à l'être intime de l'univers, que Kant appelait
son
« être en soi ».
Notre corps nous est présent de deux manières.
Il nous apparaît comme
objet parmi d'autres objets
- situé, par exemple, entre une chaise et un
bureau.
Mais il nous apparaît
en même temps comme une affectivité
irréductible à l'objectivité, à la représentation.
Je n'éprouve, en effet, une
douleur que dans
la mesure où je ne me distingue pas d'elle, que tant que je
ne la tiens pas sous mon regard.
Goethe, par exemple, ment lorsqu'il
prétend avoir écrit
Les Souffrances du jeune Werther pour guérir d'une
déception amoureuse.
Il n'a pu faire de cet amour
l'objet d'un roman que
parce qu'il l'avait
déjà mis à distance, que dans la mesure où il ne
l'éprouvait plus.
Gageons que tout à sa douleur, un amoureux éconduit ne
rêve guère au récit qu'il fera un
jour de ses tourments : il ne fait qu'un avec
eux.
Aussi Schopenhauer est-il fondé à écrire
qu'« on a tout à fait tort de
donner au plaisir et à la douleur le nom de représentation 2
.
»
Que sont donc les affects, les désirs, les sentiments et les passions
exclus,
comme tels, du champ de la représentation ? Autant de configu
rations d'un affect originel que Schopenhauer nomme
« volonté ».
« Toutes
les affections
et toutes les passions, écrit-il, doivent être comptées parmi les
manifestations de
la volonté » ; et, pour étayer sa thèse, il cite saint
Augustin, qui déclare à propos du désir, de la crainte, de la
joie et de la
tristesse :
« la volonté est en tous ces mouvements, ou plutôt tous ces mou
vements ne sont que des volontés.
En effet, qu'est-ce que le désir et la joie,
qu'une volonté qui approuve ce que nous voulons
? Et qu'est-ce que la
1.
Le Monde comme volonté et comme représentation, P.
U.F., 1966, p.
52.
2.
Ibid.
p.
142..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- COURS EC1 PREPA PHILO (art société conscient inconscient)
- Fiche de cours en philo : L'INCONSCIENT .
- Cours de philo: LA CONSCIENCE ET L'INCONSCIENT
- vérité - cours de philo
- Qu’est-ce qui rend le langage humain ? (cours de philo)