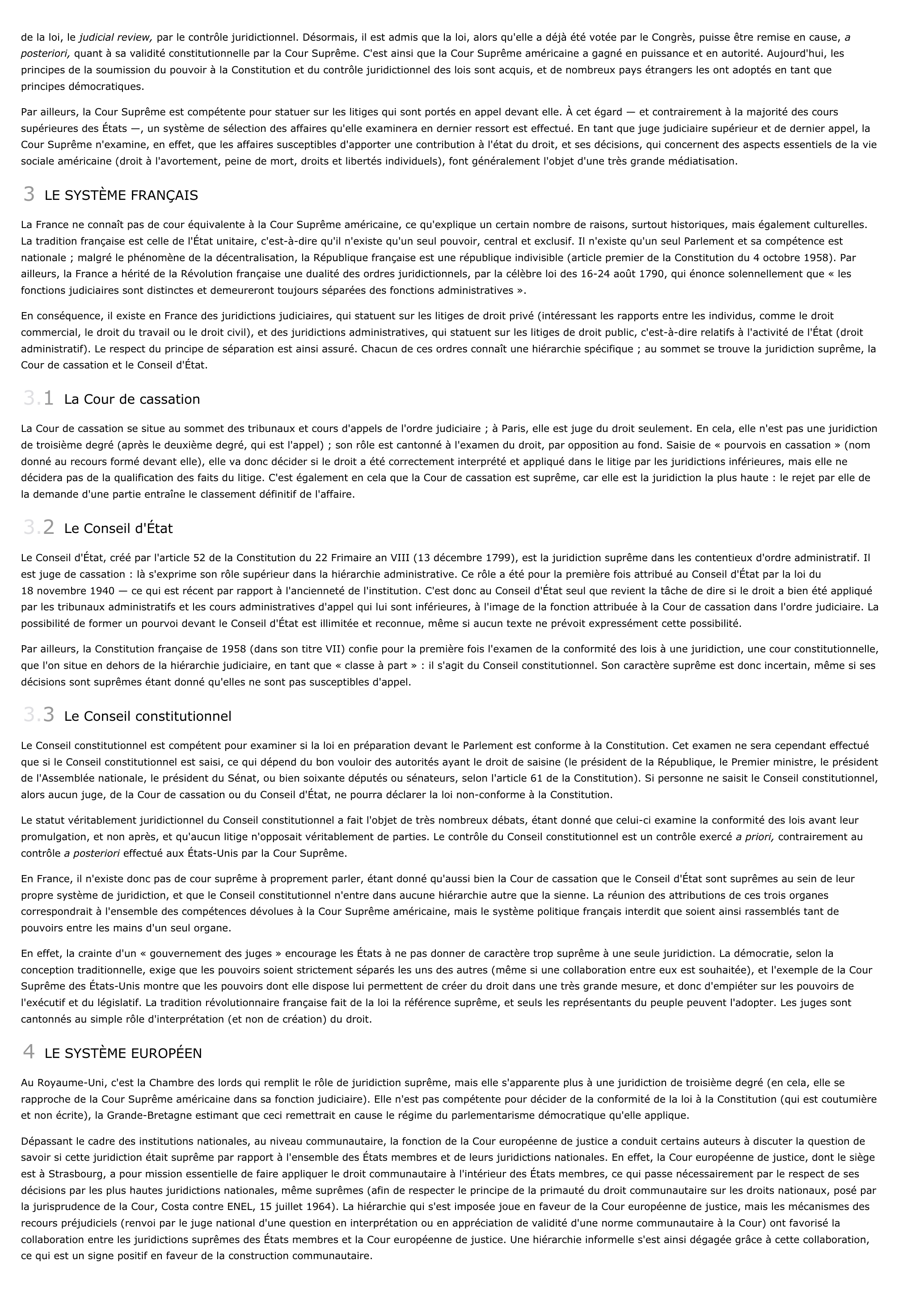cours suprêmes (cours de droit).
Publié le 20/05/2013

Extrait du document


«
de la loi, le judicial review, par le contrôle juridictionnel.
Désormais, il est admis que la loi, alors qu'elle a déjà été votée par le Congrès, puisse être remise en cause, a posteriori, quant à sa validité constitutionnelle par la Cour Suprême.
C'est ainsi que la Cour Suprême américaine a gagné en puissance et en autorité.
Aujourd'hui, les principes de la soumission du pouvoir à la Constitution et du contrôle juridictionnel des lois sont acquis, et de nombreux pays étrangers les ont adoptés en tant queprincipes démocratiques.
Par ailleurs, la Cour Suprême est compétente pour statuer sur les litiges qui sont portés en appel devant elle.
À cet égard — et contrairement à la majorité des courssupérieures des États —, un système de sélection des affaires qu'elle examinera en dernier ressort est effectué.
En tant que juge judiciaire supérieur et de dernier appel, laCour Suprême n'examine, en effet, que les affaires susceptibles d'apporter une contribution à l'état du droit, et ses décisions, qui concernent des aspects essentiels de la viesociale américaine (droit à l'avortement, peine de mort, droits et libertés individuels), font généralement l'objet d'une très grande médiatisation.
3 LE SYSTÈME FRANÇAIS
La France ne connaît pas de cour équivalente à la Cour Suprême américaine, ce qu'explique un certain nombre de raisons, surtout historiques, mais également culturelles.La tradition française est celle de l'État unitaire, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul pouvoir, central et exclusif.
Il n'existe qu'un seul Parlement et sa compétence estnationale ; malgré le phénomène de la décentralisation, la République française est une république indivisible (article premier de la Constitution du 4 octobre 1958).
Parailleurs, la France a hérité de la Révolution française une dualité des ordres juridictionnels, par la célèbre loi des 16-24 août 1790, qui énonce solennellement que « lesfonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ».
En conséquence, il existe en France des juridictions judiciaires, qui statuent sur les litiges de droit privé (intéressant les rapports entre les individus, comme le droitcommercial, le droit du travail ou le droit civil), et des juridictions administratives, qui statuent sur les litiges de droit public, c'est-à-dire relatifs à l'activité de l'État (droitadministratif).
Le respect du principe de séparation est ainsi assuré.
Chacun de ces ordres connaît une hiérarchie spécifique ; au sommet se trouve la juridiction suprême, laCour de cassation et le Conseil d'État.
3.1 La Cour de cassation
La Cour de cassation se situe au sommet des tribunaux et cours d'appels de l'ordre judiciaire ; à Paris, elle est juge du droit seulement.
En cela, elle n'est pas une juridictionde troisième degré (après le deuxième degré, qui est l'appel) ; son rôle est cantonné à l'examen du droit, par opposition au fond.
Saisie de « pourvois en cassation » (nomdonné au recours formé devant elle), elle va donc décider si le droit a été correctement interprété et appliqué dans le litige par les juridictions inférieures, mais elle nedécidera pas de la qualification des faits du litige.
C'est également en cela que la Cour de cassation est suprême, car elle est la juridiction la plus haute : le rejet par elle dela demande d'une partie entraîne le classement définitif de l'affaire.
3.2 Le Conseil d'État
Le Conseil d'État, créé par l'article 52 de la Constitution du 22 Frimaire an VIII (13 décembre 1799), est la juridiction suprême dans les contentieux d'ordre administratif.
Ilest juge de cassation : là s'exprime son rôle supérieur dans la hiérarchie administrative.
Ce rôle a été pour la première fois attribué au Conseil d'État par la loi du18 novembre 1940 — ce qui est récent par rapport à l'ancienneté de l'institution.
C'est donc au Conseil d'État seul que revient la tâche de dire si le droit a bien été appliquépar les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel qui lui sont inférieures, à l'image de la fonction attribuée à la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire.
Lapossibilité de former un pourvoi devant le Conseil d'État est illimitée et reconnue, même si aucun texte ne prévoit expressément cette possibilité.
Par ailleurs, la Constitution française de 1958 (dans son titre VII) confie pour la première fois l'examen de la conformité des lois à une juridiction, une cour constitutionnelle,que l'on situe en dehors de la hiérarchie judiciaire, en tant que « classe à part » : il s'agit du Conseil constitutionnel.
Son caractère suprême est donc incertain, même si sesdécisions sont suprêmes étant donné qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel.
3.3 Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner si la loi en préparation devant le Parlement est conforme à la Constitution.
Cet examen ne sera cependant effectuéque si le Conseil constitutionnel est saisi, ce qui dépend du bon vouloir des autorités ayant le droit de saisine (le président de la République, le Premier ministre, le présidentde l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou bien soixante députés ou sénateurs, selon l'article 61 de la Constitution).
Si personne ne saisit le Conseil constitutionnel,alors aucun juge, de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, ne pourra déclarer la loi non-conforme à la Constitution.
Le statut véritablement juridictionnel du Conseil constitutionnel a fait l'objet de très nombreux débats, étant donné que celui-ci examine la conformité des lois avant leurpromulgation, et non après, et qu'aucun litige n'opposait véritablement de parties.
Le contrôle du Conseil constitutionnel est un contrôle exercé a priori, contrairement au contrôle a posteriori effectué aux États-Unis par la Cour Suprême.
En France, il n'existe donc pas de cour suprême à proprement parler, étant donné qu'aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'État sont suprêmes au sein de leurpropre système de juridiction, et que le Conseil constitutionnel n'entre dans aucune hiérarchie autre que la sienne.
La réunion des attributions de ces trois organescorrespondrait à l'ensemble des compétences dévolues à la Cour Suprême américaine, mais le système politique français interdit que soient ainsi rassemblés tant depouvoirs entre les mains d'un seul organe.
En effet, la crainte d'un « gouvernement des juges » encourage les États à ne pas donner de caractère trop suprême à une seule juridiction.
La démocratie, selon laconception traditionnelle, exige que les pouvoirs soient strictement séparés les uns des autres (même si une collaboration entre eux est souhaitée), et l'exemple de la CourSuprême des États-Unis montre que les pouvoirs dont elle dispose lui permettent de créer du droit dans une très grande mesure, et donc d'empiéter sur les pouvoirs del'exécutif et du législatif.
La tradition révolutionnaire française fait de la loi la référence suprême, et seuls les représentants du peuple peuvent l'adopter.
Les juges sontcantonnés au simple rôle d'interprétation (et non de création) du droit.
4 LE SYSTÈME EUROPÉEN
Au Royaume-Uni, c'est la Chambre des lords qui remplit le rôle de juridiction suprême, mais elle s'apparente plus à une juridiction de troisième degré (en cela, elle serapproche de la Cour Suprême américaine dans sa fonction judiciaire).
Elle n'est pas compétente pour décider de la conformité de la loi à la Constitution (qui est coutumièreet non écrite), la Grande-Bretagne estimant que ceci remettrait en cause le régime du parlementarisme démocratique qu'elle applique.
Dépassant le cadre des institutions nationales, au niveau communautaire, la fonction de la Cour européenne de justice a conduit certains auteurs à discuter la question desavoir si cette juridiction était suprême par rapport à l'ensemble des États membres et de leurs juridictions nationales.
En effet, la Cour européenne de justice, dont le siègeest à Strasbourg, a pour mission essentielle de faire appliquer le droit communautaire à l'intérieur des États membres, ce qui passe nécessairement par le respect de sesdécisions par les plus hautes juridictions nationales, même suprêmes (afin de respecter le principe de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux, posé parla jurisprudence de la Cour, Costa contre ENEL, 15 juillet 1964).
La hiérarchie qui s'est imposée joue en faveur de la Cour européenne de justice, mais les mécanismes desrecours préjudiciels (renvoi par le juge national d'une question en interprétation ou en appréciation de validité d'une norme communautaire à la Cour) ont favorisé lacollaboration entre les juridictions suprêmes des États membres et la Cour européenne de justice.
Une hiérarchie informelle s'est ainsi dégagée grâce à cette collaboration,ce qui est un signe positif en faveur de la construction communautaire..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DROIT ADMINISTRATIF - cours complet
- justice et droit (cours)
- le droit commercial (cours complet)
- cours S2 L1 droit de la famille
- Le droit cours amphi