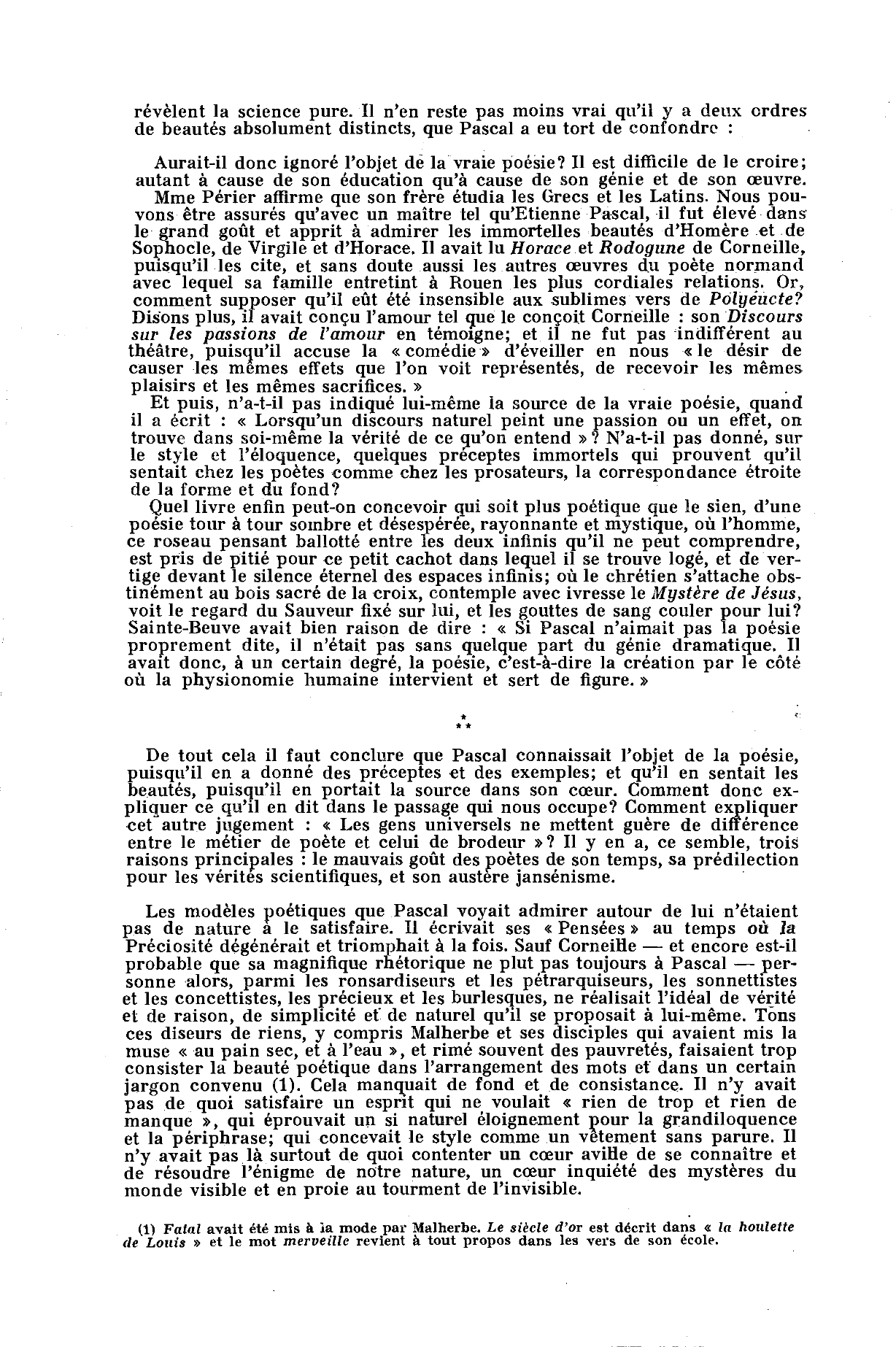Cette opinion de Pascal sur la poésie est-elle juste ?
Publié le 18/02/2012

Extrait du document

« Comme on dit beauté poétique, on devrait aussi dire beauté géométrique et beauté médicinale. Cependant on ne le dit point; et la raison en est qu'on sait bien quel est l'objet de la géométrie et qu'il consiste en preuves; et quel est l'objet de la médecine et qu'il consiste en la guérison; mais on ne sait pas en quoi consiste Pagrémetit qui est l'objet de la poésie. On ne sait ce que c'est que ce modèle naturel qu'il faut imiter et, faute de cette connaissance, on a inventé certains termes bizarres : Siècle d'or, merveille de nos jours, fatal, etc..., on appelle ce jargon beauté poétique... « Cette opinion de Pascal sur la poésie est-elle juste?
Comment expliquez-vous que Pascal ait pu la formuler ?
Dans ce passage, et dans quelques autres des Pensées, Pascal s'est montré bien sévère pour la poésie. Il soutient, en somme, qu'on ne sait pas en quoi consiste l'agrément qui est l'objet de la poésie, c'est-à-dire que la poésie n'a pas d'objet ou de fond; et que, faute de connaître « ce modèle naturel « qu'il faut imiter, on a fait consister la poésie dans l'artifice des mots....

«
revelent la science pure.
B.
n'en reste pas moms vrai qu'il y a deux crdres
de beautes absolument distincts, que Pascal a eu tort de confondre :
Aurait-il donc ignore l'objet de la vraie poesie? Il est difficile de le croire;
autant a cause de son education qu'a cause de son genie et de son oeuvre.
Mme Perier affirme que son frere etudia les Grecs et les Latins.
Nous pou-
vons etre assures qu'avec un maitre tel qu'Etienne Pascal, il fut eleve dans
le grand gout et apprit a admirer les immortelles beautes d'Homere et de
Sophocle, de Virgile et d'Horace.
Il avait lu Horace et Rodogune de Corneille, puisqu'il les cite, et sans doute aussi les autres oeuvres du poke normand
avec lequel sa famille entretint a Rouen les plus cordiales relations.
Or,
comment supposer qu'il out ate insensible aux sublimes vers de Polyeucte?
DiSons plus, II avait concu l'amour tel que le concoit Corneille : son Discours
sur les passions de l'amour en temoigne; et il ne fut pas indifferent au
theatre, puisqu'il accuse la « comedie »d'eveiller en nous « le desir de
causer les memes effets que l'on voit representes, de recevoir les memes
plaisirs et les memes sacrifices.
» Et puis, n'a-t-il pas indique lui-meme to source de la vraie poesie, quand
il a ecrit :« Lorsqu'un discours naturel peint une passion ou un effet, on
trouve dans soi-meme la verite de ce 9u'on entend »? N'a-t-il pas donne, sur
le style et l'eloquence, quelques preceptes immortels qui prouvent qu'il
sentait chez les pokes comme chez les prosateurs, la correspondance &mite
de la forme et du fond?
Quel livre enfin peut-on concevoir qui soft plus poetique que le sien, d'une
poesie tour a tour sombre et desesperee, rayonnante et mystique, on l'homme,
ce roseau pensant ballotte entre les deux infinis qu'il ne peut comprendre,
est psis de pitie pour ce petit cachot dans lequel il se trouve loge, et de ver-
tige devant le silence kernel des espaces infinis; oil le chretien s'attache obs-
tinement an boil sacra de la croix, contemple avec ivresse le Mystere de Jesus,
voit le regard du Sauveur fixe sur lui, et les gouttes de sang couler pour lui?
Sainte-Beuve avait bien raison de dire :« Si Pascal n'aimait pas la poesie
proprement dite, it n'etait pas sans quelque part du genie dramatique.
Il
avait donc, a un certain degre, la poesie, c'est-a-dire la creation par le cote
on la physionomie humaine intervient et sert de figure.
»
De tout cela it faut conclure que Pascal connaissait l'objet de la poesie,
puisqu'il en a donne des preceptes et des exemples; et qu'il en sentait les
beautes, puisqu'il en portait la source dans son cceur.
Comment done ex-
pliquer ce qu'il en dit dans le passage qui nous occupe? Comment expliquer
cet autre jugement : q Les gens universels ne mettent guere de difference
entre le métier de poke et celui de brodeur »? Il y en a, ce semble, trois
raisons principales : le mauvais gout des poetes de son temps, sa predilection
pour les verites scientifiques, et son austere jansenisme.
Les modeles poetiques que Pascal voyait admirer autour de lui n'etaient
pas de nature a le satisfaire.
Il ecrivait ses « Pensees » au temps of/ Ia
Preciosite degenerait et triomphait a la fois.
Sauf Corneille - et encore est-il
probable que sa magnifique rhetorique ne plut pas toujours a Pascal - per-
sonne alors, parmi les ronsardiseurs et les petrarquiseurs, les sonnettistes
et les concettistes, les precieux et les burlesques, ne realisait l'ideal de verite
et de raison, de simplicite el de natures qu'il se proposait a lui-meme.
Tons ces diseurs de riens, y compris Malherbe et ses disciples qui avaient mis la
muse « au pain sec, et a l'eau », et rime souvent des pauvretes, faisaient trop
consister la beaute poetique dans l'arrangement des mots et dans un certain
jargon convenu (1).
Cela manquait de fond et de consistance.
Il n'y avait
pas de quoi satisfaire un esprit qui ne voulait « rien de trop et rien de
manque », qui eprouvait un si naturel eloignement pour la grandiloquence
et la periphrase; qui concevait le style comme un vetement sans parure.
Il
n'y avait pas la surtout de quoi contenter un cceur avilie de se connaitre et
de resoudre l'enigme de notre nature, un cceur inquiete des mysteres du
monde visible et en proie an tourment de l'invisible.
(1) Fatal avait ate mis a is mode par Malherbe.
Le siecle d'or est (Merit dans 1 la houlette
de Louis » et le mot merueille revient a tout propos dans les vers de son ecole.
révèlent la science pure. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a deux ordres
de beautés absolument distincts, que Pascal a eu tort de confondre :
Aurait-il donc ignoré l'objet de la vraie poésie? Il est difficile de le croire;
autant à cause de son éducation qu'à cause de son génie et de son œuvre.
Mme Périer affirme que son frère étudia les Grecs et les Latins. Nous pou
vons être assurés qu'avec un maître tel qu'Etienne Pascal, il fut élevé dans
le grand goût et apprit à admirer les immortelles beautés d'Homère et de Sophocle, de Virgile et d'Horace. Il avait lu Horace et Rodogune de Corneille, puisqu'il les cite, et sans doute aussi les autres œuvres du poète normand
avec lequel sa famille entretint à Rouen les plus cordiales relations. Or, comment supposer qu'il eût été insensible aux sublimes vers de Pôlyéucte? Disons plus, il avait conçu l'amour tel que le conçoit Corneille : son Discours sur les passions de Vamour en témoigne; et il ne fut pas indifférent au
théâtre, puisqu'il accuse la « comédie » d'éveiller en nous « le désir de causer les mêmes effets que l'on voit représentés, de recevoir les mêmes plaisirs et les mêmes sacrifices. » Et puis, n'a-t-il pas indiqué lui-même la source de la vraie poésie, quand il a écrit : « Lorsqu'un discours naturel peint une passion ou un effet, on trouve dans soi-même la vérité de ce qu'on entend » ? N'a-t-il pas donné, sur le style et l'éloquence, quelques préceptes immortels qui prouvent qu'il
sentait chez les poètes comme chez les prosateurs, la correspondance étroite de la forme et du fond? Quel livre enfin peut-on concevoir qui soit plus poétique que le sien, d'une poésie tour à tour sombre et désespérée, rayonnante et mystique, où l'homme,
ce roseau pensant ballotté entre les deux infinis qu'il ne peut comprendre,
est pris de pitié pour ce petit cachot dans lequel il se trouve logé, et de ver
tige devant le silence éternel des espaces infinis; où le chrétien s'attache obs tinément au bois sacré de la croix, contemple avec ivresse le Mystère de Jésus, voit le regard du Sauveur fixé sur lui, et les gouttes de sang couler pour lui?
Sainte-Beuve avait bien raison de dire : « Si Pascal n'aimait pas la poésie proprement dite, il n'était pas sans quelque part du génie dramatique. Il avait donc, à un certain degré, la poésie, c'est-à-dire la création par le côté
où la physionomie humaine intervient et sert de figure. »
De tout cela il faut conclure que Pascal connaissait l'objet de la poésie, puisqu'il en a donné des préceptes et des exemples; et qu'il en sentait les
beautés, puisqu'il en portait la source dans son cœur. Comment donc ex pliquer ce qu'il en dit dans le passage qui nous occupe? Comment expliquer
cet autre jugement : « Les gens universels ne mettent guère de différence entre le métier de poète et celui de brodeur » ? Il y en a, ce semble, trois raisons principales : le mauvais goût des poètes de son temps, sa prédilection pour les vérités scientifiques, et son austère jansénisme.
Les modèles poétiques que Pascal voyait admirer autour de lui n'étaient pas de nature a le satisfaire. Il écrivait ses « Pensées » au temps où la
Préciosité dégénérait et triomphait à la fois.
Sauf Corneille — et encore est-il
probable que sa magnifique rhétorique ne plut pas toujours à Pascal — per
sonne alors, parmi les ronsardiseurs et les pétrarquiseurs, les sonnettistes
et les concettistes, les précieux et les burlesques, ne réalisait l'idéal de vérité et de raison, de simplicité et* de naturel qu'il se proposait à lui-même. Tous
ces diseurs de riens, y compris Malherbe et ses disciples qui avaient mis la muse « au pain sec, et à l'eau », et rimé souvent des pauvretés, faisaient trop
consister la beauté poétique dans l'arrangement des mots et dans un certain
jargon convenu (1). Cela manquait de fond et de consistance. Il n'y avait
pas de quoi satisfaire un esprit qui ne voulait « rien de trop et rien de manque », qui éprouvait un si naturel éloignement pour la grandiloquence
et la périphrase; qui concevait le style comme un vêtement sans parure. Il n'y avait pas là surtout de quoi contenter un cœur avide de se connaître et de résoudre l'énigme de notre nature, un cœur inquiété des mystères du monde visible et en proie au tourment de l'invisible.
(1) Fatal avait
été mis à la mode par Malherbe. Le siècle d'or est décrit dans « la houlette
de Louis » et le mot merveille revient à tout propos dans les vers de son école..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Discuter cette opinion de Jules Lemaître : « Si, parmi les hommes morts depuis deux siècles, vous cherchez celui qui, revenu parmi nous, aurait le moins l'air d'un étranger, celui qui nous comprendrait le plus vite », ce ne serait ni Pascal, ni Bossuet, ni même Racine, ni même peut-être La Bruyère; « au bout du compte, c'est Molière; ce n'est aucun mille que lui, n'en doutez pas ». ?
- Vous expliquerez cette opinion selon laquelle la poésie peut parler de tout (y compris d'elle même) puisque ce qui la définit est un usage particulier du langage.
- On connaît le mot de Pascal sur Montaigne : « Le sot projet qu'il a eu de se peindre! » auquel Voltaire réplique: « Le charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement, car, en se peignant, il a peint la nature humaine.>) Comment expliquez-vous l'opposition radicale entre ces deux jugements ? Quelle est votre opinion personnelle ?
- « L'art par excellence, celui qui surpasse tous les autres, parce qu'il est incomparablement le plus ex¬pressif, c'est la poésie. » Donnez votre opinion sur cette définition de Victor Cousin, en vous appuyant sur des exemples.
- Dans une conférence donnée en 1947, et qui ne manqua pas de provoquer un beau scandale, l'écrivain polonais Gombrowicz affirmait : «... J'avoue que les vers me déplaisent et même qu'ils m'ennuient un peu. Non que je sois ignorant des choses de l'art et que la sensibilité poétique me fasse défaut. Lorsque la poésie apparaît mêlée à d'autres éléments, plus crus, plus prosaïques, comme dans les drames de Shakespeare, les livres de Dostoïevski, de Pascal, ou tout simplement dans le crépus