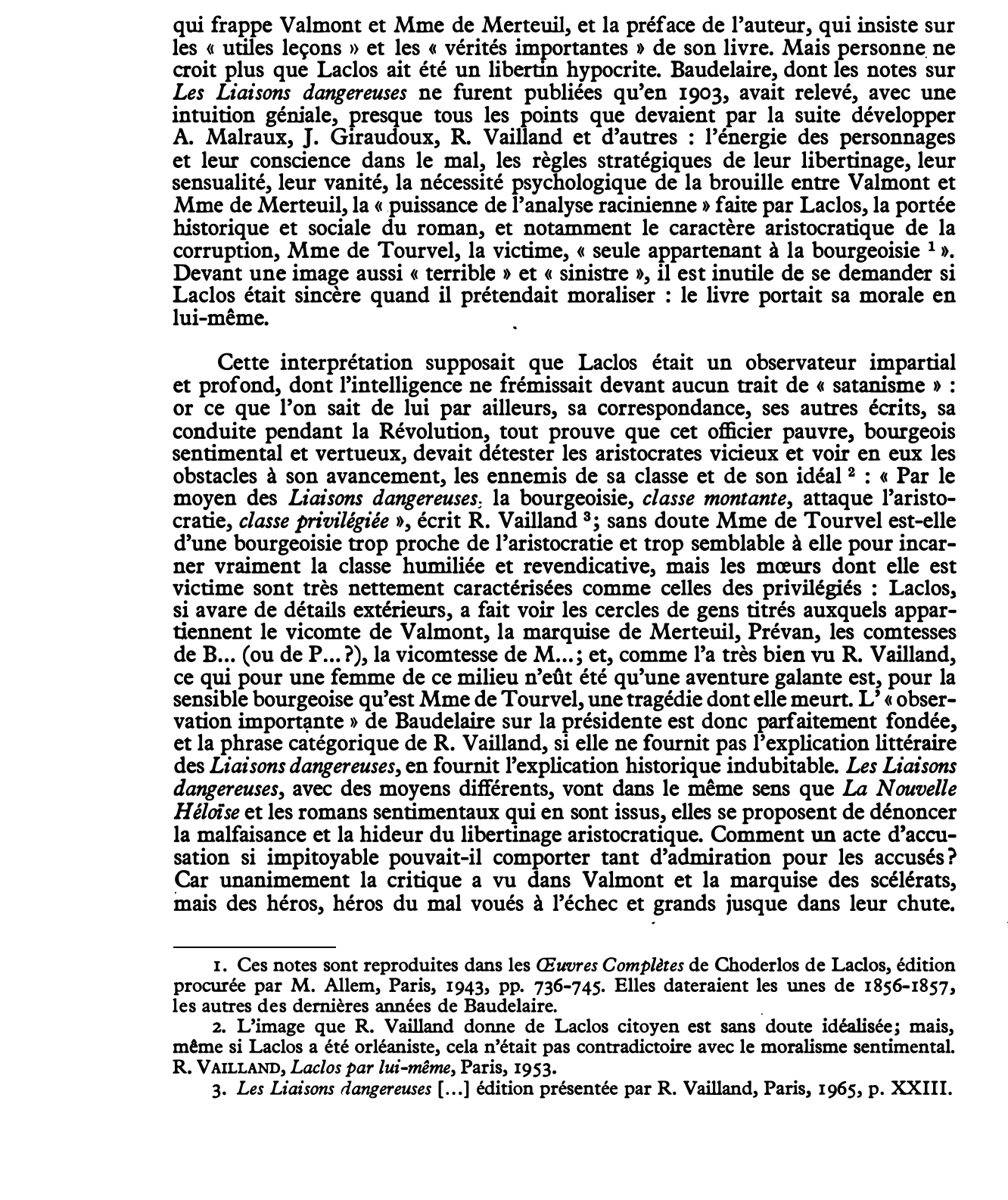Choderlos de Laclos - Histoire de la littérature
Publié le 20/01/2018

Extrait du document

dès que ses principes ne s'appliquent plus à une situation qu'il n'attendait pas, il « reste court comme un Écolier » : « Vous n'avez pas le génie de votre état; vous n'en savez que ce que vous en avez appris, et vous n'inventez rien » (Lettre CVI); un libertin par système ne présente aucun danger pour une femme avertie : « Qu'il est commode d'avoir affaire à vous autres gens à principes! [ ... ] votre marche réglée se devine si facilement! » (Lettre LXXXV). Il avoue lui-même son embarras et essaie d'un procédé ridiculement livresque pour en sortir .: « Depuis huit jours, je repasse inutilement tous les moyens connus, tous ceux des Romans et de mes Mémoires secrets; je n'en trouve aucun qui convienne, ni aux circonstances de l'aventure, ni au caractère de l'héroïne » (Lettre CX). La première figure du ballet libertin, selon R. Vailland, serait « le choix » de la future victime : V almont en fait n'en a choisi aucune; la vicomtesse de M ... est une ancienne maîtresse, à laquelle il garde le secret, et l'aventure qui la remet en sa présence était machinée, sans qu'il le sût, par Mme de Merteuil; Émilie n'est pas une feme à séduire; Cécile lui est fournie par l'occasion, elle tombe dans un piège que la marquise encore avait préparé pour le bénéfice d'un autre; quant à la présidente, il fait précisément un mauvais choix du point de vue même du libertinage en s'attardant auprès d'elle au lieu d'aller s'occuper de Cécile: c'est ce que lui reproche la marquise (Lettre II et Lettre V). Il rétorque qu'au contraire Cécile serait une conquête sans difficulté ( « vingt autres peuvent y réussir comme moi » ), tandis que séduire la présidente est une glorieuse entreprise : « Voilà ce que j'attaque, voilà l'ennemi digne de moi ». Mais les raisons qu'il a de livrer ce combat ne sont pas de pur libertinage : il est en proie à un sentiment qu'il ne peut commander, « je n'ai plus qu'une idée; j'y pense le jour, j'en rêve la nuit. J'ai bien besoin d'avoir cette femme, pour me sauver du ridicule d'en être amoureux » (Lettre IV). Il ne faut pas en conclure trop vite que pour une fois ce séducteur est pris : il voit très bien que Mme de Tourvel n'est pas semblable aux femmes qu'il attaque d'ordinaire, mais d'une part il espère qu'elle aura quand même un peu de leur faiblesse (ni lui ni Mme de Merteuil ne sont en fait capables d'imaginer qu'il existe d'autres femmes que celles qu'ils ont cataloguées) 1, d'autre part le désir de jouissance qui l'entraîne vers elle, désir ardent et naturel, immoral sans doute, mais non vicieux, est exactement celui qui l'anime quand il s'adresse à des femmes faciles; il est trop avide de le satisfaire pour souhaiter la perte et le déshonneur des femmes qu'il conquiert; s'il a toujours préféré celles qui n'ont pas de vertu, c'est qu'il a peur de souffrir d'un désir frustré : « Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal ! nous ne serions auprès d'elles que de timides esclaves » (Lettre IV); son âme est délicatement épicurienne, et les « délicieuses jouissances » qu'il éprouve à observer les émotions d'une « femme céleste », l' « ivresse complète » qu'il partage avec elle dans le plaisir (Lettre XCVI et Lettre CXXV), il les reconnaît plus encore qu'il ne les découvre, car il les regrettait dans toutes ses amours : « dans nos arrangements, aussi froids que faciles, ce que nous appelons bonheur est à peine un plaisir. Vous le dirai-je? j e croyais mon cœur flétri, et ne me trouvant plus que des sens, j e me plaignais d'une vieillesse prématurée. Madame de Tourvel m'a rendu les charmantes illusions de la jeunesse » (Lettre VI). Les autres femmes ne demandent que le plaisir des
qui frappe Valmont et Mme de Merteuil, et la préface de l'auteur, qui insiste sur les « utiles leçons >> et les « vérités importantes » de son livre. Mais personne ne croit plus que Laclos ait été un libertin hypocrite. Baudelaire, dont les notes sur Les Liaisons dangereuses ne furent publiées qu'en 1903, avait relevé, avec une intuition géniale, presque tous les points que devaient par la suite développer A. Malraux, J. Giraudoux, R. Vailland et d'autres : l'énergie des personnages et leur conscience dans le mal, les règles stratégiques de leur libertinage, leur sensualité, leur vanité, la nécessité psychologique de la brouille entre Valmont et Mme de Merteuil, la << puissance de l'analyse racinienne >> faite par Laclos, la portée historique et sociale du roman, et notament le caractère aristocratique de la corruption, Mme de Tourvel, la victime, << seule appartenant à la bourgeoisie 1 ». Devant une image aussi << terrible » et << sinistre », il est inutile de se demander si Laclos était sincère quand il prétendait moraliser : le livre portait sa morale en lui-même.
Cette interprétation supposait que Laclos était un observateur impartial et profond, dont l'intelligence ne frémissait devant aucun trait de « satanisme » : or ce que l'on sait de lui par ailleurs, sa correspondance, ses autres écrits, sa conduite pendant la Révolution, tout prouve que cet officier pauvre, bourgeois sentimental et vertueux, devait détester les aristocrates vicieux et voir en eux les obstacles à son avancement, les ennemis de sa classe et de son idéal ` : « Par le moyen des Liaisons dangereuses, la bourgeoisie, classe montante, attaque l'aristocratie, classe privilégiée », écrit R. Vailland 3; sans doute Mme de Tourvel est-elle d'une bourgeoisie trop proche de l'aristocratie et trop semblable à elle pour incarner vraiment la classe humiliée et revendicative, mais les mœurs dont elle est victime sont très nettement caractérisées comme celles des privilégiés : Laclos, si avare de détails extérieurs, a fait voir les cercles de gens titrés auxquels appartiennent le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, Prévan, les comtesses de B ... (ou de P ... ?), la vicomtesse de M ... ; et, comme l'a très bien vu R. Vailland, ce qui pour une femme de ce milieu n'eût été qu'une aventure galante est, pour la sensible bourgeoise qu'est Mme de Tourvel, une tragédie dont elle meurt. L' « observation import~nte >> de Baudelaire sur la présidente est donc parfaitement fondée, et la phrase catégorique de R. Vailland, si elle ne fournit pas l'explication littéraire des Liaisons dangereuses, en fournit l'explication historique indubitable. Les Liaisons dangereuses, avec des moyens différents, vont dans le même sens que La Nouvelle Héloïse et les romans sentimentaux qui en sont issus, elles se proposent de dénoncer la malfaisance et la hideur du libertinage aristocratique. Comment un acte d'accusation si impitoyable pouvait-il comporter tant d'admiration pour les accusés ? Car unanimement la critique a vu dans Valmont et la marquise des scélérats, mais des héros, héros du mal voués à l'échec et grands jusque dans leur chute.

«
qui frappe Valmont et Mme de Merteuil, et la préface de l'auteu r, qui insiste sur
les « utiles leçons >> et les « vérités importantes » de son livre.
Mais personne ne
croit plus que Laclos ait été un libertin hypocrite.
Baudelaire, dont les notes sur
Les Liaisons dangereuses ne furent publiées qu'en 1903, avait relevé, avec une
intuition géniale, presque tous les points que devaient par la suite développer
A.
Malraux, J.
Giraudoux, R.
Vailland et d'autres : l'énergie des personnages
et leur conscience dans le mal, les règles stratégiques de leur libertinage, leur
sensualité, leur vanité, la nécessité psychologique de la brouille entre Valmont et
Mme de Merteuil, la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Laclos, Pierre Choderlos de - littérature.
- Texte 4 : Les Liaisons dangereuses (1782), Choderlos de Laclos (1741- 1803) - Lettre 81
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours