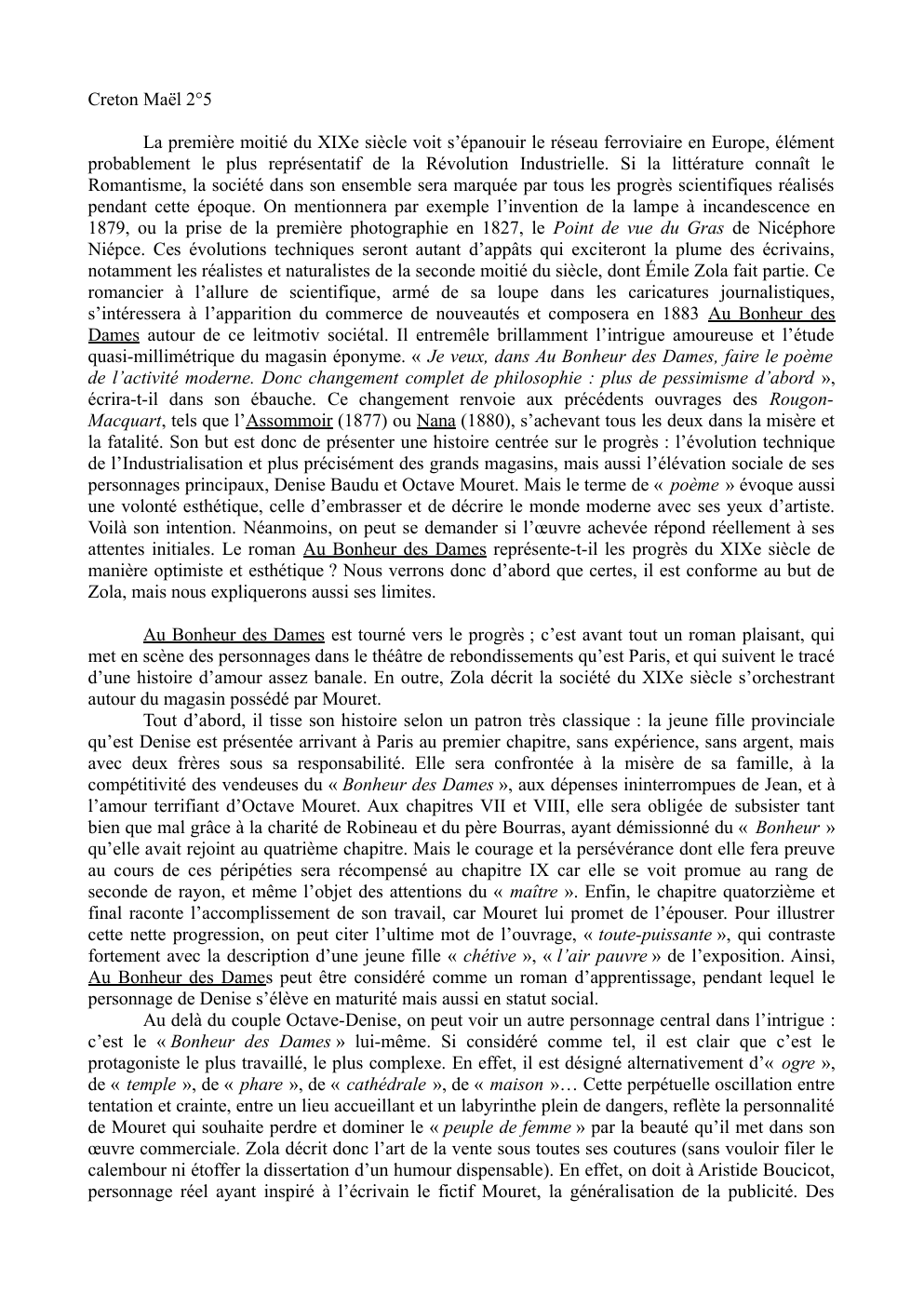Dissertation sur Au bonheur des dames
Publié le 05/11/2023
Extrait du document
«
La première moitié du XIXe siècle voit s’épanouir le réseau ferroviaire en Europe, élément
probablement le plus représentatif de la Révolution Industrielle.
Si la littérature connaît le
Romantisme, la société dans son ensemble sera marquée par tous les progrès scientifiques réalisés
pendant cette époque.
On mentionnera par exemple l’invention de la lampe à incandescence en
1879, ou la prise de la première photographie en 1827, le Point de vue du Gras de Nicéphore
Niépce.
Ces évolutions techniques seront autant d’appâts qui exciteront la plume des écrivains,
notamment les réalistes et naturalistes de la seconde moitié du siècle, dont Émile Zola fait partie.
Ce
romancier à l’allure de scientifique, armé de sa loupe dans les caricatures journalistiques,
s’intéressera à l’apparition du commerce de nouveautés et composera en 1883 Au Bonheur des
Dames autour de ce leitmotiv sociétal.
Il entremêle brillamment l’intrigue amoureuse et l’étude
quasi-millimétrique du magasin éponyme.
« Je veux, dans Au Bonheur des Dames, faire le poème
de l’activité moderne.
Donc changement complet de philosophie : plus de pessimisme d’abord »,
écrira-t-il dans son ébauche.
Ce changement renvoie aux précédents ouvrages des RougonMacquart, tels que l’Assommoir (1877) ou Nana (1880), s’achevant tous les deux dans la misère et
la fatalité.
Son but est donc de présenter une histoire centrée sur le progrès : l’évolution technique
de l’Industrialisation et plus précisément des grands magasins, mais aussi l’élévation sociale de ses
personnages principaux, Denise Baudu et Octave Mouret.
Mais le terme de « poème » évoque aussi
une volonté esthétique, celle d’embrasser et de décrire le monde moderne avec ses yeux d’artiste.
Voilà son intention.
Néanmoins, on peut se demander si l’œuvre achevée répond réellement à ses
attentes initiales.
Le roman Au Bonheur des Dames représente-t-il les progrès du XIXe siècle de
manière optimiste et esthétique ? Nous verrons donc d’abord que certes, il est conforme au but de
Zola, mais nous expliquerons aussi ses limites.
Au Bonheur des Dames est tourné vers le progrès ; c’est avant tout un roman plaisant, qui
met en scène des personnages dans le théâtre de rebondissements qu’est Paris, et qui suivent le tracé
d’une histoire d’amour assez banale.
En outre, Zola décrit la société du XIXe siècle s’orchestrant
autour du magasin possédé par Mouret.
Tout d’abord, il tisse son histoire selon un patron très classique : la jeune fille provinciale
qu’est Denise est présentée arrivant à Paris au premier chapitre, sans expérience, sans argent, mais
avec deux frères sous sa responsabilité.
Elle sera confrontée à la misère de sa famille, à la
compétitivité des vendeuses du « Bonheur des Dames », aux dépenses ininterrompues de Jean, et à
l’amour terrifiant d’Octave Mouret.
Aux chapitres VII et VIII, elle sera obligée de subsister tant
bien que mal grâce à la charité de Robineau et du père Bourras, ayant démissionné du « Bonheur »
qu’elle avait rejoint au quatrième chapitre.
Mais le courage et la persévérance dont elle fera preuve
au cours de ces péripéties sera récompensé au chapitre IX car elle se voit promue au rang de
seconde de rayon, et même l’objet des attentions du « maître ».
Enfin, le chapitre quatorzième et
final raconte l’accomplissement de son travail, car Mouret lui promet de l’épouser.
Pour illustrer
cette nette progression, on peut citer l’ultime mot de l’ouvrage, « toute-puissante », qui contraste
fortement avec la description d’une jeune fille « chétive », « l’air pauvre » de l’exposition.
Ainsi,
Au Bonheur des Dames peut être considéré comme un roman d’apprentissage, pendant lequel le
personnage de Denise s’élève en maturité mais aussi en statut social.
Au delà du couple Octave-Denise, on peut voir un autre personnage central dans l’intrigue :
c’est le « Bonheur des Dames » lui-même.
Si considéré comme tel, il est clair que c’est le
protagoniste le plus travaillé, le plus complexe.
En effet, il est désigné alternativement d’« ogre »,
de « temple », de « phare », de « cathédrale », de « maison »… Cette perpétuelle oscillation entre
tentation et crainte, entre un lieu accueillant et un labyrinthe plein de dangers, reflète la personnalité
de Mouret qui souhaite perdre et dominer le « peuple de femme » par la beauté qu’il met dans son
œuvre commerciale.
Zola décrit donc l’art de la vente sous toutes ses coutures (sans vouloir filer le
calembour ni étoffer la dissertation d’un humour dispensable).
En effet, on doit à Aristide Boucicot,
personnage réel ayant inspiré à l’écrivain le fictif Mouret, la généralisation de la publicité.
Des
ballons où est inscrit le nom du magasin sont offerts aux clients à leur sortie.
Le système de rendus
est aussi inventé : « prenez toujours, madame, vous nous rendrez l’article s’il cesse de vous
plaire », déclame le vendeur hypocrite qui souhaite toucher ses tant pour cent en ruinant les
acheteuses.
Et Mouret installe son statut de « maître » grâce à une compétitivité sanguinaire entre
ses subordonnés.
Chacun contrôle les activités des autres vendeurs pour ne pas qu’ils s’approprient
des pourcentages sur leurs ventes.
Pour finir, on peut mettre en évidence la progression frappante du
magasin grâce aux chiffres que Zola mentionne aux chapitres IV, IX et XIV, ceux des grandes
ventes.
Le nombre de rayons passe de 19 à 50 en passant par 39, et le chiffre d’affaires s’élève de
87 mille à 587 mille, jusqu’au million sur lequel la quatrième de couverture tombe.
On voit donc,
tout au long du roman, le « Bonheur des Dames » s’étendre dans la capitale, et offrir ses devantures
chatoyantes au public.
C’est l’objet qu’Émile Zola a choisi d’utiliser pour faire son « poème de
l’activité moderne ».
Néanmoins, ce portait – car il nous est difficile d’appeler les galeries palpitantes de foule du
magasin une nature morte – est mis en valeur par un décor tout aussi somptueux.
Ce décor, c’est
Paris ! Zola raconte le changement que connaît cette ville suite aux travaux Haussmanniens
(l’architecte est dans le roman représenté par le baron Hartmann).
De sa plume si semblable aux
pinceaux des impressionnistes, il décrit les nombreux matériaux utilisés par les architectes
modernes : verre, fer, acier remplacent la pierre et forment la « cathédrale du commerce » qu’est le
« Bonheur des Dames ».
En outre, grâce à la métaphore, les bâtiments sont transfigurés et prennent
vie.
Il compare par exemple le magasin à une « machine », symbole de la révolution industrielle,
mais aussi à un organisme vivant capable de digérer les clientes.
Enfin, « l’activité moderne » est
illustrée par la vie qu’il insuffle dans sa description.
Les notions d’« activité » et de « poème »
évoquent le mouvement, le rythme : Zola se sert à de multiples reprises de la comparaison avec
l’eau pour vitaliser son écriture.
Ainsi, autant par son style que par les évènements qu’il retranscrit,
l’écrivain fait un tableau de l’industrialisation.
Au Bonheur des Dames développe donc l’histoire d’amour plaisante vécue par Denise et
Octave, tout en peignant l’atmosphère de progrès qui habite la seconde moitié du XIXe siècle.
Cette
évolution parallèle permet d’allier les sentiments humains avec l’expérience sociétale, ce qui
constitue le but du roman naturaliste.
En revanche, l’auteur représente des aspects plus sombres de la vie parisienne, et se sert de
l’extinction du petit commerce pour mettre en valeur les vastes magasins de nouveautés : cela
semble contradictoire avec son intention de rompre avec le pessimisme.
En premier lieu, le concept du déclin occupe une place non négligeable dans Au Bonheur
des Dames et vient concurrencer l’idée de progrès développée précédemment.
Mais est-il
réellement possible que l’un existe....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DISSERTATION : AU BONHEUR DES DAMES: Comment Zola applique-t-il le naturalisme dans une œuvre romanesque ?
- AU BONHEUR DES DAMES
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames
- sujet de réflexion au bonheur des dames
- dissertation lucidité et bonheur