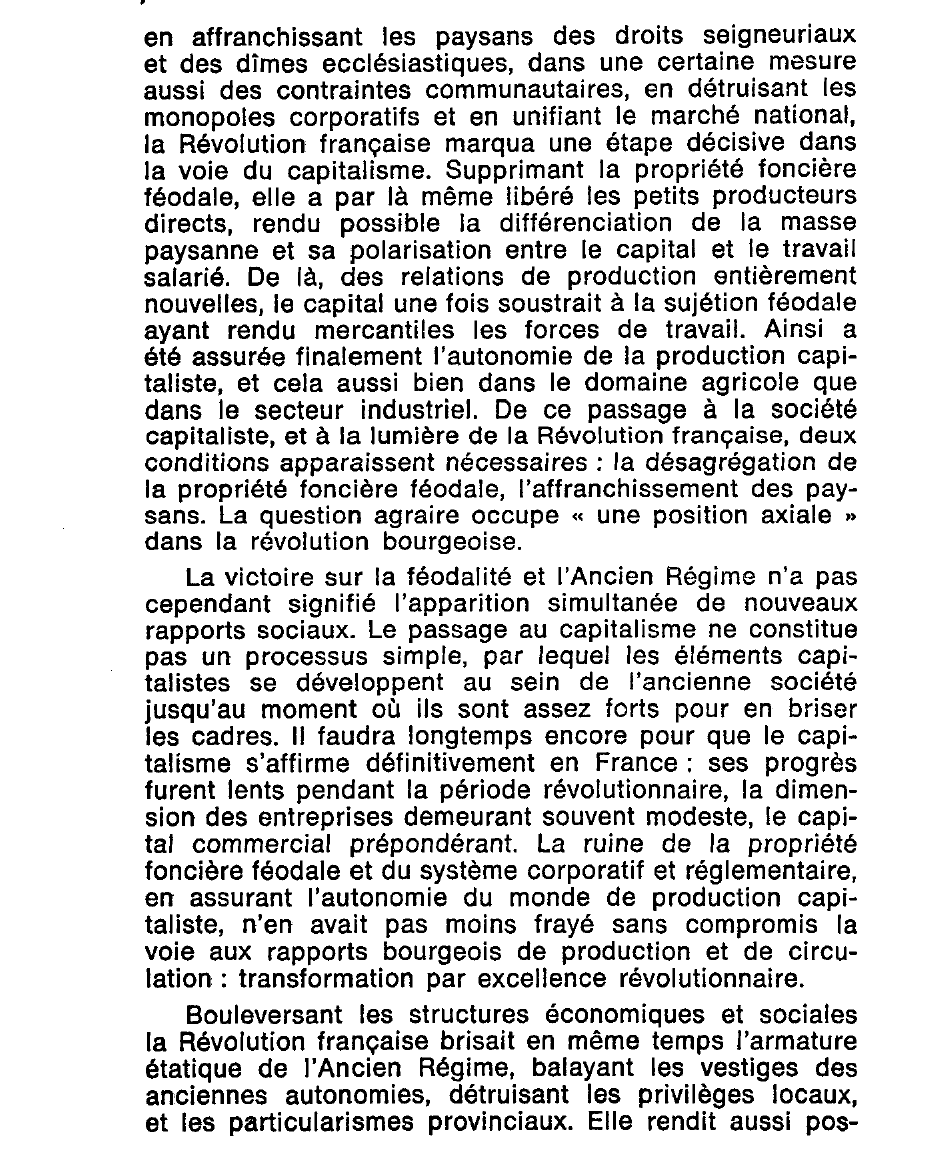RÉALITÉS ET IDÉES NEUVES AU XIXe SIÈCLE
Publié le 30/03/2012

Extrait du document
La Révolution de 1789-1794 a marqué l'avènement de la société moderne bourgeoise et capitaliste, dans l'histoire de la France. Sa caractéristique essentielle est d'avoir réalisé l'unité nationale du pays sur la base de la destruction du régime seigneurial et des ordres féodaux privilégiés: la Révolution, selon Tocqueville dans L'Ancien Régime et la Révolution (1856) "dont l'objet propre était d'abolir partout le reste des institutions du Moyen Age "· Que la Révolution française ait abouti finalement à l'établissement d'une démocratie libérale précise encore sa signification historique. Si elle fut la plus éclatante des révolutions bourgeoises, éclipsant par le caractère dramatique de ses luttes de classes, les révolutions qui l'avaient précédée, la Révolution française le dut à l'obstination de l'aristocratie ancrée sur ses privilèges féodaux, se refusant à toute concession, et à l'acharnement contraire des masses populaires. La bourgeoisie n'avait pas souhaité la ruine de l'aristocratie ; le refus du compromis et la contrerévolution l'obligèrent à poursuivre la destruction de l'ordre ancien. Mais elle n'y parvint qu'en s'alliant aux masses rurales et urbaines, à qui il fallut bien donner satisfaction: la révolution populaire et la terreur firent place nette, la féodalité fut irrémédiablement détruite, la démocratie instaurée...
«
en affranchissant les paysans des droits seigneuriaux
et des dîmes ecclésiastiques, dans une certaine mesure
aussi des contraintes communautaires, en détruisant les
monopoles corporatifs et
en unifiant le marché national,
la Révolution française marqua une étape décisive dans
la voie du capitalisme.
Supprimant la propriété foncière
féodale,
elle a par là même libéré les petits producteurs
directs, rendu possible la différenciation de la masse
paysanne et sa polarisation entre le capital et le travail
salarié.
De là, des relations de production entièrement
nouvelles, le capital une fois soustrait à la sujétion féodale
ayant rendu mercantiles les forces de travail.
Ainsi a
été assurée finalement l'autonomie de la production capi
taliste, et cela aussi bien dans
Je domaine agricole que
dans le secteur industriel.
De ce passage à la société
capitaliste, et à la lumière de la Révolution française, deux
conditions apparaissent nécessaires : la désagrégation de
la propriété foncière féodale, l'affranchissement des pay
sans.
La question agraire occupe
" une position axiale , dans la révolution bourgeoise.
La victoire sur la féodalité et l'Ancien Régime n'a pas
cependant signifié J'apparition simultanée de nouveaux
rapports sociaux.
Le passage au capitalisme ne constitue
pas un processus simple, par lequel les éléments capi
talistes
se développent au sein de l'ancienne société
jusqu'au moment où ils sont assez forts pour en briser
les cadres.
Il faudra longtemps encore pour que Je capi
talisme s'affirme définitivement en France : ses progrès
furent lents pendant la période révolutionnaire, la dimen
sion des entreprises demeurant souvent modeste, le capi
tal commercial prépondérant.
La ruine de la propriété
foncière féodale et du système corporatif et réglementaire,
en assurant J'autonomie du monde de production capi
taliste, n'en avait pas moins frayé sans compromis la
voie aux rapports bourgeois de production et de circu
lation : transformation par excellence révolutionnaire.
Bouleversant les structures économiques et sociales
la Révolution française brisait
en même temps J'armature
étatique de l'Ancien Régime, balayant les vestiges des
anciennes autonomies, détruisant les privilèges locaux,
et les particularismes provinciaux.
Elle rendit aussi pos-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE MOUVEMENT DES IDÉES DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
- L'histoire et la prose d'idées au XIXe siècle
- La Pièce à thèse et le Théâtre d'idées au XIXe siècle
- O poètes, s'écriait Leconte de Lisle, vous n'êtes plus écoutés, parce que vous ne réunissez qu'une somme d'idées désormais insuffisante; l'époque ne vous entend plus, parce que vous l'avez importunée de vos plaintes stériles, impuissants que vous étiez à exprimer autre chose que votre propre inanité (Discours de réception à l'Académie française, 1887). Que pensez-vous de ce reproche adressé aux poètes français du XIXe siècle ?
- Chateaubriand a déclaré que le roman de René, comme celui d'Atala, était lié au même dessein, à savoir d'offrir une démonstration des idées contenues dans le Génie du Christianisme. Quelle est la place de René dans l'œuvre de Chateaubriand ? Quel est le caractère du héros principal ? Quelle a été l'influence de cette œuvre sur la littérature du XIXe siècle ?