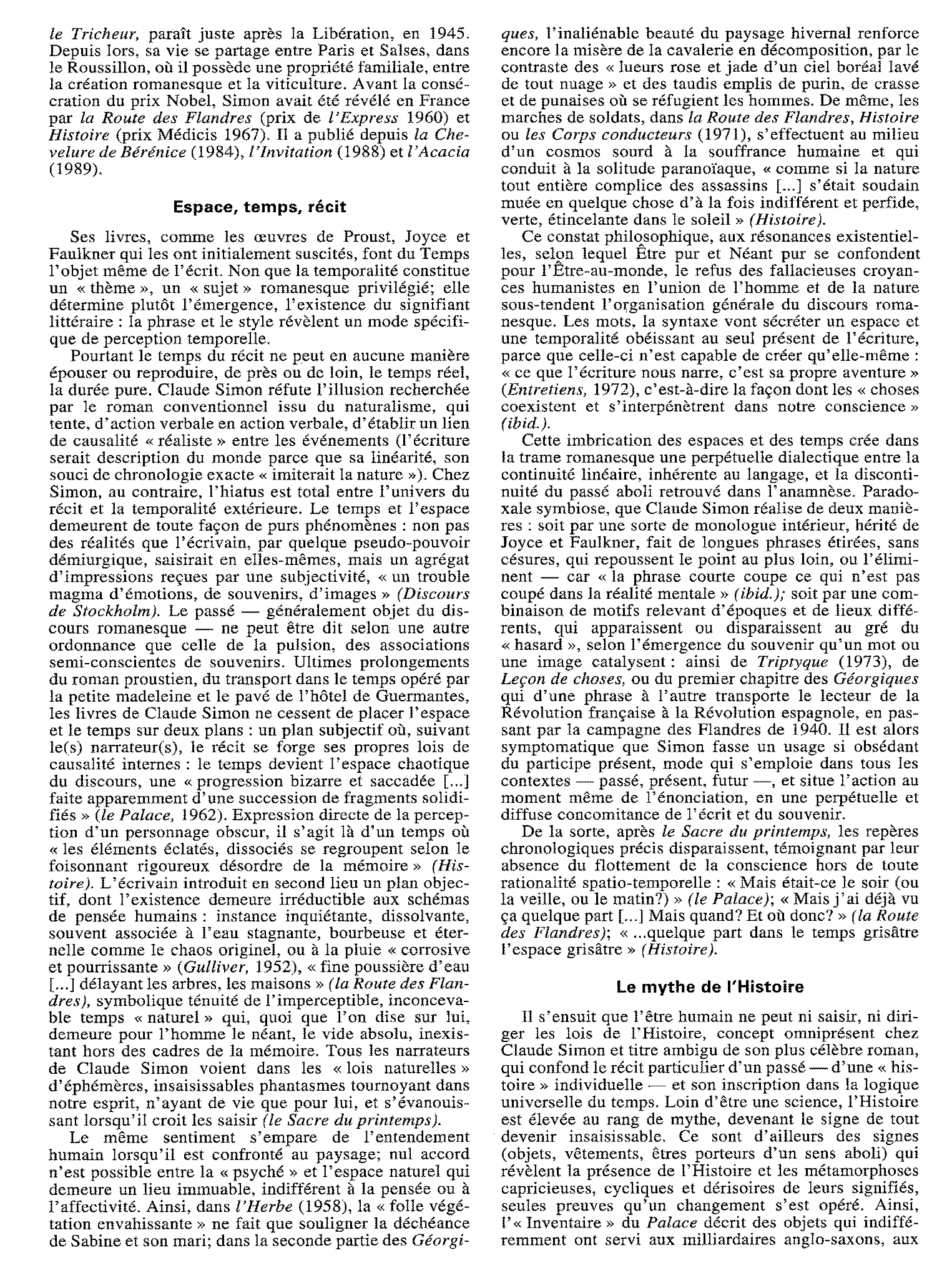SIMON Claude : analyse et critique de l'oeuvre
Publié le 14/10/2018

Extrait du document
Claude Simon, prix Nobel 1985 : il aura fallu la récompense d’une institution littéraire internationale pour qu’un large public français peu à peu découvre un auteur souvent contesté ou rejeté pour « confusionnisme », « hermétisme » ou « artificialité », pour qu’on lise enfin une oeuvre depuis longtemps traduite, répandue, connue dans plus de dix-huit pays.
Considéré dans les années 60 comme l’un des principaux représentants du Nouveau Roman, devenu aujourd’hui une référence majeure de la « modernité » littéraire, Claude Simon mène une vie discrète, éloignée des manifestations de l’intelligentsia culturelle et qui, depuis 1945, se confond avec la pratique même de l’écriture.
De l'expérience vécue au roman
Né à Tananarive d’un père officier colonial, Claude Simon passe son enfance à Perpignan avant de suivre, à partir de 1924, des études secondaires à Paris, au collège Stanislas. Il complète cette formation à Oxford puis à Cambridge, est attiré par la peinture, et devient l’élève d’André Lhote. Mais en 1932 commence une période de voyages à travers l’Europe, seulement interrompue, en 1934-1935, par le service militaire; Simon visite l’Allemagne, l’U.R.S.S., l’Italie, la Grèce. Attiré par l’Espagne républicaine, il côtoie la révolution, expérience décisive, qui ne cessera de transparaître dans les romans ultérieurs, du Sacre du printemps (1954) aux Géorgiques (1981). Vient ensuite la guerre, qu’il effectue dans la cavalerie, au 31e dragons que l’état-major lance à l’assaut des chars allemands : situation dérisoire et apocalyptique qui, transposée, alimentera elle aussi abondamment la fiction (la Route des Flandres, 1960; Leçon de choses, 1976; les Géorgiques encore). Prisonnier en 1940, Claude Simon s’évade d’Allemagne et parvient à rejoindre Perpignan.
Après ces expériences qui l’ont convaincu qu’« il n’y a aucun sens à tout cela » et que — comme pour Shakespeare — « si le monde signifie quelque chose, c’est qu’il ne signifie rien — sauf qu’il est» (Discours de Stockholm, 1986, prononcé à l’occasion de la remise du prix Nobel), il commence à écrire. Son premier roman,
«
le Tricheur, paraît juste après la Libération, en 1945.
Depuis lors, sa vie se partage entre Paris et Salses, dans le Roussillon, où il possède une propriété familiale, entre la création romanesque et la viticulture.
Avant la consé cration du prix Nobel, Simon avait été révélé en France par la Route des Flandres (prix de l'Express 1960) et Histoire (prix Médicis 1967).
Il a publié depuis la Che velure de Bérénice (1984), l'Invitation (1988) et l'Acacia
(1989).
Espace, temps, récit
Ses livres, comme les œuvres de Proust, Joyce et Faulkner qui les ont initialement suscités, font du Temps l'objet même de l'écrit.
Non que la temporalité constitue un «thème», un «sujet» romanesque privilégié; elle détermine plutôt l'émergence, l'existence du signifiant littéraire : la phrase et le style révèlent un mode spécifi que de perception temporelle.
Pourtant le temps du récit ne peut en aucune manière épouser ou reproduire, de près ou de loin, le temps réel, la durée pure.
Claude Simon réfute l'illusion recherchée par le roman conventionnel issu du naturalisme, qui tente, d'action verbale en action verbale, d'établir un lien de causalité « réaliste » entre les événements (l'écriture serait description du monde parce que sa linéarité, son souci de chronologie exacte« imiterait la nature » ).
Chez Simon, au contraire, l'hiatus est total entre l'univers du récit et la temporalité extérieure.
Le temps et l'espace demeurent de toute façon de purs phénomènes : non pas
des réalités que l'écrivain, par quelque pseudo-pouvoir démiurgique, saisirait en elles-mêmes, mais un agrégat d'impressions reçues par une subjectivité, « un trouble magma d'émotions, de souvenirs, d'images» (Discours
de Stockholm).
Le passé - généralement objet du dis cours romanesque ne peut être dit selon une autre ordonnance que celle de la pulsion, des associations semi-conscientes de souvenirs.
Ultimes prolongements du roman proustien, du transport dans le temps opéré par la petite madeleine et le pavé de l'hôtel de Guermantes, les livres de Claude Simon ne cessent de placer l'espace et le temps sur deux plans : un plan subjectif où, suivant le(s) narrateur(s), le récit se forge ses propres lois de causalité internes: le temps devient l'espace chaotique du discours, une «progression bizarre et saccadée [ ...
] faite apparemment d'une succession de fragments solidi
fiés » (le Palace, 1962).
Expression directe de la percep tion d'un personnage obscur, il s'agit là d'un temps où « les éléments éclatés, dissociés se regroupent selon le foisonnant rigoureux désordre de la mémoire » (His
toire).
L'écrivain introduit en second lieu un plan objec tif, dont l'existence demeure irréductible aux schémas de pensée humains : instance inquiétante, dissolvante, souvent associée à l'eau stagnante, bourbeuse et éter nelle comme le chaos originel, ou à la pluie « corrosive et pourrissante» (Gulliver, 1952), «fine poussière d'eau [ ...
] délayant les arbres, les maisons» (la Route des Flan
dres), symbolique ténuité de l'imperceptible, inconceva ble temps « naturel » qui, quoi que l'on dise sur lui, demeure pour l'homme le néant, le vide absolu, inexis tant hors des cadres de la mémoire.
Tous les narrateurs de Claude Simon voient dans les « lois naturelles »
d'éphémères, insaisissables phantasmes tournoyant dans notre esprit, n'ayant de vie que pour lui, et s'évanouis sant lorsqu'il croit les saisir (le Sacre du printemps).
Le même sentiment s'empare de l'entendement humain lorsqu'il est confronté au paysage; nul accord
n'est possible entre la « psyché )) et l'espace naturel qui demeure un lieu immuable, indifférent à la pensée ou à
l'affectivité.
Ainsi, dans l'Herbe (1958), la« folle végé tation envahissante » ne fait que souligner la déchéance de Sabine et son mari; dans la seconde partie des Géorgi- ques,
l'inaliénable beauté du paysage hivernal renforce encore la misère de la cavalerie en décomposition, par le contraste des «lueurs rose et jade d'un ciel
boréal lavé de tout nuage » et des taudis emplis de purin, de crasse et de punaises où se réfugient les hommes.
De même, les marches de soldats, dans la Route des Flandres, Histoire ou les Corps conducteurs (1971), s'effectuent au milieu d'un cosmos sourd à la souffrance humaine et qui conduit à la solitude paranoïaque, « comme si la nature tout entière complice des assassins [ ...
] s'était soudain muée en quelque chose d'à la fois indifférent et perfide,
verte, étincelante dans le soleil» (Histoire).
Ce constat phil~sophique, aux résonances existentiel les, selon lequel Etre pur et Néant pur se confondent pour l'Être-au-monde, le refus des fallacieuses croyan ces humanistes en l'union de l'homme et de la nature sous-tendent l'm;ganisation générale du discours roma
nesque.
Les mots, la syntaxe vont sécréter un espace et une temporalité obéissant au seul présent de l'écriture, parce que celle-ci n'est capable de créer qu'elle-même: « ce que 1' écriture nous narre, c'est sa propre aventure » (Entretiens, 1972), c'est-à-dire la façon dont les« choses coexistent et s'interpénètrent dans notre conscience» (ibid.).
Cette imbrication des espaces et des temps crée dans la trame romanesque une perpétuelle dialectique entre la continuité linéaire, inhérente au langage, et la disconti nuité du passé aboli retrouvé dans l'anamnèse.
Parado xale symbiose, que Claude Simon réalise de deux maniè res : soit par une sorte de monologue intérieur, hérité de Joyce et Faulkner, fait de longues phrases étirées, sans
césures, qui repoussent le point au plus loin, ou l'élimi nent - car «la phrase courte coupe ce qui n'est pas coupé dans la réalité mentale» (ibid.); soit par une com binaison de motifs relevant d'époques et de lieux diffé
rents, qui apparaissent ou disparaissent au gré du «hasard», selon l'émergence du souvenir qu'un mot ou une image catalysent: ainsi de Triptyque (1973), de Leçon de choses, ou du premier chapitre des Géorgiques qui d'une phrase à l'autre transporte le lecteur de la Révolution française à la Révolution espagnole, en pas sant par la campagne des Flandres de 1940.
Il est alors symptomatique que Simon fasse un usage si obsédant du participe présent, mode qui s'emploie dans tous les contextes passé, présent, futur-, et situe l'action au moment même de l'énonciation, en une perpétuelle et diffuse concomitance de l'écrit et du souvenir.
De la sorte, après le Sacre du printemps, les repères chronologiques précis disparaissent, témoignant par leur absence du flottement de la conscience hors de toute rationalité spatio-temporelle : «Mais était-ce le soir (ou la veille, ou le matin?)» (le Palace); «Mais j'ai déjà vu ça quelque part[ ...
] Mais quand? Et où donc?)> (la Route
des Flandres); « ...
quelque part dans le temps grisâtre 1' espace grisâtre » (Histoire).
Le mythe de l'Histoire
Il s'ensuit que l'être humain ne peut ni saisir, ni diri ger les lois de l'Histoire, concept omniprésent chez Claude Simon et titre ambigu de son plus célèbre roman,
qui confond le récit particulier d'un passé d'une« his toire » individuelle - et son inscription dans la logique
universelle du temps.
Loin d'être une science, l'Histoire est élevée au rang de mythe, devenant le signe de tout devenir insaisissable.
Ce sont d'ailleurs des signes
(objets, vêtements, êtres porteurs d'un sens aboli) qui révèlent la présence de l'Histoire et les métamorphoses
capricieuses, cycliques et dérisoires de leurs signifiés,
seules preuves qu'un changement s'est opéré.
Ainsi, l'« Inventaire » du Palace décrit des objets qui indiffé remment ont servi aux milliardaires anglo-saxons, aux.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SAINT-SIMON, Claude Henri de Rouvroy, comte de (analyse critique de l'oeuvre)
- GÉORGIQUES (les) de CLAUDE SIMON (résumé et analyse de l'oeuvre)
- SAINT-SIMON, Louis, duc de : analyse et critique de l'oeuvre.
- SIMON Richard : analyse et critique de l'oeuvre
- SEYSSEL ou SEISSEL Claude de: analyse et critique de l'oeuvre