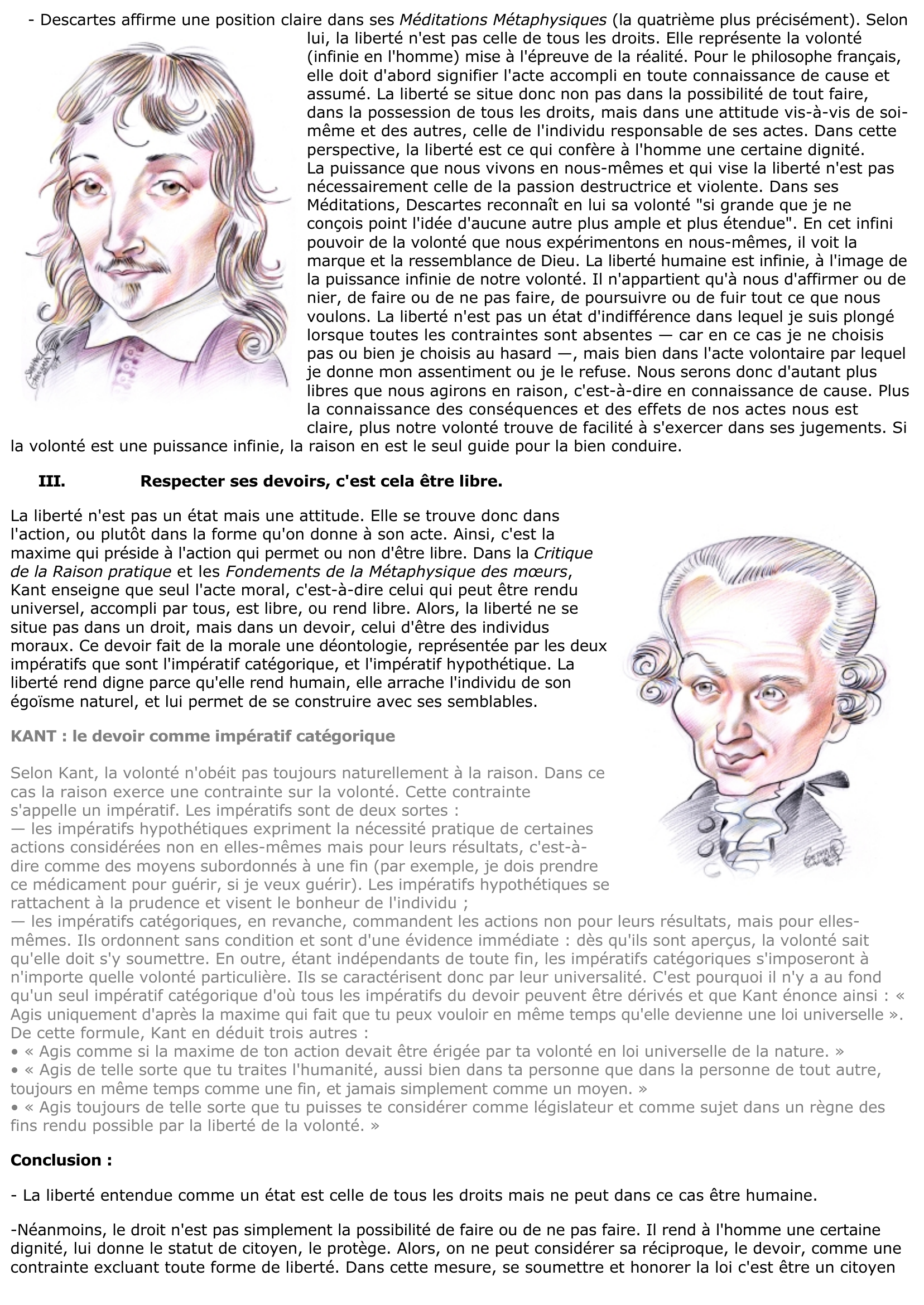Avoir tous les droits est-ce être libre?
Publié le 14/01/2005
Extrait du document
«
- Descartes affirme une position claire dans ses Méditations Métaphysiques (la quatrième plus précisément).
Selon lui, la liberté n'est pas celle de tous les droits.
Elle représente la volonté(infinie en l'homme) mise à l'épreuve de la réalité.
Pour le philosophe français,elle doit d'abord signifier l'acte accompli en toute connaissance de cause etassumé.
La liberté se situe donc non pas dans la possibilité de tout faire,dans la possession de tous les droits, mais dans une attitude vis-à-vis de soi-même et des autres, celle de l'individu responsable de ses actes.
Dans cetteperspective, la liberté est ce qui confère à l'homme une certaine dignité.La puissance que nous vivons en nous-mêmes et qui vise la liberté n'est pasnécessairement celle de la passion destructrice et violente.
Dans sesMéditations, Descartes reconnaît en lui sa volonté "si grande que je neconçois point l'idée d'aucune autre plus ample et plus étendue".
En cet infinipouvoir de la volonté que nous expérimentons en nous-mêmes, il voit lamarque et la ressemblance de Dieu.
La liberté humaine est infinie, à l'image dela puissance infinie de notre volonté.
Il n'appartient qu'à nous d'affirmer ou denier, de faire ou de ne pas faire, de poursuivre ou de fuir tout ce que nousvoulons.
La liberté n'est pas un état d'indifférence dans lequel je suis plongélorsque toutes les contraintes sont absentes — car en ce cas je ne choisispas ou bien je choisis au hasard —, mais bien dans l'acte volontaire par lequelje donne mon assentiment ou je le refuse.
Nous serons donc d'autant pluslibres que nous agirons en raison, c'est-à-dire en connaissance de cause.
Plusla connaissance des conséquences et des effets de nos actes nous estclaire, plus notre volonté trouve de facilité à s'exercer dans ses jugements.
Si la volonté est une puissance infinie, la raison en est le seul guide pour la bien conduire.
III. Respecter ses devoirs, c'est cela être libre.
La liberté n'est pas un état mais une attitude.
Elle se trouve donc dansl'action, ou plutôt dans la forme qu'on donne à son acte.
Ainsi, c'est lamaxime qui préside à l'action qui permet ou non d'être libre.
Dans la Critique de la Raison pratique et les Fondements de la Métaphysique des mœurs , Kant enseigne que seul l'acte moral, c'est-à-dire celui qui peut être renduuniversel, accompli par tous, est libre, ou rend libre.
Alors, la liberté ne sesitue pas dans un droit, mais dans un devoir, celui d'être des individusmoraux.
Ce devoir fait de la morale une déontologie, représentée par les deuximpératifs que sont l'impératif catégorique, et l'impératif hypothétique.
Laliberté rend digne parce qu'elle rend humain, elle arrache l'individu de sonégoïsme naturel, et lui permet de se construire avec ses semblables.
KANT : le devoir comme impératif catégorique
Selon Kant, la volonté n'obéit pas toujours naturellement à la raison.
Dans cecas la raison exerce une contrainte sur la volonté.
Cette contraintes'appelle un impératif.
Les impératifs sont de deux sortes :— les impératifs hypothétiques expriment la nécessité pratique de certainesactions considérées non en elles-mêmes mais pour leurs résultats, c'est-à-dire comme des moyens subordonnés à une fin (par exemple, je dois prendrece médicament pour guérir, si je veux guérir).
Les impératifs hypothétiques serattachent à la prudence et visent le bonheur de l'individu ;— les impératifs catégoriques, en revanche, commandent les actions non pour leurs résultats, mais pour elles-mêmes.
Ils ordonnent sans condition et sont d'une évidence immédiate : dès qu'ils sont aperçus, la volonté saitqu'elle doit s'y soumettre.
En outre, étant indépendants de toute fin, les impératifs catégoriques s'imposeront àn'importe quelle volonté particulière.
Ils se caractérisent donc par leur universalité.
C'est pourquoi il n'y a au fondqu'un seul impératif catégorique d'où tous les impératifs du devoir peuvent être dérivés et que Kant énonce ainsi : «Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ».De cette formule, Kant en déduit trois autres :• « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature.
»• « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre,toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen.
»• « Agis toujours de telle sorte que tu puisses te considérer comme législateur et comme sujet dans un règne desfins rendu possible par la liberté de la volonté.
»
Conclusion :
- La liberté entendue comme un état est celle de tous les droits mais ne peut dans ce cas être humaine.
-Néanmoins, le droit n'est pas simplement la possibilité de faire ou de ne pas faire.
Il rend à l'homme une certainedignité, lui donne le statut de citoyen, le protège.
Alors, on ne peut considérer sa réciproque, le devoir, comme unecontrainte excluant toute forme de liberté.
Dans cette mesure, se soumettre et honorer la loi c'est être un citoyen.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Être libre, est-ce avoir tous les droits ?
- Être libre, est-ce avoir tous les droits ?
- Etre libre, est-ce pouvoir exercer ses droits ?
- Un homme privé de ses droits de citoyen est-il encore un homme libre ?
- Avoir tous les droits, est-ce etre libre ?