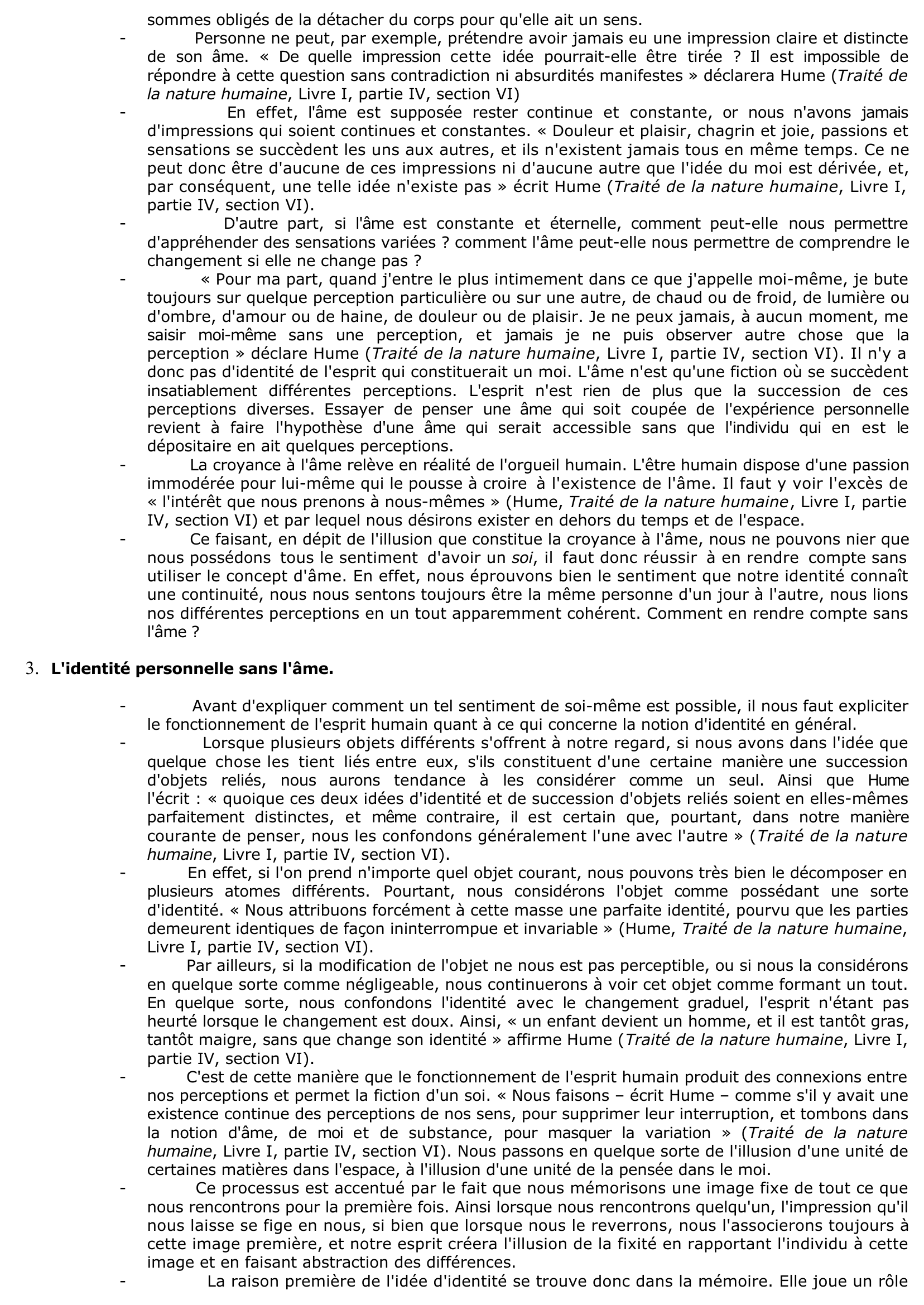Comment puis-je dire que je suis le même alors que je change au cours du temps ?
Publié le 19/08/2005

Extrait du document

Analyse du sujet :
- La question pose problème, car ce qui caractérise le changement, c'est le fait que quelque chose passe d'un état à un autre état, et que dans ce passage, l'état premier est supprimé pour laisser la place à l'état second. Il y a donc a priori stricte opposition entre le changement et le fait de demeurer le même.
- Pourtant, en ce qui concerne l'être humain, chacun peut affirmer à la fois qu'il a changé, et en même temps qu'il est toujours lui-même. Même dans le cas où l'on dit de quelqu'un qu'il « sort de lui-même «, on espère toujours qu'il « redeviendra lui-même «, ce qui indique qu'on suppose toujours une individualité sous-jacente.
- Cela implique de considérer que ce n'est pas la totalité de l'individu qui change, mais seulement une partie, comme s'il y avait un noyau central en lequel reposait l'individualité, et d'autres choses autour, plus superficielles, qui pourraient changer sans modifier ce noyau.
- Ainsi par exemple, lorsque quelqu'un grandit, on constate bien que son corps change. Si l'on s'obstine à considérer qu'il est le même, c'est parce qu'on pense que son corps n'est qu'un aspect superficiel de lui-même, qu'il est presque négligeable en regard de ce noyau profond qui constitue son moi intime.
- La question revient donc à se demander quelle est la nature de ce mystérieux noyau et comment il est possible qu'il résiste aux modifications qui lui sont périphériques.
- Ce questionnement pourrait ensuite nous amener à nous interroger sur la pertinence de cette impression selon laquelle nous resterions le même.
Problématisation :
Le sentiment de disposer d'un moi profond que rien ne puisse altérer est si prégnant chez l'être humain qu'il est quasiment incontestable. Il n'en reste pas moins que dans un monde où le passage du temps semble condamner toute chose au changement, il est difficile de rendre compte de ce sentiment intime. Il n'y a guère d'autres solutions que de postuler chez tout être humain un moi immuable qui résiste aux altérations extérieures, mais comment considérer l'existence d'un tel moi si, par ailleurs, le corps peut changer jusqu'à disparaître totalement ?

«
sommes obligés de la détacher du corps pour qu'elle ait un sens. - Personne ne peut, par exemple, prétendre avoir jamais eu une impression claire et distincte de son âme.
« De quelle impression cette idée pourrait-elle être tirée ? Il est impossible derépondre à cette question sans contradiction ni absurdités manifestes » déclarera Hume ( Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI) - En effet, l'âme est supposée rester continue et constante, or nous n'avons jamais d'impressions qui soient continues et constantes.
« Douleur et plaisir, chagrin et joie, passions etsensations se succèdent les uns aux autres, et ils n'existent jamais tous en même temps.
Ce nepeut donc être d'aucune de ces impressions ni d'aucune autre que l'idée du moi est dérivée, et,par conséquent, une telle idée n'existe pas » écrit Hume ( Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI). - D'autre part, si l'âme est constante et éternelle, comment peut-elle nous permettre d'appréhender des sensations variées ? comment l'âme peut-elle nous permettre de comprendre lechangement si elle ne change pas ? - « Pour ma part, quand j'entre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, je bute toujours sur quelque perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière oud'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir.
Je ne peux jamais, à aucun moment, mesaisir moi-même sans une perception, et jamais je ne puis observer autre chose que laperception » déclare Hume ( Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI).
Il n'y a donc pas d'identité de l'esprit qui constituerait un moi.
L'âme n'est qu'une fiction où se succèdentinsatiablement différentes perceptions.
L'esprit n'est rien de plus que la succession de cesperceptions diverses.
Essayer de penser une âme qui soit coupée de l'expérience personnellerevient à faire l'hypothèse d'une âme qui serait accessible sans que l'individu qui en est ledépositaire en ait quelques perceptions. - La croyance à l'âme relève en réalité de l'orgueil humain.
L'être humain dispose d'une passion immodérée pour lui-même qui le pousse à croire à l'existence de l'âme.
Il faut y voir l'excès de« l'intérêt que nous prenons à nous-mêmes » (Hume, Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI) et par lequel nous désirons exister en dehors du temps et de l'espace. - Ce faisant, en dépit de l'illusion que constitue la croyance à l'âme, nous ne pouvons nier que nous possédons tous le sentiment d'avoir un soi, il faut donc réussir à en rendre compte sans utiliser le concept d'âme.
En effet, nous éprouvons bien le sentiment que notre identité connaîtune continuité, nous nous sentons toujours être la même personne d'un jour à l'autre, nous lionsnos différentes perceptions en un tout apparemment cohérent.
Comment en rendre compte sansl'âme ? L'identité personnelle sans l'âme. 3.
- Avant d'expliquer comment un tel sentiment de soi-même est possible, il nous faut expliciter le fonctionnement de l'esprit humain quant à ce qui concerne la notion d'identité en général. - Lorsque plusieurs objets différents s'offrent à notre regard, si nous avons dans l'idée que quelque chose les tient liés entre eux, s'ils constituent d'une certaine manière une successiond'objets reliés, nous aurons tendance à les considérer comme un seul.
Ainsi que Humel'écrit : « quoique ces deux idées d'identité et de succession d'objets reliés soient en elles-mêmesparfaitement distinctes, et même contraire, il est certain que, pourtant, dans notre manièrecourante de penser, nous les confondons généralement l'une avec l'autre » ( Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI). - En effet, si l'on prend n'importe quel objet courant, nous pouvons très bien le décomposer en plusieurs atomes différents.
Pourtant, nous considérons l'objet comme possédant une sorted'identité.
« Nous attribuons forcément à cette masse une parfaite identité, pourvu que les partiesdemeurent identiques de façon ininterrompue et invariable » (Hume, Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI). - Par ailleurs, si la modification de l'objet ne nous est pas perceptible, ou si nous la considérons en quelque sorte comme négligeable, nous continuerons à voir cet objet comme formant un tout.En quelque sorte, nous confondons l'identité avec le changement graduel, l'esprit n'étant pasheurté lorsque le changement est doux.
Ainsi, « un enfant devient un homme, et il est tantôt gras,tantôt maigre, sans que change son identité » affirme Hume ( Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI). - C'est de cette manière que le fonctionnement de l'esprit humain produit des connexions entre nos perceptions et permet la fiction d'un soi.
« Nous faisons – écrit Hume – comme s'il y avait uneexistence continue des perceptions de nos sens, pour supprimer leur interruption, et tombons dansla notion d'âme, de moi et de substance, pour masquer la variation » ( Traité de la nature humaine , Livre I, partie IV, section VI).
Nous passons en quelque sorte de l'illusion d'une unité de certaines matières dans l'espace, à l'illusion d'une unité de la pensée dans le moi. - Ce processus est accentué par le fait que nous mémorisons une image fixe de tout ce que nous rencontrons pour la première fois.
Ainsi lorsque nous rencontrons quelqu'un, l'impression qu'ilnous laisse se fige en nous, si bien que lorsque nous le reverrons, nous l'associerons toujours àcette image première, et notre esprit créera l'illusion de la fixité en rapportant l'individu à cetteimage et en faisant abstraction des différences. - La raison première de l'idée d'identité se trouve donc dans la mémoire.
Elle joue un rôle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- le temps (cours complet)
- Cours sur LE TEMPS
- LE TEMPS (cours de philosophie)
- INTRODUCTION COURS SUR LE TEMPS
- Le cours de l'histoire change-t-il ?