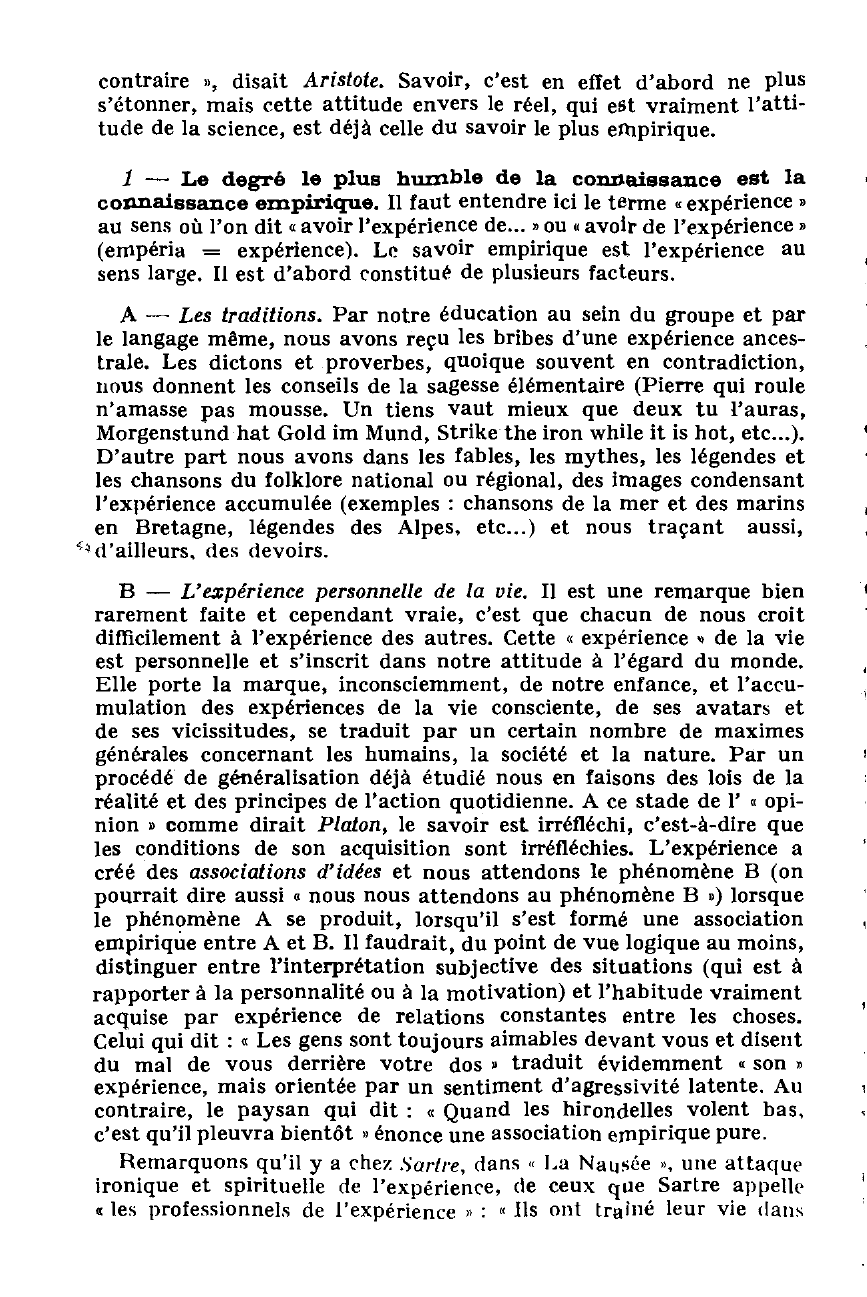Comment se constitue la science ?
Publié le 27/01/2012
Extrait du document
L'animal semble doué d'une capacité de connaissance sensible,
et certains animaux supérieurs, auxquels on s'accorde ordinairement
à reconnaître de l'intelligence sont vraiment ingénieux. L'homme
les dépasse en ceci qu'il est, en outre, artificieux, c'est-à-dire non
seulement capable de saisir les rapports concrets, mais aussi capable
de chercher les principes par lesquels les effets peuvent être indéfiniment
reproduits par voie nécessaire et surtout d'inventer des
moyens nouveaux d'expression et d'action, de réaliser des instruments
et des formes physiques nouvelles.
«
contraire •, disait Aristote.
Savoir, c'est en effet d'abord ne plus
s'étonner, mais cette attitude envers le réel, qui est vraiment l'atti tude de la science, est déjà celle du savoir le plus etnpirique.
1 - Le degré le plus hUIIIble de la conraaissance est la co:PDaissance 8Dlpirique.
Il faut entendre ici le terme • expérience • au sens où l'on dit • avoir l'expérience de ...
• ou • avoir de l'expérience • (empéria = expérience).
Le savoir empirique est l'expérience au sens large.
Il est d'abord constitué de plusieurs facteurs.
A - Les
traditions.
Par notre éducation au sein du groupe et par le langage même, nous avons reçu les bribes d'une expérience ances
trale.
Les dictons et proverbes, quoique souvent en contradiction,
nous donnent les conseils de la sagesse élémentaire (Pierre qui roule n'amasse pas mousse.
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, Morgenstund hat Gold im Mund, Strike·the iron while it is hot, etc ..• ).
D'autre part nous avons dans les fables, les mythes, les légendes et les chansons du folklore national ou régional, des images condensant
l'expérience accumulée (exemples : chansons de la mer et des marins en Bretagne, légendes des Alpes, etc ...
) et nous traçant aussi, f< d'ailleurs.
des devoirs.
B -
L'e:s;périence personnelle de la vie.
Il est une remarque bien rarement faite et cependant vraie, c'est que chacun de nous croit difficilement à l'expérience des autres.
Cette • expérience" de la vie est personnelle et s'inscrit dans notre attitude à l'égard du monde.
Elle porte la marque, inconsciemment, de notre enfance, et l'accu mulation des expériences de la vie consciente, de ses avatars et de ses vicissitudes, se traduit par un certain nombre de maximes générales concernant les humains, la société et la nature.
Par un procédé de généralisation déjà étudié nous en faisons des lois de la réalité et des principes de l'action quotidienne.
A ce stade de l' • opi
nion • comme dirait Platon, le savoir est irréfléchi, c'est-à-dire que les conditions de son acquisition sont irréfléchies.
L'expérience a
créé des associations d'idées et nous attendons le phénomène B (on pourrait dire aussi • nous nous attendons au phénomène B •) lorsque
le phénomène A se produit, lorsqu'il s'est formé une association
empirique entre A et B.
Il faudrait, du point de vue logique au moins,
distinguer entre l'interprétation subjective des situations (qui est à rapporter à la personnalité ou à la motivation) et l'habitude vraiment acquise par expérience de relations constantes entre les choses.
Celui qui dit : • Les gens sont toujours aimables devant vous et disent du mal de vous derrière votre dos • traduit évidemment • son • expérience, mais orientée par un sentiment d'agressivité latente.
Au
contraire, le paysan qui dit : • Quand les hirondelles volent bas, c'est qu'il pleuvra bientôt • énonce une association empirique pure.
Remarquons qu'il
y a chez Sartre, dans " La Nausée •, une attaqut> ironique et spirituelle de l'expérience, de ceux que Sartre appelle a les professionnels de l'expérience , : • Ils ont tra!né leur vie dans.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le modèle déductif des Mathématiques constitue-t-il un idéal pour la science entière?
- La Science constitue -t-elle une arme contre l'irrationnel ?
- Le modèle déductif des mathématiques constitue-t-il un idéal pour la science ?
- LA SCIENCE DE LA LANGUE ET LE STRUCTURALISME
- Peut-on tout attendre de la science ?