DIDEROT Denis : sa vie et son oeuvre
Publié le 22/11/2018

Extrait du document
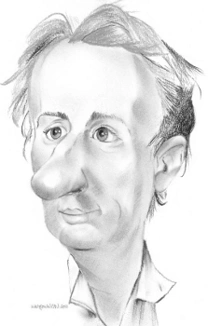
Les cordes, les abeilles, le polype et l'araignée
Derrière les prudences et les masques, l’hypothèse matérialiste s’exprime donc très tôt et très fortement dans l’œuvre de Diderot, mais les tendances de sa personnalité le portent plus vers le concret que vers l’abstrait : aussi le discours scientifique ou métaphysique s’accompagne-t-il toujours de visualisation. Diderot philosophe ne cesse jamais d’être poète; mieux : la philosophie matérialiste devient la source d’une nouvelle poésie.
La vision du chaos s’organisant lui-même, « dans le commencement où la matière en fermentation faisait éclore l’univers » (Lettre sur les aveugles), est une image qui fascine Diderot. La matière créatrice fait jaillir à profusion des multitudes d’espèces, quelques-unes bien organisées, d’autres monstrueuses, qui disparaissent. L’espèce humaine, qui avait des organes normaux de digestion et de reproduction, est une de celles qui, par hasard, ont pu survivre. Mais elle disparaîtra un jour, comme les autres. Au demeurant, elle n’est pas parfaite : le géomètre aveugle Saunderson en est la preuve. Que serait un Dieu qui tolérerait que l’un voie, et l’autre non? Mieux vaut ne pas retenir l’hypothèse Dieu.
Il en est des mondes comme des espèces : les uns sont manqués, les autres réussis. Dans une vaste vision cosmique, Diderot se plaît à imaginer des mondes qui disparaissent, d’autres qui se forment dans les espaces éloignés, à tout instant. Il reste imprégné des images du De natura rerum de Lucrèce. Un mouvement permanent combine des amas de matière, jusqu’à ce qu’apparaissent « une symétrie passagère, un ordre momentané ». Notre monde n’est qu’un point dans le temps et l’espace infinis. Diderot reprend à Pascal ses visions cosmiques, mais en les vidant de leur angoisse pour n’y montrer que la puissance merveilleuse de la matière et de la vie.
Dans l’essai De l'interprétation de la nature et dans le Rêve de d’Alembert, le thème de l’évolution des espèces suscite d’autres fresques en mouvement sur l’image de la fermentation universelle : « Qu’était l’éléphant dans son origine? Peut-être l’animal énorme, tel qu’il nous paraît; peut-être un atome, car tous les deux sont également possibles; ils ne supposent que le mouvement et les propriétés diverses de la matière... L’éléphant, cette masse énorme, organisée, le produit subit de la fermentation? Pourquoi non? Le rapport de ce grand quadrupède à sa matrice première est moindre que celui du vermisseau à la molécule de farine qui l’a produit » (le Rêve de d’Alembert). Les expériences du jésuite Needham sur les générations spontanées à partir de grains de blc et de farine fermentés ont ouvert à Diderot d’immenses horizons philosophiques et poétiques. Il y voit l’explication et l’origine de la vie.
Dans certaines conditions de chaleur, il se produit dans l’œuf des réactions chimiques qui suscitent l’apparition des ailes, des pattes et enfin du poulet. La vie n’est plus un « prodige » : la matière inerte n’est pas morte, elle porte en elle une « sensibilité sourde » qui ne demande qu’à devenir active et vivante selon des processus chimiques naturels. De même, Diderot se plaît, dans cette trilogie du Rêve de d’Alembert, à imaginer l’évolution naturelle de d’Alembert et de son interlocutrice Julie de Lespinasse depuis le stade embryonnaire jusqu’à l’âge adulte. Aux théories génétiques de son temps sur les germes préexistants, il préfère celle de l’cpigenèse : il voit ainsi l’embryon se former, se développer, acquérir successivement vie, mémoire, conscience, passions,
pensée à partir de la molécule originelle, « éternelle et inaltérable ».
Ainsi se précise peu à peu une vision nouvelle de l’homme : les molécules forment des « fibres », qui forment des organes, qui à leur tour forment un corps. La poésie demande des images : notre corps est comme un essaim d’abeilles; d’abord juxtaposées, contiguës, les abeilles rassemblées se fondent en un ensemble organisé continu animé d’une sensibilité globale; mais, si on les sépare, chaque abeille retrouve sa vie séparée. De même, chacun de nos organes est un animal indépendant : « Homme : assemblage d’animaux où chacun garde sa fonction » (Eléments de physiologie). Chacun de nous est animé d’une triple vie : celle de chaque molécule, celle de chaque organe — qui vit et meurt à son rythme —, celle de l’être organisé. Le mouvement et la sensibilité, inhérents et essentiels à la matière, assurent la vie sans intervention extérieure.
Du stade de la sensibilité et de la vie à celui de la pensée, rien d’autre non plus que la matière. Diderot est farouchement opposé à la notion d’âme conçue comme une substance différente du corps. La structure du corps vivant ressemble à une araignée au centre de sa toile. A partir de chaque point de l’extérieur du corps, des fibres nerveuses forment un faisceau qui converge vers un centre situé dans le cerveau et qui enregistre les sensations. De la comparaison de ces sensations naissent les idées, celles du chaud ou du froid, par exemple. Encore faut-il que nous gardions le souvenir des sensations passées : le point central du faisceau est là pour cela, il assure la mémoire, seule garantie de l’unité de notre moi. Sur la mémoire, Diderot tient dans ses Éléments de physiologie des propos qui préfigurent ceux de Proust : il est persuadé que tout ce que nous avons une fois vu, entendu, connu, reste en nous à notre insu : chaque arbre d’une forêt, chaque grain de sable d’un rivage, chaque voix, chaque cri, chaque air de musique. « Je revois actuellement, éveillé, toutes les forêts de la Westphalie, de la Prusse, de la Saxe et de la Pologne. Je les revois en rêve aussi fortement coloriées qu’elles le seraient dans un tableau de Vernet. Le sommeil m’a remis dans des concerts qui se sont exécutés derechef comme lorsque j’y étais. »
Si, pour l’enregistrement des sensations, l’image analogique de l’araignée s’impose, pour les émotions et les passions, c’est celle de l’instrument de musique, du clavecin. Chaque corde pincée, brin du faisceau nerveux, fait vibrer la voisine, qui fait vibrer la troisième, et ainsi de suite. La différence avec le clavecin, qui n’a que la sensibilité potentielle de la matière inerte, est que nous sommes à la fois l’instrument et le musicien. Ce qui nous entoure étant ainsi cause des sensations et des émotions, l’univers entier devient une sorte d’immense caisse de résonance, le lieu où résonne une symphonie au sein de laquelle chacun de nous joue sa partie, recevant les sensations qui font vibrer les cordes de nos passions et mettent en jeu notre énergie. Tout, y compris le rêve (« état anarchique où le centre ne domine plus »), s’explique par les actions et réactions des éléments de la matière. Si chacun de nos organes est un animal indépendant à l’intérieur de nous, chacun de nous est un animal indépendant, une partie du grand animal qu’est le Tout, immense polype dont chaque partie est vivante. Cette image du polype dont chaque partie reste vivante quand on la coupe est aussi une des images obsédantes de Diderot. Il fut surpris, un jour, de voir une vipère, tête coupée, écorchée, vidée de son cœur et de ses entrailles, continuer à se mouvoir longuement : « Pourquoi dirais-je qu’elle ne vit pas? »
Dans ce monde de matière, où tout vit avec une énergie tenace, où la mort n’est qu’un passage d’une vie globale consciente à une vie moléculaire primaire, cha
DIDEROT Denis (1713-1784). «J’arrête mes yeux sur l’amas général des corps; je vois tout en action et en réaction; tout se détruisant sous une forme; tout se recomposant sous une autre; des sublimations, des dissolutions, des combinaisons de toutes les espèces (...) : d'où naît le mouvement ou plutôt la fermentation générale dans l'univers » (Principes philosophiques sur la matière et le mouvement). Le mouvement et la fermentation : la vie, la pensée de Diderot furent continuellement cela. Ses idées bouillonnent, prennent forme, se détruisent, se recomposent. Aucun système fixe, aucun scepticisme non plus : il tente à tout prix d’arracher à cette attitude philosophique son ami d’Alembert. « Notre véritable sentiment n'est pas celui dans lequel nous n'avons jamais vacillé, mais celui auquel nous sommes le plus habituellement revenus » (Entretien avec d’Alembert). Pour lui, ce « sentiment », c’est que le monde n'est que matière. S'il lui arrive de vaciller, c’est vers le spinozisme qu’il incline un instant : « Deus sive natura ». Mais presque toujours, c’est à la nature sans Dieu qu'il s’en tient. Il est fasciné par « la possibilité des choses ».
Les contradictions ne l’effraient pas. Friand de dialectique, il a toujours préféré à la synthèse finale trop fixe le moment où, du heurt des contraires, jaillit l’étincelle qui éclaire toutes les possibilités du problème et en révèle la richesse; le moment, surtout, où il peut concilier unité et diversité, ce qui satisfait à la fois son esprit et son imagination. Le monde entier n’existe pour lui que dans cette contradiction de l’un et du multiple, à la fois opposition et harmonie. Le matérialisme permettant la meilleure explication de cette structure contradictoire, il s’y est attaché.
Dans sa vie même, il y a une contradiction fondamentale : celle qui oppose le bourgeois serein et le philosophe tumultueux. Mais l’aventure intellectuelle que la vision matérialiste du monde et ses conséquences lui proposent n’est-elle pas justement un refuge pour ses rêves et ses délires, une compensation à la vie de conventions et d’honorabilité qu’impliquent ses rôles de chef de famille et de directeur de l’Encyclopédie? Cela étant, c’est bien son être authentique qui apparaît dans ses écrits philosophiques et dans ses « contes ». Il poursuit sans fin ce rêve matérialiste dans lequel il se jette de toute son énergie, savourant le plaisir — malgré les moments de fatigue et de découragement — de vivre en continuel mouvement dans un univers en mouvement éternel.
Pour illustrer le destin, dans sa « rhapsodie » de Jacques le Fataliste, Diderot emploie l’image d’un grand rouleau des causes et des effets plutôt que celle, classique, d'un grand livre. C’est qu’un livre a un début et une fin et suppose quelqu’un qui l’a écrit — ce « quelqu’un » qu'il a toujours refusé, sans parti pris ni hostilité systématique, simplement parce que cette hypothèse compliquait et obscurcissait encore plus, et inutilement, l’interprétation de la nature, clef de la connaissance de l'homme et son principal souci jusqu’à son dernier souffle.
« Un homme très dangereux »
Langres, où naquit Denis Diderot, était en 1713 un puissant évêché; le frère de Denis, Didier, fut prêtre; une de ses sœurs fut religieuse au couvent des ursulines, où elle mourut folle à vingt-huit ans; Denis lui-même, élève des jésuites de la ville, fut tonsuré à treize ans, « par provision » (son oncle, chanoine, pensait qu’il lui succéderait). Il lui est arrivé de jeûner et même de porter cilice. Mais les Langrois, a-t-il dit un jour, sont sensibles aux variations météorologiques; le vent d’Est devait pousser Diderot vers un autre destin : parti pour Paris afin d'y devenir jésuite, il s’éprit de l’étude pour l’étude, dédaignant les injonctions paternelles de se faire au moins médecin ou avocat.
Ce départ pour Paris, à seize ans, après l'enfance à Langres entre une mère dont il a peu parlé et un père, artisan coutelier, qu’il admirait pour sa rigueur morale, sa sensibilité et son honorabilité, marque le début d’une vie passionnée, surmenée, tumultueuse, bien qu’elle se déroule jusqu’à soixante ans dans le seul espace parisien, si l’on excepte trois voyages à Langres pour affaires de famille et tentatives de réconciliation avec son frère, abbé fanatique. Ce qu’il fit à Paris de seize à vingt-huit ans, de 1728 à 1740, nous l’ignorons presque entièrement : la maîtrise ès Arts de l’université de Paris, puis la vie de bohème qu’il mena sont les seules certitudes. Il fut, semble-t-il, clerc de procureur et précepteur. Hors cela, des anecdotes, racontées par lui plus tard, mais anecdotes significatives : comment il déclamait des tirades de Molière dans le jardin du Luxembourg, comment il se bouchait les oreilles au théâtre pour voir si les gestes seuls des acteurs lui permettraient de comprendre la pièce. Et les joyeuses roueries auxquelles il se livrait pour se procurer un peu d’argent.
En 1741, il rencontre une lingère, Anne-Toinette Champion. Son père lui ayant refusé l’autorisation de se marier avec elle, il l’épouse secrètement en 1743. Elle restera sa compagne jusqu’à la fin. Diderot, qui connaît l’anglais, fait des traductions pour nourrir le ménage. « Si ce n’est pas de la gloire, c’est du bouillon », dira son personnage du Neveu de Rameau. En tout cas, c’est le début d’une formation encyclopédique : histoire de la Grèce, ouvrages de médecine, puis la Cyclopaedia de Chambers, d’où allait naître l’immense entreprise de VEncyclopédie [voir Encyclopédie]. En 1742, la rencontre avec Jean-Jacques Rousseau, pour quinze ans d’amitié avant une brouille retentissante, fait surgir de nouvelles idées, de nouveaux échanges; sur la philosophie sensualiste, en particulier, lorsque Condillac se joint à eux.
Philosophiquement, la vraie vie commence en 1745 : Diderot a trente-deux ans et traduit — très librement — l'Essai sur le mérite et la vertu du théiste anglais Shaftesbury. Il y puise, pour toujours, quelques idées fondamentales : d’abord, un nouvel encouragement à lutter contre le fanatisme et la superstition; mais surtout une réflexion sur trois éléments : l’enthousiasme, les passions, la vertu. L’enthousiasme n’est plus seulement la force platonicienne qui inspire les poètes, c’est l’ardeur universelle, le dynamisme, la force qui anime aussi bien la matière en mouvement, le boulanger au pétrin et au fournil, l’amant ou l'artiste. Qu’on ajoute seulement à cette notion un peu du spiritualisme de Swedenborg et de Louis-Claude de Saint-Martin, on arrivera à l’« énergie » balzacienne. A cette énergie générale s’ajoute celle des passions : « Nous ressemblons à de vrais instruments, dont les passions sont les cordes. » Commence alors l’apologie des passions fortes, que toute l’œuvre de Diderot confirmera. C'est aussi dans l'Essai de Shaftesbury qu'il trouve la conception de la vertu qu’il fera sienne jusqu’à l’obsession : la vertu n’est pas liée forcément à la religion, l’athée peut être vertueux; le juste et l’injuste, le bien et le mal sont des notions naturelles, antérieures à toute hypothèse divine; le vertueux est celui dont les tendances sont conformes au bien général de l'espèce, la vertu unit le plaisir naturel personnel et l’utilité sociale dans la joie de faire ou voir faire une belle action. Cette philosophie de l’enthousiasme et des passions convient à son ardeur naturelle, à l’élan de dévoration qui le pousse vers tout, idées, femmes, nourriture. Cette morale de la vertu convient à sa bonté, à sa générosité. Diderot sort tout armé de l'Essai de Shaftesbury comme Minerve du cerveau de Jupiter.
C’est dans le prolongement de cette traduction qu’il compose d'un trait, en quelques jours du printemps 1746, sa première œuvre personnelle, les Pensées philosophiques. Pensées, mais philosophiques : réplique à Pascal pour lui opposer l’apologie des passions, la critique de l’ascétisme; mais, avant tout, dialogue à quatre voix entre un chrétien, un déiste, un sceptique et un athée. On pourrait croire que la palme revient au déiste; en fait, derrière les précautions de style imposées par la crainte de la censure, les arguments de l'athée sont privilégiés : pourquoi le mouvement des atomes n’aurait-il pas produit le monde tel que nous le voyons? C’était une possibilité de la matière; or, à l’échelle de l’infini et de l’éternel, toute probabilité devient nécessité. Inutile, donc, de recourir à Dieu pour expliquer le monde. Lucrèce était derrière cela, les pouvoirs ne s’y trompent pas, le livre est condamné par le parlement. Son auteur, dont on sait qu’il est engagé dans l’entreprise jugée subversive de l'Encyclopédie, travaille en outre à la Promenade du sceptique, « ouvrage encore plus dangereux contre la religion », au dire du curé de Saint-Médard, qui le dénonce à la police, déjà avertie qu’il est « un homme très dangereux ».
La Lettre sur les aveugles, parue en 1749, année où l’on arrête pêle-mêle et massivement les « mauvais esprits », vaut à Diderot un été dans le donjon de Vincen-nes. Cette fois, même si la parole était prêtée au géomètre aveugle Saunderson délirant avant de mourir, la pensée matérialiste s’épanouissait : l’homme n’est qu’un hasard de l’organisation de la matière par elle-même; le monde que nous voyons n’est qu’un instant de l’éternel mouvement des atomes. La morale dépend des sens : un aveugle n’a pas la même morale qu’un homme qui voit clair. Une image de l’homme se précise : non plus celle de l’homme abstrait du rationalisme classique, mais celle de l’homme vivant, être de chair et de matière, agrégat d’atomes mouvants dans un monde en mouvement; chaque être est différent des autres; chacun est différent de soi-même selon les heures et les circonstances.
L’emprisonnement porta un coup moral à Diderot, mais l’écriture, pour lui, était une activité physique et biologique, comme marcher ou manger, voire une activité d’ordre quasi érotique. Il se jure et il jure à son père d'être désormais prudent; il se masque, et, derrière les masques, la pensée apparaît clairement. Dans l’hiver 1753-1754, l’essai De l'interprétation de la nature poursuit la mise au point progressive de sa vision matérialiste du monde. Nécessité, déterminisme, évolution des espèces, tout cela entraîne une conséquence logique, difficilement admissible : la négation de la liberté de l’homme. C’est ce qu’il expose en 1756 dans une lettre au dramaturge Landois. Une telle conséquence devrait mener au désespoir, au découragement. Pourtant, les hommes vivent. Alors, de même que Montaigne, l’un de ses auteurs préférés, abandonna son insoluble méditation sur la mort pour regarder mourir calmes et résignés les paysans de Castillon touchés par la peste, Diderot regarde les hommes vivre. Il ne veut pas être prisonnier d’un système. La réflexion philosophique, de 1760 à 1765, se double donc d’une soudaine explosion de la création romanesque : ia Religieuse, le Neveu de Rameau, Jacques le Fataliste sont mis en chantier. Tout cela ponctué de la mort de trois enfants successivement, de la mort de sa mère en 1748, de la mort de son père en 1759, des tracas et des dangers inhérents à l’Encyclopédie, de la naissance en 1753 de sa fille Angélique — la seule qui survivra —, de la rencontre de Sophie Volland. Il a trente-six ans, elle en a trente-neuf lorsqu’elle entre dans sa vie, petite, potelée, avec ses besicles et sa « menotte sèche ». S’il est Socrate, comme l’appellent ses amis, elle sera Diotima, l’âme-sœur, la confidente, la maîtresse. Tout cela ponctué aussi des essais de drame bourgeois (le Fils naturel, le Père de famille), des premiers commentaires des Salons de peinture écrits pour faire plaisir à Grimm, de la méditation sur les « ballets d’action » de Noverre et la pantomime, sur le métier d’acteur du comédien anglais Garrick, sur le pathétique des romans de Richardson.
De la chimie à Sénèque
En 1769, la trilogie du Rêve de d'Alembert répond aux questions posées en 1754, à la fin de l’essai De l'interprétation de la nature, sur l’origine de la vie, la structure de la matière, l’organisation des êtres. Entretemps, Diderot a suivi les cours de « chimie des affinités » de Rouelle, ainsi que des cours de chirurgie; il a beaucoup rencontré les médecins Bordeu et Tronchin; il a lu le volumineux ouvrage de physiologie de von Haller. La vision matérialiste du monde tirée de Lucrèce et fondée sur le mouvement fortuit des atomes fait place à une autre vision, plus scientifique, plus totale : le secret de la vie de la matière est dans les forces chimiques. L’homme et le monde ne sont que le lieu d’actions et de réactions continuelles, de rapports entre les éléments qui composent la matière. Finie la matière homogène de Descartes, fini le monde mécanique et physique de Newton, où la matière en mouvement selon des lois mathématiques ne s’identifiait pas avec l’espace, sensorium de Dieu. Le monde est tout entier expliqué, dans son unité et sa diversité, par les affinités chimiques entre les éléments d’une matière hétérogène. La vie? la pensée? Processus chimiques. La physiologie et la biologie viennent en renfort. La « sensibilité » est partout dans la matière. Les êtres humains sont avant tout des corps; des corps-instruments mus par des passions-cordes. Ce ne sont pas seulement Descartes et Newton qui se trouvent périmés, mais aussi et surtout la Genèse selon la mythologie chrétienne, et toutes les écoles de théologie. Diderot est un philosophe de plus en plus « dangereux ». La trilogie du Rêve de d'Alembert, en rendant compte chimiquement et physiologiquement de tout l’homme et de l’univers entier, marque l’apogée de son matérialisme.
En même temps, le rude labeur de l’Encyclopédie étant terminé pour l’essentiel, il s’abandonne plus librement aux réflexions d’ordre esthétique. Les Salons, qui l’ennuyaient au début, « l’amusent ». Ceux de 1765 et 1767 sont de sa part l'objet de copieux commentaires. Parallèlement, les quelques centaines de tableaux racontés, arrangés, modifiés, forment une profusion de petits romans esquissés. A l’image de la matière, avec l’enthousiasme et l'énergie inhérents à chaque être, Diderot crée continuellement des êtres nouveaux, anime des vies nouvelles. De quarante-sept à soixante ans, de 1760 à 1772 environ, il est au plus abondant de sa création : contes, entretiens, dialogues, paradoxes, réflexions, lettres, etc., tous genres n’exigeant pas une construction fixe et achevée qui tuerait le plaisir de l’auteur et nierait sa conception de l’écriture vivante, enthousiaste, dynamique, à l’image de la nature elle-même. Il arrive à Diderot de gémir d’être obligé d’écrire pour d’autres, libraires ou amis : au service de l’Encyclopédie', au service de la Correspondance littéraire de Grimm; au service du baron d'Holbach, son ami, pour l’aider à rédiger le Système de la nature, qui sera la bible du matérialisme; au service de l’abbé Raynal pour collaborer à l'Histoire des deux Indes, premier grand manifeste anticolonialiste... Mais Térence aussi, dont il a fait l’éloge, était esclave : « Le vendeur lui dit : Et toi, que sais-tu? L’esclave lui répondit : commander aux hommes. Et le crieur se mit à crier : Qui veut un maître? » (Sur Térence.) Si valet soit-il, Diderot sait bien qu’il est le maître de ses maîtres, comme Térence, comme son personnage de Jacques le Fataliste. C’est la consolation de l’intellectuel; le seul grand voyage de sa vie l’obligea pourtant, un instant, à remettre en question cette consolation.
Parmi ses maîtres, il y avait l’impératrice Catherine II, qui lui avait acheté sa bibliothèque et ses papiers. Ayant en 1772 achevé la publication des derniers volumes de planches de l’Encyclopédie et bien marié sa fille Angélique à un maître de forges, Diderot se décide enfin à entreprendre le voyage de Pétersbourg. Il y trouvera la déception de découvrir en Catherine II un despote moins éclairé que prévu et comprendra qu’il a été victime d’une illusion. Il avait blâmé Sénèque, dans une de ses premières œuvres, d’être resté au service de Néron. Et voici qu’il se trouve, lui Diderot, dans la même situation. Justement, après son retour de Russie à la fin de 1774, son ami d’Holbach lui demande une étude sur Sénèque pour accompagner la traduction du grand stoïcien. Le discours sur Sénèque fournira à l’écrivain l’occasion d’une méditation sur soi-même, d’un ultime examen de conscience à soixante-cinq ans. Publié en 1778, complété en 1782, l’EssaZ sur les règnes de Claude et de Néron nous livre le dernier état de la pensée de Diderot. Le moraliste l’emporte sur le philosophe : le stoïcisme, accord avec soi-même et avec le monde, résignation lucide au déterminisme universel, est une attitude digne de l’homme. Diderot l’avait déjà prêtée à Jacques le Fataliste; il la fait sienne. Il comprend qu’il avait mal jugé Sénèque : qu’importe l’apparente servitude devant Néron ou Catherine II? L’intellectuel n’est responsable que devant lui-même et la postérité. Sénèque avait raison puisqu’il est encore grand après dix-huit siècles.
Réfutant le matérialisme trop sommaire du traité De l'homme d’Helvétius, Diderot, en 1782, se complaît à un mélange de matérialisme et de stoïcisme qui n’exclut pas, parfois, quelques embardées spinozistes, et qui eût sans doute encore évolué si la mort, deux ans après, en 1784, n’était venue « transformer » Sophie Volland en février et son ami en juillet au moment où, conformément au mouvement universel du monde, il reprenait, complétait, regroupait toutes ses œuvres dans l’intention d’en donner une édition complète qu’il n’eut pas le temps de réaliser.
De la chimie à Sénèque
En 1769, la trilogie du Rêve de d'Alembert répond aux questions posées en 1754, à la fin de l’essai De l'interprétation de la nature, sur l’origine de la vie, la structure de la matière, l’organisation des êtres. Entretemps, Diderot a suivi les cours de « chimie des affinités » de Rouelle, ainsi que des cours de chirurgie; il a beaucoup rencontré les médecins Bordeu et Tronchin; il a lu le volumineux ouvrage de physiologie de von Haller. La vision matérialiste du monde tirée de Lucrèce et fondée sur le mouvement fortuit des atomes fait place à une autre vision, plus scientifique, plus totale : le secret de la vie de la matière est dans les forces chimiques. L’homme et le monde ne sont que le lieu d’actions et de réactions continuelles, de rapports entre les éléments qui composent la matière. Finie la matière homogène de Descartes, fini le monde mécanique et physique de Newton, où la matière en mouvement selon des lois mathématiques ne s’identifiait pas avec l’espace, sensorium de Dieu. Le monde est tout entier expliqué, dans son unité et sa diversité, par les affinités chimiques entre les éléments d’une matière hétérogène. La vie? la pensée? Processus chimiques. La physiologie et la biologie viennent en renfort. La « sensibilité » est partout dans la matière. Les êtres humains sont avant tout des corps; des corps-instruments mus par des passions-cordes. Ce ne sont pas seulement Descartes et Newton qui se trouvent périmés, mais aussi et surtout la Genèse selon la mythologie chrétienne, et toutes les écoles de théologie. Diderot est un philosophe de plus en plus « dangereux ». La trilogie du Rêve de d'Alembert, en rendant compte chimiquement et physiologiquement de tout l’homme et de l’univers entier, marque l’apogée de son matérialisme.
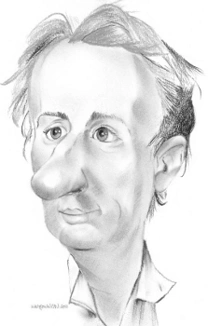
«
sans
fin ce rêve matérialiste dans lequel il se jette de
toute son énergie, savourant le plaisir -malgré les
moments de fatigue et de découragement -de vivre en
continuel mouvement dans un univers en mouvement
éternel.
Pour illustrer le destin, dans sa « rhapsodie » de
Jacques le Fataliste, Diderot emploie J'image d'un grand
rouleau des causes et des effets plutôt que celle, classi
que, d'un grand livre.
C'est qu'un livre a un début et une
fin et suppose quelqu'un qui l'a écrit -ce« quelqu'un »
qu'il a toujours refusé, sans parti pris ni hostilité systé
matique, simplement parce que cette hypothèse compli
quait et obscurcissait encore plus, et inutilement, l'in
terprétation de la nature, clef de la connaissance de
l' homme et son principal souci jusqu'à son dernier
souffle.
cc Un homme très dangereux >>
Langres, oll naquit Denis Diderot, était en 1713 un
puissant évêché; le frère de Denis, Didier, fut prêtre; une
de ses sœurs fut religieuse au couvent des ursulines, où
elle mourut folle à vingt-huit ans; Denis lui-même, élève
des jésuites de la ville, fut tonsuré à treize ans, «par
provision » (son oncle, chanoine, pensait qu'illui succé
derait).
Tl lui est arrivé de jeûner et même de porter
cilice.
Mais les Lan grois, a-t-il dit un jour, sont sensibles
aux variations météorologiq ues; le vent d'Est devait
pousser Diderot vers un autre destin : parti pour Paris
afin d'y devenir jésuite, il s'éprit de l'étude pour l'étude,
dédaignant les injonctions paternelles de se faire au
moins médecin ou avocat.
Ce départ pour Paris, à seize ans, après l'enfance à
Langres entre une mère dont il a peu parlé et un père,
artisan coutelier, qu'il admirait pour sa rigueur morale,
sa sensibilité et son honorabilité, marque le début d'une
vie passionnée, surmenée, tumultueuse, bien qu'elle se
déroule jusqu'à soixante ans dans le seul espace parisien,
si l'on excepte trois voyages à Langres pour affaires de
famille et tentatives de réconciliation avec son frère,
abbé fanatique.
Ce qu'il fit à Paris de seize à vingt-huit
ans, de 1728 à 1740, nous l'ignorons presque entière
ment : la maîtrise ès Arts de l'université de Paris, puis la
vie de bohème qu'il mena sont les seules certitudes.
Il
fut, semble-t-il, clerc de procureur et précepteur.
Hors
cela, des anecdotes, racontées par lui plus tard, mais
anecdotes significatives : comment il déclamait des tira
des de Molière dans le jardin du Luxembourg, comment
il se bouchait les oreilles au théâtre pour voir si les gestes
seuls des acteurs lui permettraient de comprendre la
pièce.
Et les joyeuses roueries auxquelles il se livrait
pour se procurer un peu d'argent.
En 1741, il rencontre une lingère, Anne-Toinette
Champion.
Son père lui ayant refusé 1' autorisation de se
marier avec elle, il l'épouse secrètement en 1743.
Elle
restera sa compagne jusqu'à la fin.
Diderot, qui connaît
l'anglais, fait des traductions pour nourrir le ménage.
«S i ce n'est pas de la gloire, c'est du bouillon », dira
son personnage du Neveu.
de Rameau.
En tout cas, c'est
le début d'une formation encyclopédique : histoire de la
Grèce, ouvrages de médecine, puis la Cyclopaedia de
Chambers, d'où allait naître l'immense entreprise de
l'Encyc lopédie [voir ENCYCLOPÉDIE].
En 1742, la rencon
tre avec Jean-Jacques Rousseau, pour quinze ans d'ami
tié avant une brouille retentissante, fait surgir de nouvel
les idées, de nouveaux échanges; sur la philosophie
sensualiste, en particulier, lorsque Condillac se joint à
eux.
Philosophiquement, la vraie vie commence en 1745 :
Diderot a trente-deux ans et traduit - très librement
- l'Essai sur Le mérite et La vertu du théiste anglais
Shaftesbury.
Ji y puise, pour toujours, quelques idées fondamentales
: d'abord, un nouvel encouragement à
lutter contre le fanatisme et la superstition; mais surtout
une réflexion sur trois éléments : 1 'enthousiasme, les
passions, la vertu.
L'enthousiasme n'est plus seulement
la force platonicienne qui inspire les poètes, c'est l'ar
deur universelle, le dynamisme, la force qui anime aussi
bien la matière en mouvement, le boulanger au pétrin et
au fournil, 1' amant ou l'artiste.
Qu'on ajoute seulement
à cette notion un peu du spiritualisme de Swedenborg et
de Louis-Claude de Saint-Martin, on arrivera à l'« éner
gie » balzacienne.
A cette énergie générale s'ajoute celle
des passions : « Nous ressemblons à de vrais instru
ments, dont les passions sont les cordes.
» Commence
alors l'apologie des passions fortes, que toute l'œuvre de
Diderot confirmera.
C'est aussi dans l'Essai de Shaftes
bury qu'il trouve la conception de la vertu qu'il fera
sienne jusqu'à l'obsession : la vertu n'est pas liée forcé
ment à la religion, 1' athée peut être vertueux; le juste et
l'injuste, le bien et le mal sont des notions naturelles,
antérieures à toute hypothèse divine; le vertueux est celui
dont les tendances sont conformes au bien général de
l'espèce, la vertu unit le plaisir naturel personnel et l'uti
lité sociale dans la joie de faire ou voir faire une belle
action.
Cette philosophie de l'enthousiasme et des pas
sions convient à son ardeur naturelle, à l'élan de dévora
tian qui le pousse vers tout, idées, femmes, nourriture.
Cette morale de la vertu convient à sa bonté, à sa généro
sité.
Diderot sort tout armé de 1 'Essai de Shaftesbury
comme Minerve du cerveau de Jupiter.
C'est dans le prolongement de cette traduction qu'il
compose d'un trait, en quelques jours du printemps 1746,
sa première œuvre personnelle, les Pensées philosophi
ques.
Pensées, mais philosophiques : réplique à Pascal
pour lui opposer l'apologie des passions, la critique de
l'ascétisme; mais, avant tout, dialogue à quatre voix
entre un chrétien, un déiste, un sceptique et un athée.
On
pourrait croire que la palme revient au déiste; en fait,
derrière les précautions de style imposées par la crainte
de la censure, les arguments de l'athée sont privilégiés :
pourquoi le mouvement des atomes n'aurait-il pas pro
duit le monde tel que nous le voyons? C'était une possi
bilité de la matière; or, à l'échelle de l'inf ini et de l'éter
nel, toute probabilité devient nécessité.
Inutile, donc, de
recourir à Dieu pour expliquer le monde.
Lucrèce était
derrière cela, les pouvoirs ne s'y trompent pas, le livre
est condamné par le parlement.
Son auteur, dont on sait
qu'il est engagé dans l'entreprise jugée subversive de
1' Encyclopédie, travaille en outre à la Promenade du
scept ique, « ouvrage encore plus dangereux contre la
religion ''· au dire du curé de Saint-Médard, qui le
dénonce à la police, déjà avertie qu'il est «un homme
très dangereux ».
La Lettre sur Les aveugles, parue en 1749, année où
l'on arrête pêle-mêle et massivement les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- PARADOXE SUR LE COMÉDIEN de Denis Diderot (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Religieuse (la). Roman de Denis Diderot (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Neveu de Rameau (le) de Denis Diderot (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- SAINT-ÉVREMOND, Charles de Marguetel de Saint Denis, seigneur de (vie et oeuvre)

































