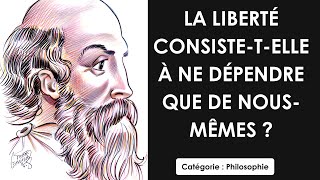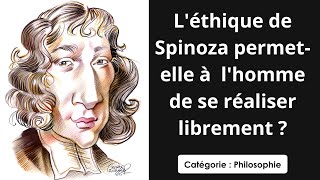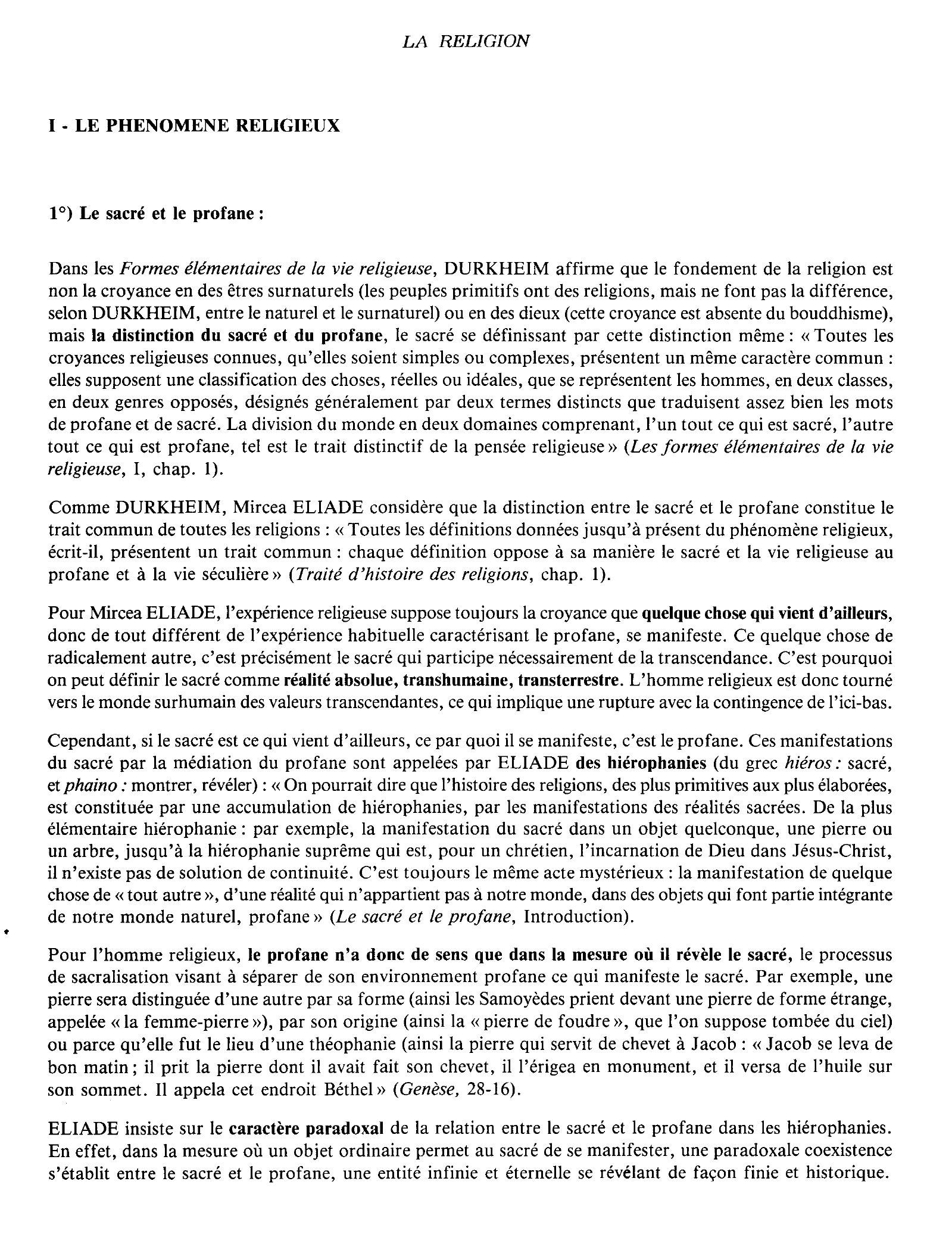Eléments de cours: LA RELIGION ?
Publié le 27/07/2009
Extrait du document

Foi religieuse et raison démonstrative sont souvent difficilement conciliables. Les philosophes chrétiens ont dû, notamment, faire effort pour concilier avec leur croyance en l'existence d'un Dieu tout-puissant la réalité du mal dans le monde. «Si les boeufs et les chevaux et les lions, écrivait Xénophane (vie siècle av. J.-C.), avaient aussi des mains, et si avec ces mains, ils savaient dessiner, et savaient modeler les oeuvres qu'avec art seuls les hommes façonnent, les chevaux forgeraient des dieux chevalins, et les boeufs donneraient aux dieux forme bovine«.

«
LA RELIGION
1 -LE PHENOMENE RELIGIEUX
1
°) Le sacré et le profane :
Dans les
Formes élémentaires de la vie religieuse, DURKHEIM affirme que le fondement de la religion est
non la croyance en des êtres surnaturels (les peuples primitifs
ont des religions, mais ne font pas la différence,
selon DURKHEIM, entre
le naturel et le surnaturel) ou en des dieux (cette croyance est absente du bouddhisme),
mais
la distinction du sacré et du profane, le sacré se définissant par cette distinction même : «Toutes les
croyances religieuses connues, qu'elles soient simples ou complexes, présentent un même caractère commun:
elles supposent une classification des choses, réelles ou idéales, que se représentent les hommes, en deux classes,
en deux genres opposés, désignés généralement par deux termes distincts que traduisent assez bien
les mots
de profane et de sacré.
La division du monde en deux domaines comprenant, l'un tout ce qui est sacré, l'autre
tout ce qui est profane, tel est le trait distinctif de la pensée religieuse » (Les formes élémentaires de la vie
religieuse,
I, chap.
1).
Comme DURKHEIM, Mircea ELIADE considère que la distinction entre le sacré et le profane constitue le
trait commun de toutes
les religions : «Toutes les définitions données jusqu'à présent du phénomène religieux,
écrit-il, présentent
un trait commun : chaque définition oppose à sa manière le sacré et la vie religieuse au
profane et à la vie
séculière» (Traité d'histoire des religions, chap.
1).
Pour Mircea ELIADE, l'expérience religieuse suppose toujours la croyance que quelque chose qui vient d'ailleurs,
donc de tout différent de l'expérience habituelle caractérisant
le profane, se manifeste.
Ce quelque chose de
radicalement autre, c'est précisément le sacré qui participe nécessairement de la transcendance.
C'est pourquoi
on peut définir
le sacré comme réalité absolue, transhumaine, transterrestre.
L'homme religieux est donc tourné
vers
le monde surhumain des valeurs transcendantes, ce qui implique une rupture avec la contingence de l'ici-bas.
Cependant,
si le sacré est ce qui vient d'ailleurs, ce par quoi il se manifeste, c'est le profane.
Ces manifestations
du sacré
par la médiation du profane sont appelées par ELIADE des hiérophanies (du grec hiéros: sacré,
et
phaino: montrer, révéler) : «On pourrait dire que l'histoire des religions, des plus primitives aux plus élaborées,
est constituée par une accumulation de hiérophanies, par
les manifestations des réalités sacrées.
De la plus
élémentaire hiérophanie : par exemple, la manifestation du sacré dans
un objet quelconque, une pierre ou
un arbre,
jusqu'à la hiérophanie suprême qui est, pour un chrétien, l'incarnation de Dieu dans Jésus-Christ,
il n'existe pas de solution de continuité.
C'est toujours le même acte mystérieux: la manifestation de quelque
chose
de« tout autre», d'une réalité qui n'appartient pas à notre monde, dans des objets qui font partie intégrante
de notre monde naturel,
profane» (Le sacré et le profane, Introduction).
Pour l'homme religieux, le profane n'a donc de sens que dans la mesure où il révèle le sacré, le processus
de sacralisation visant à séparer de son environnement profane
ce qui manifeste le sacré.
Par exemple, une
pierre sera distinguée
d'une autre par sa forme (ainsi les Samoyèdes prient devant une pierre de forme étrange,
appelée« la femme-pierre»), par son origine (ainsi la« pierre de foudre», que l'on suppose tombée du ciel)
ou parce qu'elle fut le lieu d'une théophanie (ainsi la pierre qui servit de chevet à Jacob: «Jacob se leva de
bon
matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'érigea en monument, et il versa de l'huile sur
son sommet.
Il appela cet endroit Béthel
» (Genèse, 28-16).
ELIADE insiste sur le caractère paradoxal de la relation entre le sacré et le profane dans les hiérophanies.
En effet, dans la mesure
où un objet ordinaire permet au sacré de se manifester, une paradoxale coexistence
s'établit entre
le sacré et le profane, une entité infinie et éternelle se révélant de façon finie et historique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA RELIGION (cours de philosophie)
- La religion - RÉSUMÉ DE COURS
- Cours de philosophie sur la religion
- Fiche de cours en philo : LA RELIGION .
- Notes de cours: LA RELIGION