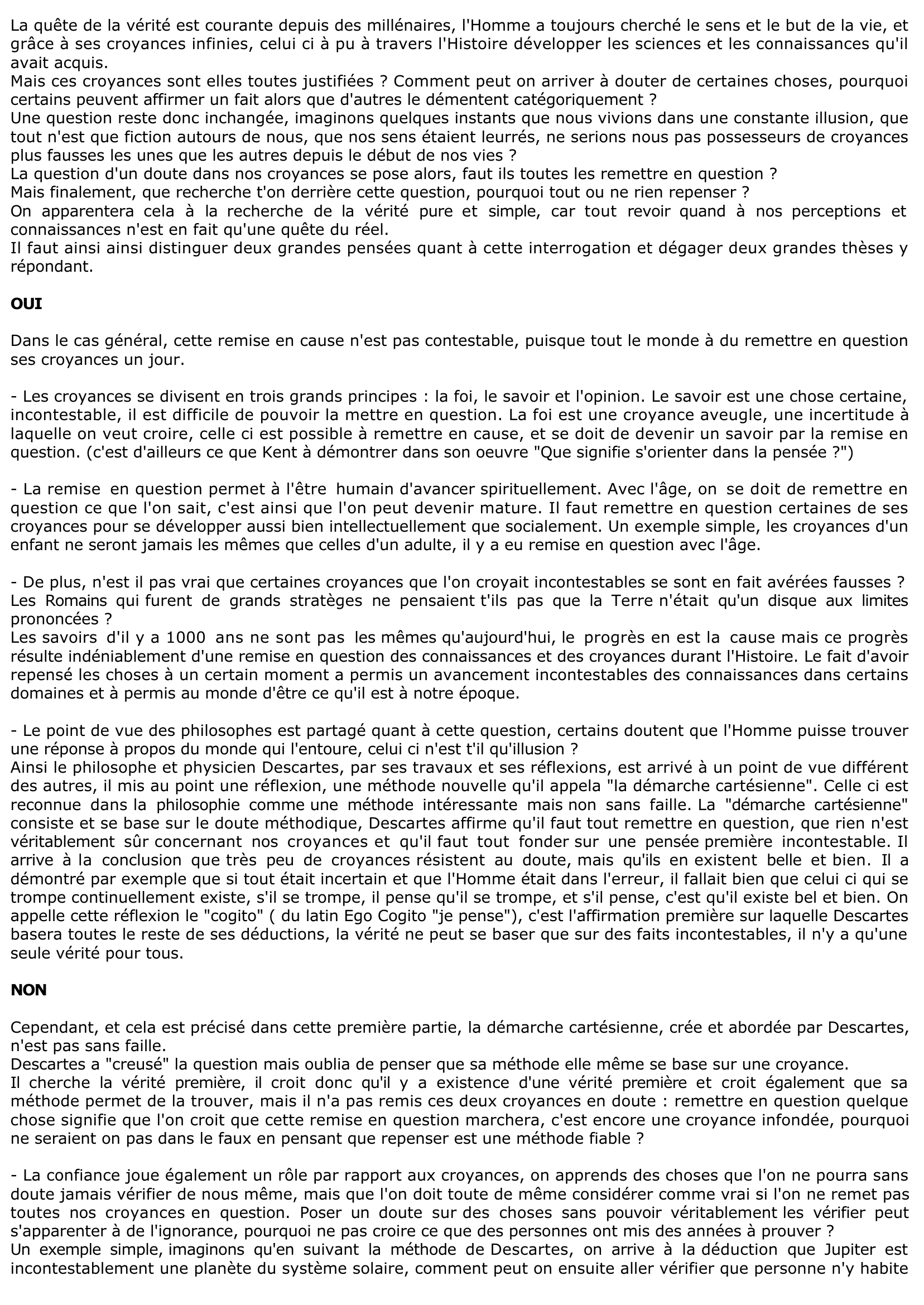Faut-il mettre en question toutes nos croyances ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document


«
La quête de la vérité est courante depuis des millénaires, l'Homme a toujours cherché le sens et le but de la vie, etgrâce à ses croyances infinies, celui ci à pu à travers l'Histoire développer les sciences et les connaissances qu'ilavait acquis.Mais ces croyances sont elles toutes justifiées ? Comment peut on arriver à douter de certaines choses, pourquoicertains peuvent affirmer un fait alors que d'autres le démentent catégoriquement ?Une question reste donc inchangée, imaginons quelques instants que nous vivions dans une constante illusion, quetout n'est que fiction autours de nous, que nos sens étaient leurrés, ne serions nous pas possesseurs de croyancesplus fausses les unes que les autres depuis le début de nos vies ?La question d'un doute dans nos croyances se pose alors, faut ils toutes les remettre en question ?Mais finalement, que recherche t'on derrière cette question, pourquoi tout ou ne rien repenser ?On apparentera cela à la recherche de la vérité pure et simple, car tout revoir quand à nos perceptions etconnaissances n'est en fait qu'une quête du réel.Il faut ainsi ainsi distinguer deux grandes pensées quant à cette interrogation et dégager deux grandes thèses yrépondant.
OUI
Dans le cas général, cette remise en cause n'est pas contestable, puisque tout le monde à du remettre en questionses croyances un jour.
- Les croyances se divisent en trois grands principes : la foi, le savoir et l'opinion.
Le savoir est une chose certaine,incontestable, il est difficile de pouvoir la mettre en question.
La foi est une croyance aveugle, une incertitude àlaquelle on veut croire, celle ci est possible à remettre en cause, et se doit de devenir un savoir par la remise enquestion.
(c'est d'ailleurs ce que Kent à démontrer dans son oeuvre "Que signifie s'orienter dans la pensée ?")
- La remise en question permet à l'être humain d'avancer spirituellement.
Avec l'âge, on se doit de remettre enquestion ce que l'on sait, c'est ainsi que l'on peut devenir mature.
Il faut remettre en question certaines de sescroyances pour se développer aussi bien intellectuellement que socialement.
Un exemple simple, les croyances d'unenfant ne seront jamais les mêmes que celles d'un adulte, il y a eu remise en question avec l'âge.
- De plus, n'est il pas vrai que certaines croyances que l'on croyait incontestables se sont en fait avérées fausses ?Les Romains qui furent de grands stratèges ne pensaient t'ils pas que la Terre n'était qu'un disque aux limitesprononcées ?Les savoirs d'il y a 1000 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, le progrès en est la cause mais ce progrèsrésulte indéniablement d'une remise en question des connaissances et des croyances durant l'Histoire.
Le fait d'avoirrepensé les choses à un certain moment a permis un avancement incontestables des connaissances dans certainsdomaines et à permis au monde d'être ce qu'il est à notre époque.
- Le point de vue des philosophes est partagé quant à cette question, certains doutent que l'Homme puisse trouverune réponse à propos du monde qui l'entoure, celui ci n'est t'il qu'illusion ?Ainsi le philosophe et physicien Descartes, par ses travaux et ses réflexions, est arrivé à un point de vue différentdes autres, il mis au point une réflexion, une méthode nouvelle qu'il appela "la démarche cartésienne".
Celle ci estreconnue dans la philosophie comme une méthode intéressante mais non sans faille.
La "démarche cartésienne"consiste et se base sur le doute méthodique, Descartes affirme qu'il faut tout remettre en question, que rien n'estvéritablement sûr concernant nos croyances et qu'il faut tout fonder sur une pensée première incontestable.
Ilarrive à la conclusion que très peu de croyances résistent au doute, mais qu'ils en existent belle et bien.
Il adémontré par exemple que si tout était incertain et que l'Homme était dans l'erreur, il fallait bien que celui ci qui setrompe continuellement existe, s'il se trompe, il pense qu'il se trompe, et s'il pense, c'est qu'il existe bel et bien.
Onappelle cette réflexion le "cogito" ( du latin Ego Cogito "je pense"), c'est l'affirmation première sur laquelle Descartesbasera toutes le reste de ses déductions, la vérité ne peut se baser que sur des faits incontestables, il n'y a qu'uneseule vérité pour tous.
NON
Cependant, et cela est précisé dans cette première partie, la démarche cartésienne, crée et abordée par Descartes,n'est pas sans faille.Descartes a "creusé" la question mais oublia de penser que sa méthode elle même se base sur une croyance.Il cherche la vérité première, il croit donc qu'il y a existence d'une vérité première et croit également que saméthode permet de la trouver, mais il n'a pas remis ces deux croyances en doute : remettre en question quelquechose signifie que l'on croit que cette remise en question marchera, c'est encore une croyance infondée, pourquoine seraient on pas dans le faux en pensant que repenser est une méthode fiable ?
- La confiance joue également un rôle par rapport aux croyances, on apprends des choses que l'on ne pourra sansdoute jamais vérifier de nous même, mais que l'on doit toute de même considérer comme vrai si l'on ne remet pastoutes nos croyances en question.
Poser un doute sur des choses sans pouvoir véritablement les vérifier peuts'apparenter à de l'ignorance, pourquoi ne pas croire ce que des personnes ont mis des années à prouver ?Un exemple simple, imaginons qu'en suivant la méthode de Descartes, on arrive à la déduction que Jupiter estincontestablement une planète du système solaire, comment peut on ensuite aller vérifier que personne n'y habite.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Projet : Jeu électrique Question - réponse PRESENTATION GENERALE Evénement déclencheur : Besoin de mettre en place un jeu pour tester les connaissances en histoire et dans d'autres disciplines à long terme.
- La question philosophique choisie ici est « Faut-il se faire des illusions pour être heureux ?
- Est-il juste d’affirmer que pour bien comprendre autrui il faut tenter de se mettre à sa place?
- • Se poser la question de savoir si la nature fait bien les choses, c'est se demander s'il faut rester naturel, ou si, au contraire, il faut dépasser le donné, et pour quelles raisons.
- Le mode de l'écrit Des apprentissages progressifs Apprendre à écrire Au cycle 3, il faut mettre l'élève en situation de rédiger des textes plus complexes qui correspondent à des modèles textuels.