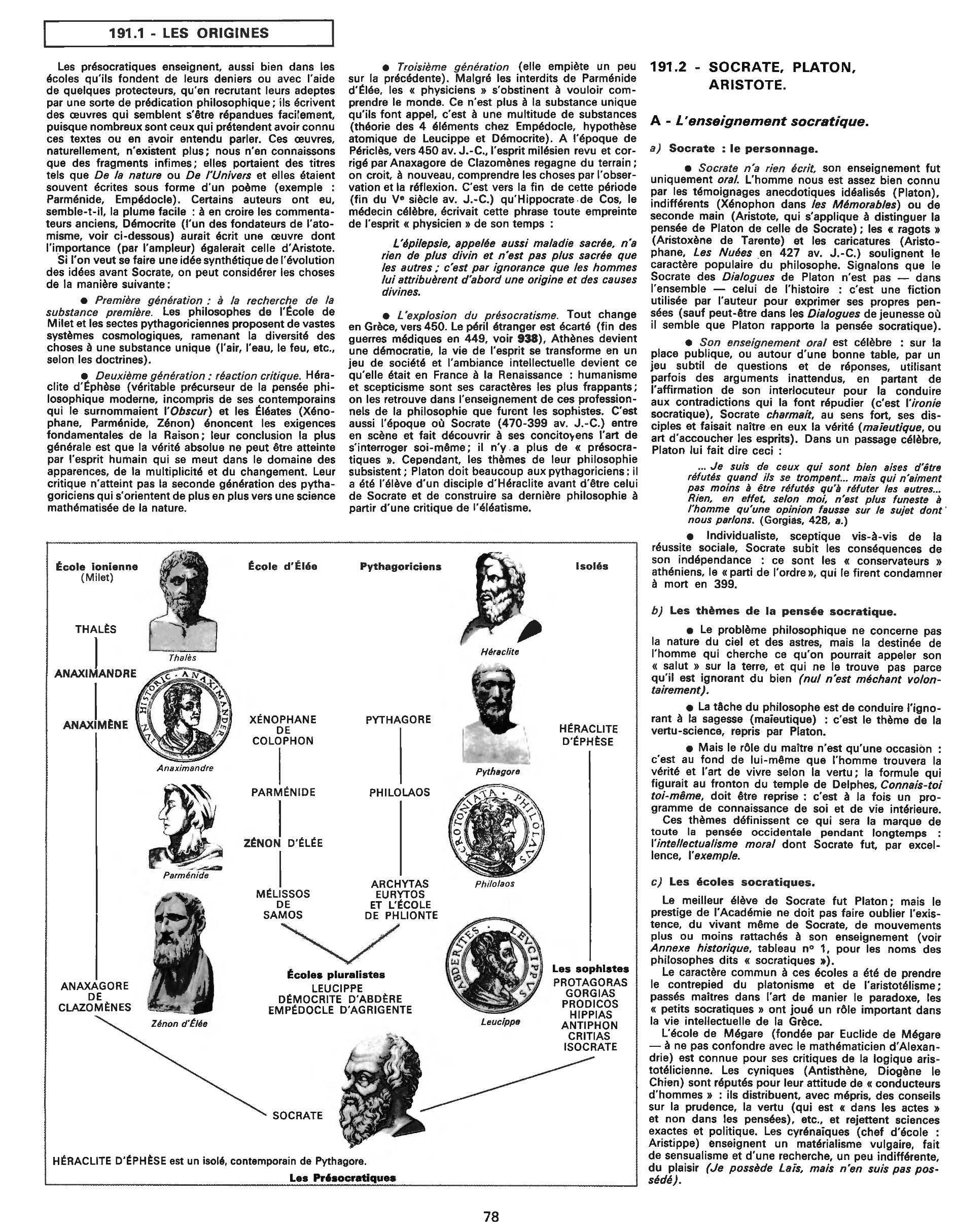HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
Publié le 01/04/2012
Extrait du document

• L'Être et le Néant s'achève sur une analyse de l'action et de la liberté. L'homme est libre parce qu'en lui l'existence précède l'essence ; le pour-soi se réalise par une succession de conduites négatives. Le poids du passé et de la situation ne détermine pas l'homme, il lui permet au contraire de s'affirmer comme libre en assumant la situation : la liberté, c'est l'acte par lequel je choisis ma situation, je m'engage
en elle. Dire que l'homme est conditionné par des motifs ou des mobiles ne veut rien dire : un motif doit être éprouvé comme tel pour être un motif, il ne cause pas l'acte, il en fait partie : la liberté est une « totalité inanalysable « (p. 529), une sorte de libre arbitre absolu et non un choix délibéré comme la liberté éclairée de Descartes, elle est en nom dans tous nos actes : l'homme est condamné à la liberté. En ce sens Il porte le poids du monde tout entier sur ses épaules (p. 639).

«
191.1 - LES ORIGINES
Les présocratiques enseignent, aussi bien dans les
écoles qu'ils fondent de leurs deniers ou avec l'aide de quelques protecteurs, qu'en recrutant leurs adeptes
par une sorte de prédication philosophique; ils écrivent
des œuvres qui semblent s'être répandues facilement, puisque nombreux sont ceux qui prétendent avoir connu
ces textes ou en avoir entendu parler.
Ces œuvres ,
naturellement , n'existent
plus; nous n'en connaissons
que des fragments infimes; elles portaient des titres
tels que De la nature ou De l'Univers et elles étaient
souvent écrites sous forme d'un poème (exemple : Parménide, Empédocle).
Certains auteurs ont eu,
semble-t -il, la plume facile : à en croire les commenta
teurs anciens , Démocrite (l'un des fondateurs de l'ato misme, voir ci-dessous) aurait écrit une œuvre dont l'importance (par l'ampleur) égalerait celle d'Aristote.
·si l'on veut se faire une idée synthétique de l'évolution
des idées avant Socrate , on peut considérer les choses
de
la manière suivante :
• Première génération : à la recherche de la substance première.
Les philosophes de l'École de Milet et les sectes pythagoriciennes proposent de vastes
systèmes cosmologiques, ramenant la diversité des
choses à une substance unique (l'air, l'eau, le feu, etc.,
selon les doctrines) .
• Deuxième génération: réaction critique.
Héra
clite d'Éphèse (véritable précurseur de la pensée phi losophique moderne, incompris de ses contemporains qui le surnommaient l'Obscur) et les Éléates (Xéno
phane, Parménide, Zénon) énoncent les exigences
fondamentales de la Raison; leur conclusion la plus
générale est que la vérité absolue ne peut être atteinte
par l'esprit humain qui se meut dans le domaine des
apparences, de la multiplicité et du changement.
Leur
critique n'atteint pas la seconde génération des pytha goriciens qui s'orientent de plus en plus vers une science
mathématisée de la nature.
École ionienne (Milet)
THALÈS
1 ANAXIMANDRE
1 ANAXIMÈNE
École d'Élée
XÉNOPHANE DE COLOPHON
1 PARMÉNIDE
1 ZÉNON D'ÉLÉE
1 MÉLISSOS DE SAMOS
• Troisième génération (elle empiète un peu
sur la précédente) .
Malgré les interdits de Parménide d'Élée, les « physiciens » s'obstinent à vouloir com prendre le monde.
Ce n'est plus à la substance unique
qu'ils font appel , c'est à une multitude de substances
(théorie des 4 éléments chez Empédocle, hypothèse
atomique de Leucippe et Démocrite) .
A l'époque de Périclès , vers 450 av.
J.- C ., l'esprit milésien revu et cor rigé par Anaxagore de Clazomènes regagne du terrain; on croit , à nouveau, comprendre les choses par l'obser vation et la réflexion .
C 'est vers la fin de cette période
(fin du V• siècle av.
J.-C .) qu 'Hippocrate de Cos, le
médecin célèbre, écrivait cette phrase toute empreinte
de
l'esprit « physicien »de son temps :
L'épilepsie, appelée aussi maladie sacrée, n'a
rien de plus divin et n'est pas plus sacrée que les autres ; c' est par ignorance que les hommes lui attribuèrent d'abord une origine et des causes
divines.
• L'explosion du présocratisme .
Tout change en Grèce, vers 450 .
Le péril étranger est écarté (fin des
guerres médiques en 449 , voir 938), Athènes devient
une démocratie , la vie de l'esprit se transforme en un
jeu de société et l'ambiance intellectuelle devient ce qu'elle était en France à la Renaissance : humanisme
et scepticisme sont ses caractères les plus frappants;
on les retrouve dans l'enseignement de ces profession
nels de
la philosophie que furent les soph istes .
C'est
aussi l'époque où Socrate (470-399 av.
J. -C.) entre
en scène et fait découvrir à ses concito'yens l'art de
s'interroger soi-même; il n'y .
a plus de « présocra
tiques » .
Cependant , les thèmes de leur philosophie
subsistent ; Platon doit beaucoup aux pythagoriciens : il
a été l' élève d'un disciple d'Héraclite avant d'être celui
de Socrate et de construire sa dernière philosophie à
partir d'une critique de l'éléatisme.
Pythagoriciens
PYTHAGORE
PHILO LAOS
ARCHYTAS EURYTOS ET L'ÉCOLE DE PHLIONTE
Hérac li te
P yth agor e
Philo/a as
Isolés
HÉRACLITE D'ÉPHÈSE
~
ANAXAGORE DE CLAZOMÈNES
Écoles pluralistes LEUCIPPE DÉMOCRITE D 'ABDÈRE EMPÉDOCLE D 'AGRIGENTE
SOCRATE
HÉRACLITE D'ÉPHÈSE est un isolé, contemporain de Pythagore.
Les Présocratiques
Leu cippe
78
Les sophistes PROTAGORAS
GORGIAS
PRODICOS
HIPPIAS
ANTIPHON CRITIAS
ISOCRATE
191.2 -SOCRATE, PLATON,
ARISTOTE.
A - L'enseignement socratique.
a) Socrate : le personnage.
• Socrate n'a rien écrit.
son enseignement fut uniquement oral.
L'homme nous est assez bien connu
par les témoignages anecdotiques idéalisés (Platon), indifférents (Xénophon dans les Mémorables) ou de
seconde main (Aristote , qui s'applique à distinguer la pensée de Platon de celle de Socrate) ; les « ragots » (Ar istoxène de Tarente) et les caricatures (Aristo phane, Les Nuées en 427 av.
J.- C.) soulignent le
caractère populaire du philosophe.
Signalons que le
Socrate des
Dialogues de Platon n'est pas -dans l'ensemble - celui de l'histoire : c'est une fiction utilisée par l'auteur pour exprimer ses propres pen
sées (sauf peut-être dans les Dialogues de jeunesse où
il semble que Platon rapporte la pensée socratique).
• Son enseignement oral est célèbre : sur la place publique, ou autour d'une bonne table, par un
jeu subtil de questions et de réponses, utilisant
parfois des arguments inattendus, en partant de
l ' affirmation de son interlocuteur
pour la conduire
aux contradictions qui la font répudier (c'est l' ironie socratique), Socrate charmait, au sens fort , ses dis
ciples et faisait naître en eux la vérité (maïeutique , ou
art d'accoucher les esprits).
Dans un passage célèbre,
Platon lui fait dire ceci :
...
Je suis de ceux qui sont bien aises d' être réfutés quand ils se trompent ...
mais qui n'aiment
pas moins à être réfutés qu'à réfuter les autres . ..
Rien.
en effet.
selon moi, n'est plus funeste à l'homme qu'une opinion fausse sur le sujet dont· nous parlons .
(Gorgias, 428, a.)
e Individualiste , sceptique vis-à-vis de la réussite sociale, Socrate subit les conséquences de
son indépendance : ce sont les « conservateurs » athéniens, le «parti de l'ordre», qui le firent condamner
à mort en 399.
b) Les thèmes de la pensée socratique.
• Le problème philosophique ne concerne pas la nature du ciel et des astres , mais la destinée de l'homme qui cherche ce qu'on pourrait appeler son « salut » sur la terre, et qui ne le trouve pas parce qu'il est ignorant du bien (nul n'est méchant volon
tairement) .
e La tâche du philosophe est de conduire l'igno rant à la sagesse (maïeutique) : c'est le thème de la vertu-science, repris par Platon.
•
Mais le rôle du maître n'est qu'une occasion :
c'est au fond de lui-même que l'homme trouvera la vérité et l'art de vivre selon la vertu; la formule qui
figurait au fronton du temple de Delphes , Connais-toi
toi-même , doit être reprise : c'est à la fois un pro gramme de connaissance de soi et de vie intérieure.
Ces thèmes définissent ce qui sera la marque de
toute la pensée occidentale pendant longtemps : l'intellectualisme moral dont Socrate fut, par excel
lence, l'exemple .
c) Les écoles socratiques.
Le meilleur élève de Socrate fut Platon ; mais le
prestige de l' Académie ne doit pas faire oublie r l'exis tence, du vivant même de Socrate, de mouvements
plus ou moins rattachés à son enseignement (voir Annexe historique , tableau no 1, pour les noms des
philosophes dits « socratiques »).
Le caractère commun à ces écoles a été de prendre
le contrepied du platonisme et de l'aristotélisme;
passés maîtres dans l'art de manier le paradoxe, les « petits socratiques » ont joué un rôle important dans la vie intellectuelle de la Grèce.
L'école de Mégare (fondée par Euclide de Mégare
-à ne pas confondre avec le mathématicien d'Alexan
drie) est connue pour ses critiques de la logique aris
totélicienne.
Les cyniques (Antisthène , Diogène le
Chien) sont réputés pour leur attitude de «conducteurs d'hommes » : ils distribuent, avec mépri s, des conseils
sur la prudence , la vertu (qui est « dans les actes » et non dans les pensées), etc., et rejettent sciences
exactes et politique.
Les cyrénaïques (chef d'école :
Aristippe) enseignent un matérialisme vulgaire, fait de sensualisme et d'une recherche, un peu indifférente ,
du plaisir (Je possède Lais, mais n'en suis pas pos sédé) ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- À propos de l'histoire de la philosophie (I).
- Philosophie de l’histoire et idée de progrès
- LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre
- LEÇONS SUR LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre
- PRINCIPES D’UNE SCIENCE NOUVELLE RELATIVE A LA NATURE DES NATIONS ou PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE, Giambattista Vico