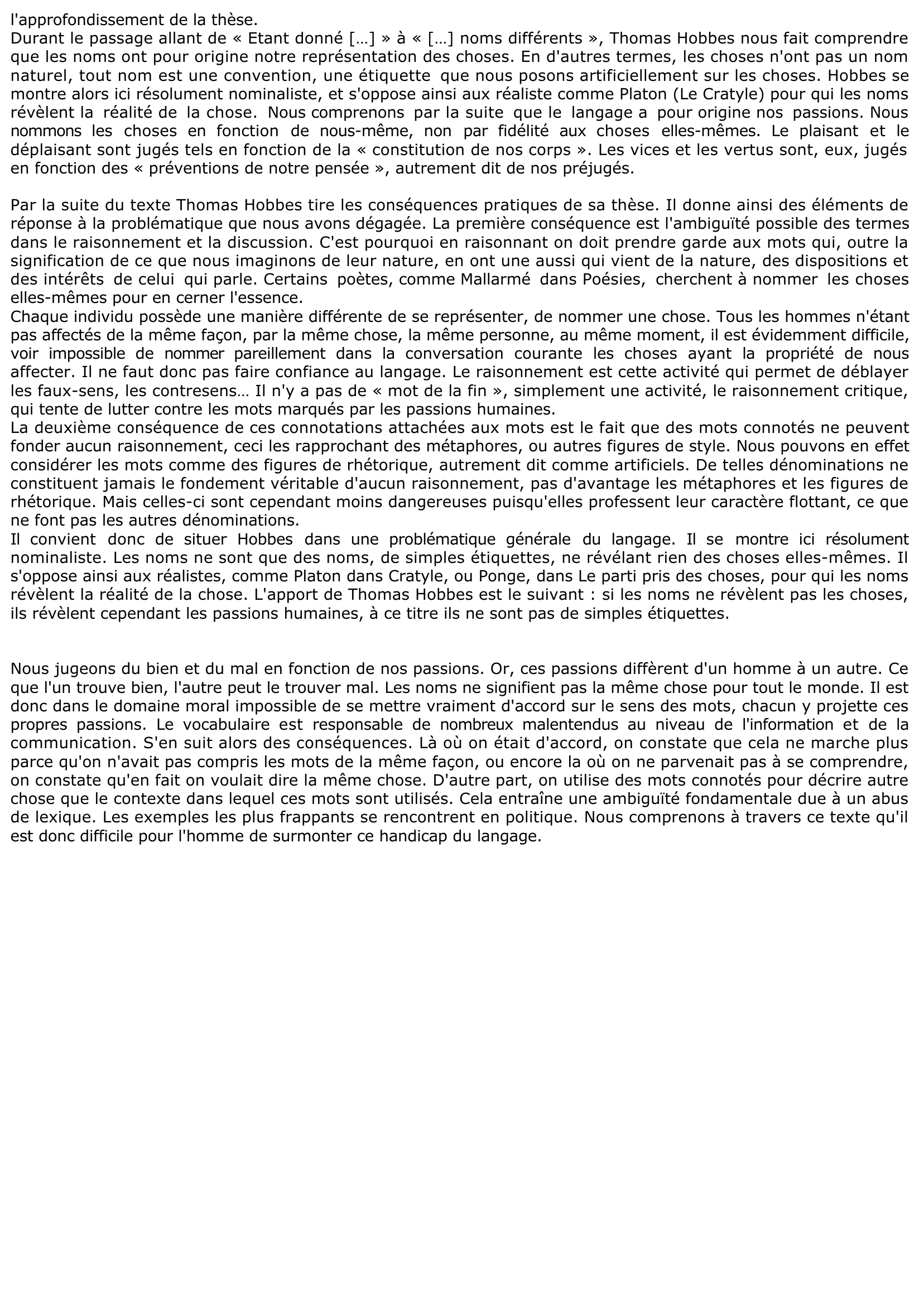Hobbes et le nominalisme
Publié le 17/04/2009

Extrait du document
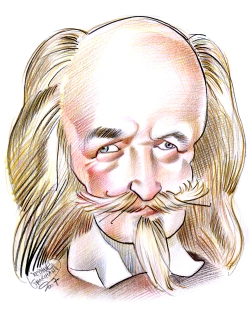
HTML clipboardNous jugeons du bien et du mal en fonction de nos passions. Or, ces passions diffèrent d’un homme à un autre. Ce que l’un trouve bien, l’autre peut le trouver mal. Les noms ne signifient pas la même chose pour tout le monde. Il est donc dans le domaine moral impossible de se mettre vraiment d’accord sur le sens des mots, chacun y projette ces propres passions. Le vocabulaire est responsable de nombreux malentendus au niveau de l'information et de la communication. S’en suit alors des conséquences. Là où on était d'accord, on constate que cela ne marche plus parce qu’on n'avait pas compris les mots de la même façon, ou encore la où on ne parvenait pas à se comprendre, on constate qu'en fait on voulait dire la même chose. D'autre part, on utilise des mots connotés pour décrire autre chose que le contexte dans lequel ces mots sont utilisés. Cela entraîne une ambiguïté fondamentale due à un abus de lexique. Les exemples les plus frappants se rencontrent en politique. Nous comprenons à travers ce texte qu’il est donc difficile pour l’homme de surmonter ce handicap du langage.
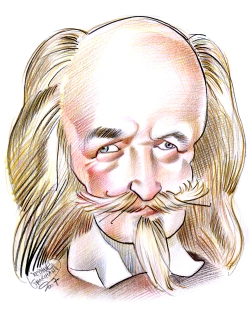
«
l'approfondissement de la thèse.Durant le passage allant de « Etant donné […] » à « […] noms différents », Thomas Hobbes nous fait comprendreque les noms ont pour origine notre représentation des choses.
En d'autres termes, les choses n'ont pas un nomnaturel, tout nom est une convention, une étiquette que nous posons artificiellement sur les choses.
Hobbes semontre alors ici résolument nominaliste, et s'oppose ainsi aux réaliste comme Platon (Le Cratyle) pour qui les nomsrévèlent la réalité de la chose.
Nous comprenons par la suite que le langage a pour origine nos passions.
Nousnommons les choses en fonction de nous-même, non par fidélité aux choses elles-mêmes.
Le plaisant et ledéplaisant sont jugés tels en fonction de la « constitution de nos corps ».
Les vices et les vertus sont, eux, jugésen fonction des « préventions de notre pensée », autrement dit de nos préjugés.
Par la suite du texte Thomas Hobbes tire les conséquences pratiques de sa thèse.
Il donne ainsi des éléments deréponse à la problématique que nous avons dégagée.
La première conséquence est l'ambiguïté possible des termesdans le raisonnement et la discussion.
C'est pourquoi en raisonnant on doit prendre garde aux mots qui, outre lasignification de ce que nous imaginons de leur nature, en ont une aussi qui vient de la nature, des dispositions etdes intérêts de celui qui parle.
Certains poètes, comme Mallarmé dans Poésies, cherchent à nommer les choseselles-mêmes pour en cerner l'essence.Chaque individu possède une manière différente de se représenter, de nommer une chose.
Tous les hommes n'étantpas affectés de la même façon, par la même chose, la même personne, au même moment, il est évidemment difficile,voir impossible de nommer pareillement dans la conversation courante les choses ayant la propriété de nousaffecter.
Il ne faut donc pas faire confiance au langage.
Le raisonnement est cette activité qui permet de déblayerles faux-sens, les contresens… Il n'y a pas de « mot de la fin », simplement une activité, le raisonnement critique,qui tente de lutter contre les mots marqués par les passions humaines.La deuxième conséquence de ces connotations attachées aux mots est le fait que des mots connotés ne peuventfonder aucun raisonnement, ceci les rapprochant des métaphores, ou autres figures de style.
Nous pouvons en effetconsidérer les mots comme des figures de rhétorique, autrement dit comme artificiels.
De telles dénominations neconstituent jamais le fondement véritable d'aucun raisonnement, pas d'avantage les métaphores et les figures derhétorique.
Mais celles-ci sont cependant moins dangereuses puisqu'elles professent leur caractère flottant, ce quene font pas les autres dénominations.Il convient donc de situer Hobbes dans une problématique générale du langage.
Il se montre ici résolumentnominaliste.
Les noms ne sont que des noms, de simples étiquettes, ne révélant rien des choses elles-mêmes.
Ils'oppose ainsi aux réalistes, comme Platon dans Cratyle, ou Ponge, dans Le parti pris des choses, pour qui les nomsrévèlent la réalité de la chose.
L'apport de Thomas Hobbes est le suivant : si les noms ne révèlent pas les choses,ils révèlent cependant les passions humaines, à ce titre ils ne sont pas de simples étiquettes.
Nous jugeons du bien et du mal en fonction de nos passions.
Or, ces passions diffèrent d'un homme à un autre.
Ceque l'un trouve bien, l'autre peut le trouver mal.
Les noms ne signifient pas la même chose pour tout le monde.
Il estdonc dans le domaine moral impossible de se mettre vraiment d'accord sur le sens des mots, chacun y projette cespropres passions.
Le vocabulaire est responsable de nombreux malentendus au niveau de l'information et de lacommunication.
S'en suit alors des conséquences.
Là où on était d'accord, on constate que cela ne marche plusparce qu'on n'avait pas compris les mots de la même façon, ou encore la où on ne parvenait pas à se comprendre,on constate qu'en fait on voulait dire la même chose.
D'autre part, on utilise des mots connotés pour décrire autrechose que le contexte dans lequel ces mots sont utilisés.
Cela entraîne une ambiguïté fondamentale due à un abusde lexique.
Les exemples les plus frappants se rencontrent en politique.
Nous comprenons à travers ce texte qu'ilest donc difficile pour l'homme de surmonter ce handicap du langage..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HOBBES et le nominalisme
- L'oisiveté est la mère de la philosophie (Hobbes)
- Quelle conception de la nature humaine vous semble la plus crédible? La guerre de chacun contre chacun de Hobbes ou la bonté naturelle de Rousseau? L’état de nature est hobbésien ou rousseauiste?
- Hobbes, article 14: L'état de nature dans Léviathan et Le Citoyen
- Léviathan, Chapitre 13, Hobbes, 1651