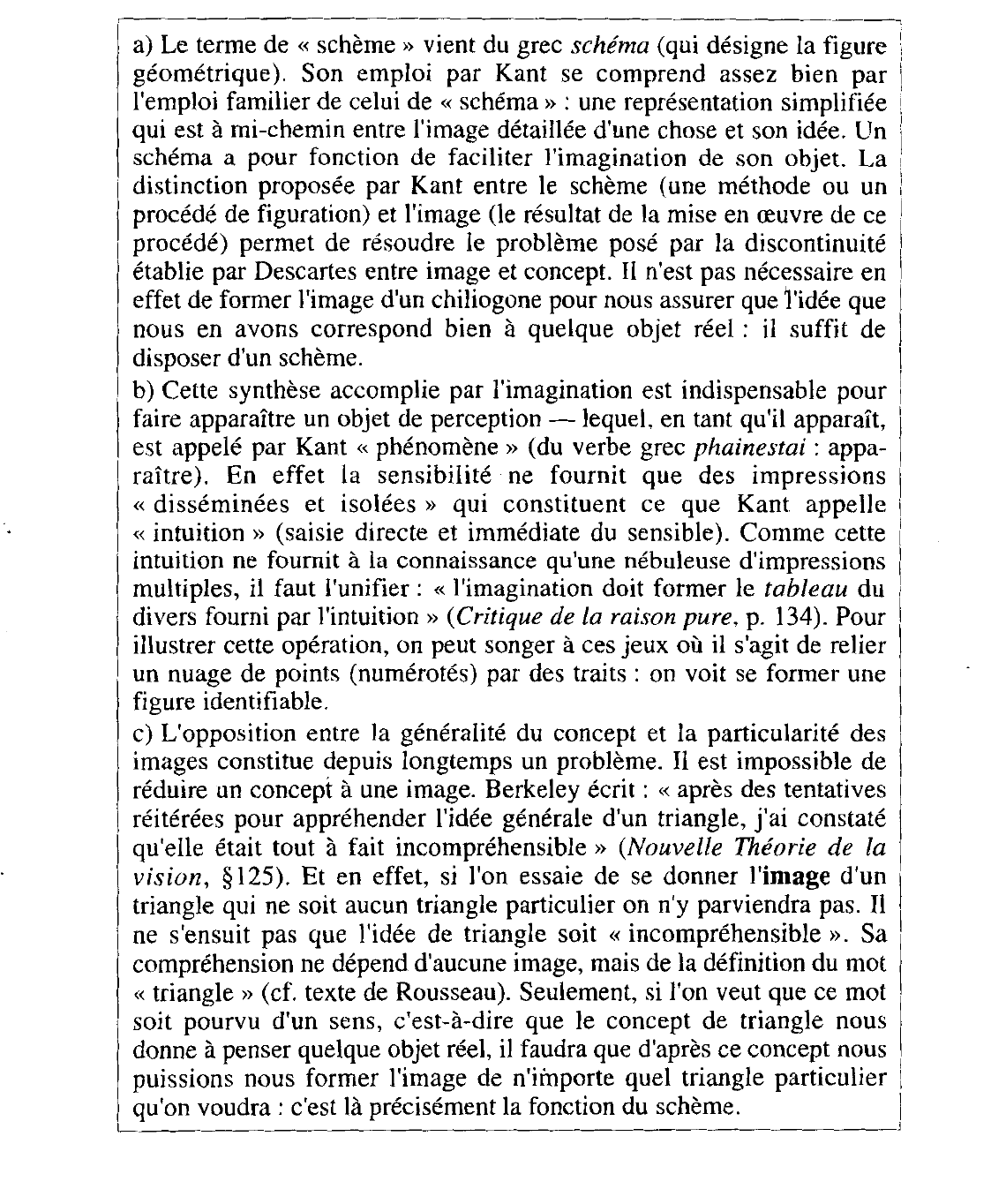Kant, Critique de la raison pure: Le schème
Publié le 22/03/2015

Extrait du document

« Le schème(a) n'est toujours par lui-même qu'un produit de l'imagination, mais comme la synthèse de l'imagination(b) n'a pour but aucune intuition particulière, mais seulement l'unité dans la détermination de la sensibilité, il faut bien distinguer le schème de l'image. Ainsi, quand je dispose cinq points les uns à la suite des
autres • c'est là une image du nombre cinq. Au contraire, quand je ne fais que penser un nombre en général, qui peut être cinq ou cent, cette pensée est la représentation d'une méthode pour représenter une multitude (par exemple mille) dans une image, conformément à un certain concept, plutôt que cette image même, qu'il me serait difficile, dans le dernier cas, de comparer au concept. Or, c'est cette représentation d'un procédé général de l'imagination pour procurer à un concept son image que j'appelle le schème de ce concept...
Dans le fait nos concepts sensibles purs n'ont pas pour fondement des images des objets, mais des schèmes. Il n'y a pas d'image d'un triangle qui puisse être jamais adéquate au concept d'un triangle en général. En effet aucune image n'atteindrait la généralité du concept(c) en vertu de laquelle celle-ci s'applique à tous les triangles, rectangles ou non, mais elle serait toujours restreinte à une seule partie de cette sphère. Le schème du triangle ne peut jamais exister ailleurs que dans la pensée et il signifie une règle de la synthèse de l'imagination, relativement à des figures pures dans l'espace ; un objet de l'expérience ou une image de cet objet atteint encore bien moins le concept empirique, mais celui-ci se rapporte toujours immédiatement au schème de l'imagination comme à une règle qui sert à déterminer notre intuition conformément à un certain concept en général. «
Kant, Critique de la raison pure,
Trad. Tremesaygues et Pacaud PUF, p. 152.

«
Textes commentés 47
a) Le terme de « schème » vient du grec schéma (qui désigne la figure
géométrique).
Son emploi par Kant se comprend assez bien par
l'emploi familier de celui de « schéma» : une représentation simplifiée
qui est
à mi-chemin entre l'image détaillée d'une chose et son idée.
Un
schéma a pour fonction de faciliter l'imagination de son objet.
La
distinction proposée par Kant entre le schème (une méthode ou un
procédé de figuration) et l'image (le résultat de la mise en œuvre de ce
procédé) permet de résoudre le problème posé par la discontinuité
établie par Descartes entre image et concept.
Il n'est pas nécessaire en
effet de former l'image d'un chiliogone pour nous assurer que
l'idée que
nous en avons correspond bien à quelque objet réel : il suffit de
disposer d'un schème.
b) Cette synthèse
accomplie par l'imagination est indispensable
pour
faire apparaître un objet de perception -lequel, en tant qu'il apparaît,
est appelé par Kant
«phénomène» (du verbe grec phainestai : appa
raître).
En effet la sensibilité ne fournit que des impressions
« disséminées et isolées » qui constituent ce que Kant appelle
« intuition» (saisie directe et immédiate du sensible).
Comme cette
intuition ne fournit à la connaissance qu'une nébuleuse d'impressions
multiples, il faut l'unifier :
« l'imagination doit former le tableau du
divers fourni par l'intuition»
(Critique de la raison pure, p.
134).
Pour
illustrer cette opération, on peut songer à ces jeux où il s'agit de relier
un nuage de points (numérotés) par des traits : on voit se former une
figure identifiable.
c) L'opposition entre la généralité du concept
et la particularité des
images constitue depuis longtemps un problème.
Il est impossible de
réduire un concept à une image.
Berkeley écrit :
« après des tentatives
réitérées pour appréhender l'idée générale d'un triangle, j'ai constaté
qu'elle était tout à fait incompréhensible
» (Nouvelle Théorie de la
vision, § 125).
Et en effet, si l'on essaie de se donner l'image d'un
triangle qui ne soit aucun triangle particulier on n'y parviendra pas.
Il
ne s'ensuit pas que l'idée de triangle soit
« incompréhensible ».
Sa
compréhension ne dépend d'aucune image, mais de la définition du mot
«triangle» (cf.
texte de Rousseau).
Seulement, si l'on veut que ce mot
soit pourvu d'un sens, c'est-à-dire que le concept de triangle nous
donne à penser quelque objet réel, il faudra que d'après ce concept nous
puissions nous former l'image de n'importe quel triangle particulier
qu'on voudra : c'est là précisément la fonction du schème.
1.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Critique de la raison pure de Kant (résumé)
- CRITIQUE DE LA RAISON PRATIQUE, Emmanuel Kant (résumé et analyse)
- CRITIQUE DE LA RAISON PURE, Emmanuel Kant (exposé de l’oeuvre)
- Kant : La liberté malgré le déterminisme Emmanuel KANT écrit en 1781 son ouvrage « Critique de la raison pure » dans lequel figure l’extrait que nous allons tenter expliquer.
- Analyse de texte: Texte 5 page 281, L’expérience Analyse de Texte Kant, Critique de la raison pure