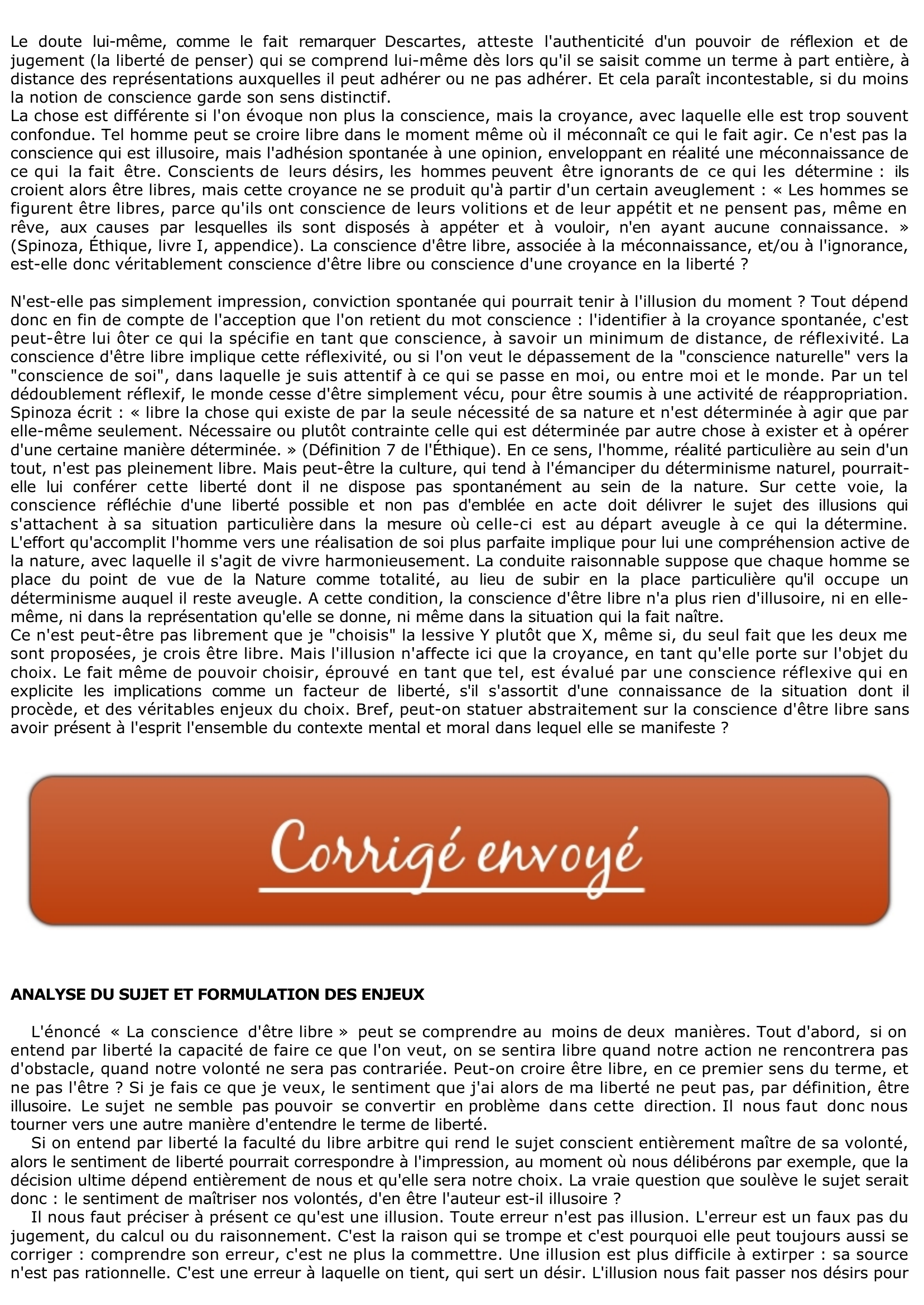La conscience d'être libre peut-elle être illusoire ?
Publié le 23/09/2005

Extrait du document

La conscience morale prouve que nous sommes libres. Lorsque nous agissons, nous avons le sentiment que nous aurions pu faire le contraire de ce que nous avons fait. Voilà qui montre que nous sommes entièrement responsables de ce que nous sommes. Mais, notre conscience de la liberté peut être illusoire. Nous ne percevons que des causes finales, et non des causes premières. Bien souvent, nos actes dépendent de motivations inconscientes dont l'origine nous est inaccessible.

«
Le doute lui-même, comme le fait remarquer Descartes, atteste l'authenticité d'un pouvoir de réflexion et dejugement (la liberté de penser) qui se comprend lui-même dès lors qu'il se saisit comme un terme à part entière, àdistance des représentations auxquelles il peut adhérer ou ne pas adhérer.
Et cela paraît incontestable, si du moinsla notion de conscience garde son sens distinctif.La chose est différente si l'on évoque non plus la conscience, mais la croyance, avec laquelle elle est trop souventconfondue.
Tel homme peut se croire libre dans le moment même où il méconnaît ce qui le fait agir.
Ce n'est pas laconscience qui est illusoire, mais l'adhésion spontanée à une opinion, enveloppant en réalité une méconnaissance dece qui la fait être.
Conscients de leurs désirs, les hommes peuvent être ignorants de ce qui les détermine : ilscroient alors être libres, mais cette croyance ne se produit qu'à partir d'un certain aveuglement : « Les hommes sefigurent être libres, parce qu'ils ont conscience de leurs volitions et de leur appétit et ne pensent pas, même enrêve, aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter et à vouloir, n'en ayant aucune connaissance.
»(Spinoza, Éthique, livre I, appendice).
La conscience d'être libre, associée à la méconnaissance, et/ou à l'ignorance,est-elle donc véritablement conscience d'être libre ou conscience d'une croyance en la liberté ?
N'est-elle pas simplement impression, conviction spontanée qui pourrait tenir à l'illusion du moment ? Tout dépenddonc en fin de compte de l'acception que l'on retient du mot conscience : l'identifier à la croyance spontanée, c'estpeut-être lui ôter ce qui la spécifie en tant que conscience, à savoir un minimum de distance, de réflexivité.
Laconscience d'être libre implique cette réflexivité, ou si l'on veut le dépassement de la "conscience naturelle" vers la"conscience de soi", dans laquelle je suis attentif à ce qui se passe en moi, ou entre moi et le monde.
Par un teldédoublement réflexif, le monde cesse d'être simplement vécu, pour être soumis à une activité de réappropriation.Spinoza écrit : « libre la chose qui existe de par la seule nécessité de sa nature et n'est déterminée à agir que parelle-même seulement.
Nécessaire ou plutôt contrainte celle qui est déterminée par autre chose à exister et à opérerd'une certaine manière déterminée.
» (Définition 7 de l'Éthique).
En ce sens, l'homme, réalité particulière au sein d'untout, n'est pas pleinement libre.
Mais peut-être la culture, qui tend à l'émanciper du déterminisme naturel, pourrait-elle lui conférer cette liberté dont il ne dispose pas spontanément au sein de la nature.
Sur cette voie, laconscience réfléchie d'une liberté possible et non pas d'emblée en acte doit délivrer le sujet des illusions quis'attachent à sa situation particulière dans la mesure où celle-ci est au départ aveugle à ce qui la détermine.L'effort qu'accomplit l'homme vers une réalisation de soi plus parfaite implique pour lui une compréhension active dela nature, avec laquelle il s'agit de vivre harmonieusement.
La conduite raisonnable suppose que chaque homme seplace du point de vue de la Nature comme totalité, au lieu de subir en la place particulière qu'il occupe undéterminisme auquel il reste aveugle.
A cette condition, la conscience d'être libre n'a plus rien d'illusoire, ni en elle-même, ni dans la représentation qu'elle se donne, ni même dans la situation qui la fait naître.Ce n'est peut-être pas librement que je "choisis" la lessive Y plutôt que X, même si, du seul fait que les deux mesont proposées, je crois être libre.
Mais l'illusion n'affecte ici que la croyance, en tant qu'elle porte sur l'objet duchoix.
Le fait même de pouvoir choisir, éprouvé en tant que tel, est évalué par une conscience réflexive qui enexplicite les implications comme un facteur de liberté, s'il s'assortit d'une connaissance de la situation dont ilprocède, et des véritables enjeux du choix.
Bref, peut-on statuer abstraitement sur la conscience d'être libre sansavoir présent à l'esprit l'ensemble du contexte mental et moral dans lequel elle se manifeste ?
ANALYSE DU SUJET ET FORMULATION DES ENJEUX
L'énoncé « La conscience d'être libre » peut se comprendre au moins de deux manières.
Tout d'abord, si onentend par liberté la capacité de faire ce que l'on veut, on se sentira libre quand notre action ne rencontrera pasd'obstacle, quand notre volonté ne sera pas contrariée.
Peut-on croire être libre, en ce premier sens du terme, etne pas l'être ? Si je fais ce que je veux, le sentiment que j'ai alors de ma liberté ne peut pas, par définition, êtreillusoire.
Le sujet ne semble pas pouvoir se convertir en problème dans cette direction.
Il nous faut donc noustourner vers une autre manière d'entendre le terme de liberté.
Si on entend par liberté la faculté du libre arbitre qui rend le sujet conscient entièrement maître de sa volonté,alors le sentiment de liberté pourrait correspondre à l'impression, au moment où nous délibérons par exemple, que ladécision ultime dépend entièrement de nous et qu'elle sera notre choix.
La vraie question que soulève le sujet seraitdonc : le sentiment de maîtriser nos volontés, d'en être l'auteur est-il illusoire ? Il nous faut préciser à présent ce qu'est une illusion.
Toute erreur n'est pas illusion.
L'erreur est un faux pas dujugement, du calcul ou du raisonnement.
C'est la raison qui se trompe et c'est pourquoi elle peut toujours aussi secorriger : comprendre son erreur, c'est ne plus la commettre.
Une illusion est plus difficile à extirper : sa sourcen'est pas rationnelle.
C'est une erreur à laquelle on tient, qui sert un désir.
L'illusion nous fait passer nos désirs pour.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pensez-vous que la conscience d'être libre puisse être illusoire ?
- «La conscience dʼêtre libre peut-elle être illusoire ?»
- La conscience d'être libre est-elle illusoire ?
- La conscience d'être libre peut-elle être illusoire ?
- La conscience de soi rend-elle libre ? (Corrigé) Problématisation