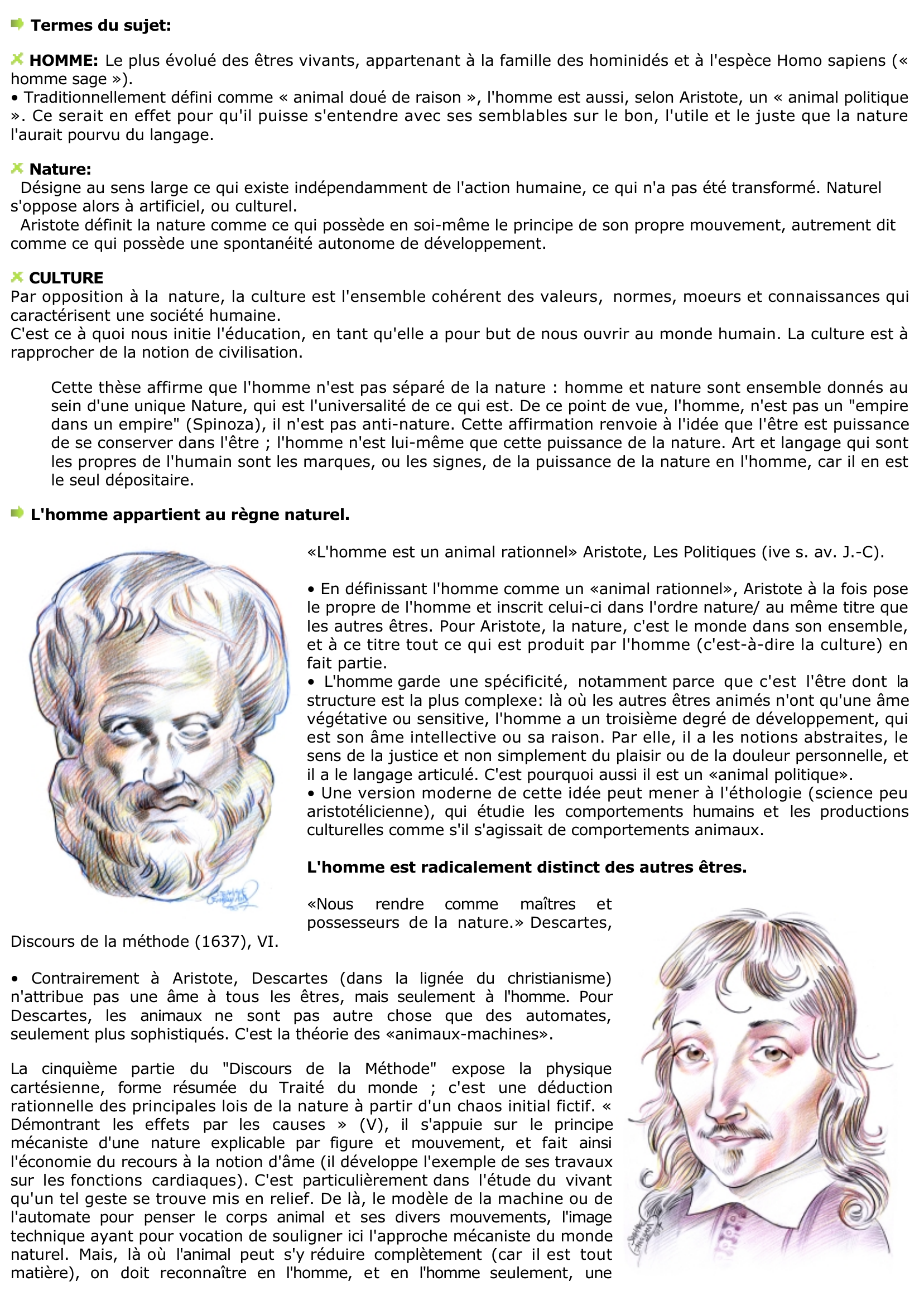La culture affranchit-elle l'homme de la nature?
Publié le 10/04/2005

Extrait du document


«
Termes du sujet:
HOMME: Le plus évolué des êtres vivants, appartenant à la famille des hominidés et à l'espèce Homo sapiens (« homme sage »).• Traditionnellement défini comme « animal doué de raison », l'homme est aussi, selon Aristote, un « animal politique».
Ce serait en effet pour qu'il puisse s'entendre avec ses semblables sur le bon, l'utile et le juste que la naturel'aurait pourvu du langage.
Nature: Désigne au sens large ce qui existe indépendamment de l'action humaine, ce qui n'a pas été transformé.
Naturels'oppose alors à artificiel, ou culturel.
Aristote définit la nature comme ce qui possède en soi-même le principe de son propre mouvement, autrement ditcomme ce qui possède une spontanéité autonome de développement.
CULTUREPar opposition à la nature, la culture est l'ensemble cohérent des valeurs, normes, moeurs et connaissances quicaractérisent une société humaine.C'est ce à quoi nous initie l'éducation, en tant qu'elle a pour but de nous ouvrir au monde humain.
La culture est àrapprocher de la notion de civilisation.
Cette thèse affirme que l'homme n'est pas séparé de la nature : homme et nature sont ensemble donnés ausein d'une unique Nature, qui est l'universalité de ce qui est.
De ce point de vue, l'homme, n'est pas un "empiredans un empire" (Spinoza), il n'est pas anti-nature.
Cette affirmation renvoie à l'idée que l'être est puissancede se conserver dans l'être ; l'homme n'est lui-même que cette puissance de la nature.
Art et langage qui sontles propres de l'humain sont les marques, ou les signes, de la puissance de la nature en l'homme, car il en estle seul dépositaire.
L'homme appartient au règne naturel.
«L'homme est un animal rationnel» Aristote, Les Politiques (ive s.
av.
J.-C).
• En définissant l'homme comme un «animal rationnel», Aristote à la fois posele propre de l'homme et inscrit celui-ci dans l'ordre nature/ au même titre queles autres êtres.
Pour Aristote, la nature, c'est le monde dans son ensemble,et à ce titre tout ce qui est produit par l'homme (c'est-à-dire la culture) enfait partie.• L'homme garde une spécificité, notamment parce que c'est l'être dont lastructure est la plus complexe: là où les autres êtres animés n'ont qu'une âmevégétative ou sensitive, l'homme a un troisième degré de développement, quiest son âme intellective ou sa raison.
Par elle, il a les notions abstraites, lesens de la justice et non simplement du plaisir ou de la douleur personnelle, etil a le langage articulé.
C'est pourquoi aussi il est un «animal politique».• Une version moderne de cette idée peut mener à l'éthologie (science peuaristotélicienne), qui étudie les comportements humains et les productionsculturelles comme s'il s'agissait de comportements animaux.
L'homme est radicalement distinct des autres êtres.
«Nous rendre comme maîtres etpossesseurs de la nature.» Descartes, Discours de la méthode (1637), VI.
• Contrairement à Aristote, Descartes (dans la lignée du christianisme)n'attribue pas une âme à tous les êtres, mais seulement à l'homme.
PourDescartes, les animaux ne sont pas autre chose que des automates,seulement plus sophistiqués.
C'est la théorie des «animaux-machines».
La cinquième partie du "Discours de la Méthode" expose la physiquecartésienne, forme résumée du Traité du monde ; c'est une déductionrationnelle des principales lois de la nature à partir d'un chaos initial fictif.
«Démontrant les effets par les causes » (V), il s'appuie sur le principemécaniste d'une nature explicable par figure et mouvement, et fait ainsil'économie du recours à la notion d'âme (il développe l'exemple de ses travauxsur les fonctions cardiaques).
C'est particulièrement dans l'étude du vivantqu'un tel geste se trouve mis en relief.
De là, le modèle de la machine ou del'automate pour penser le corps animal et ses divers mouvements, l'imagetechnique ayant pour vocation de souligner ici l'approche mécaniste du mondenaturel.
Mais, là où l'animal peut s'y réduire complètement (car il est toutmatière), on doit reconnaître en l'homme, et en l'homme seulement, une.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La culture affranchit-elle l'homme de la nature ?
- La culture affranchit-elle l'homme de la nature ?
- Peut-on distinguer nature et culture chez l'homme?
- KANT: En quel sens peut-on dire que la raison affranchit l'homme de la nature ?
- Merleau-Ponty: Nature et Culture chez l'homme