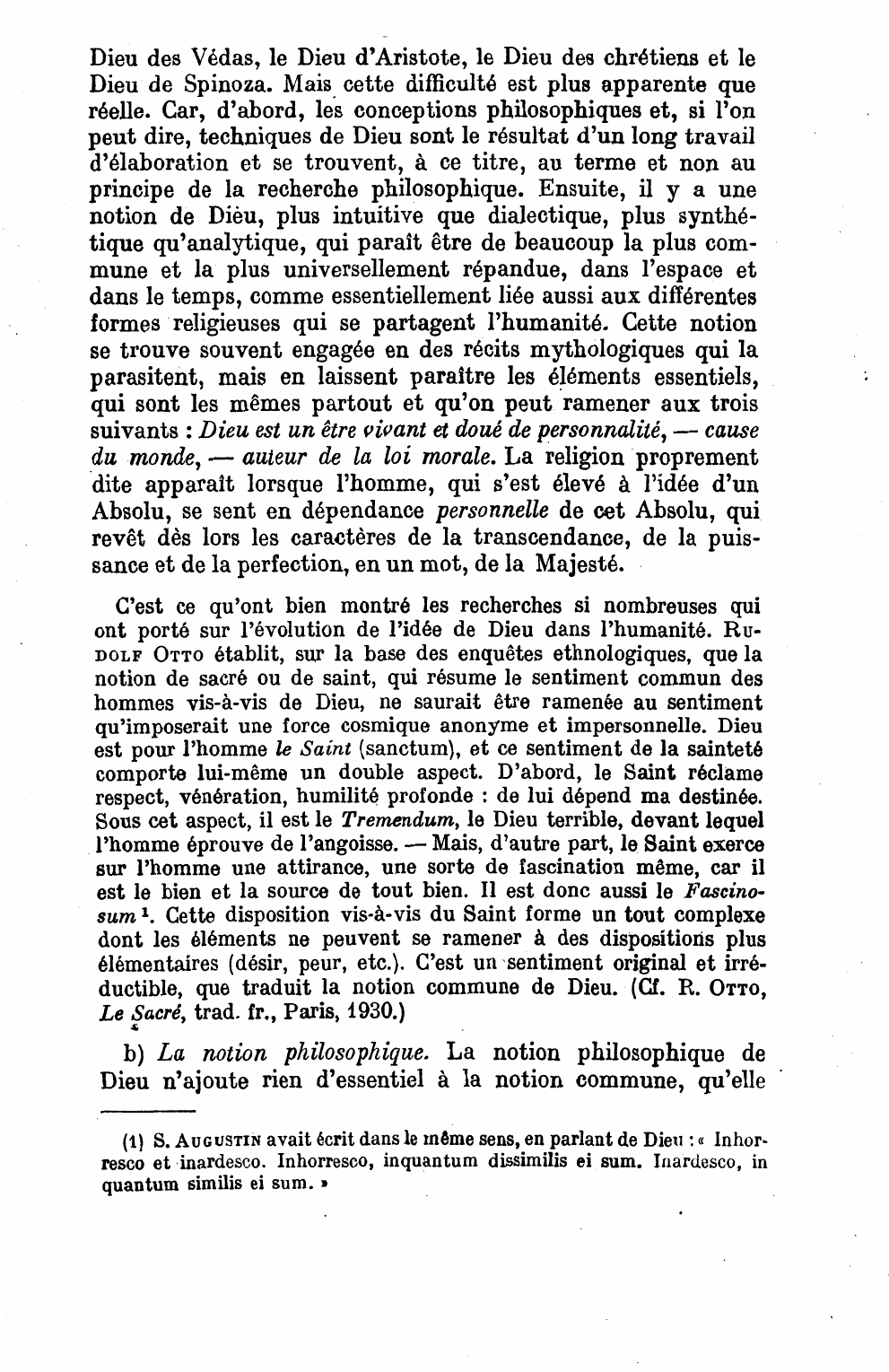La Possibilité de la preuve de Dieu.
Publié le 08/06/2012

Extrait du document

On ne peut aborder le double problème de la possibilité
et de la nécessité d'une preuve ou d'une démonstration de
l'existence de Dieu avant d'avoir défini ce dont on parle lorsqu'on
use du mot Dieu. Rechercher si Dieu existe et, s'il est,
quel il est, et· se demander préalablement si cette recherche
n'est pas vaine, cela suppose évidemment que nous avons déjà
dans l'esprit une certaine notion de Dieu, sinon notre enquête
serait complètement impossible, car on ne se pose pas de
question sur ce dont on ne sait absolument rien. Nous devons
donc commencer par préciser la notion de Dieu qui est au principe
de nos investigations.

«
Dieu des Védas, le Dieu d'Aristote, le Dieu des chrétiens et le
Dieu de Spinoza.
Mais cette difficulté
est plus apparente que
réelle.
Car, d'abord,
les conceptions philosophiques et, si l'on
peut dire, techniques de Dieu sont le résultat d'un long travail
d'élaboration et se trouvent, à ce titre, au terme et non au
principe de la recherche philosophique.
Ensuite, il y a une
notion de Diëu, plus intuitive que dialectique, plus synthé
tique qu'analytique, qui paraît être de beaucoup la plus com
mune
et la plus universellement répandue, dans l'espace et
dans le temps, comme essentiellement liée aussi aux différentes
formes religieuses qui se
partagent l'humanité.
Cette notion
se
trouve souvent engagée en des récits mythologiques qui la
parasitent, mais en laissent paraître les éléments essentiels,
qui
sont les mêmes partout et qu'on peut ramener aux trois
suivants :
Dieu est un être vivant et doué de personnalité,- cause
du monde, -auteur
de la loi morale.
La religion proprement
dite apparaît lorsque l'homme, qui s'est élevé à l'idée d'un
Absolu, se sent en dépendance personnelle de cet Absolu, qui
revêt dès lors les caractères de la transcendance, de la puis
sance
et de la perfection, en un mot, de la Majesté.
C'est
ce qu'ont bien montré les recherches si nombreuses qui
ont porté sur l'évolution de l'idée de Dieu dans l'humanité.
Ru DOLF OTTO établit, sur la base des enquêtes ethnologiques, que la
notion de sacré ou de saint, qui résume le sentiment commun des hommes vis-à-vis de Dieu, ne saurait être ramenée au sentiment
qu'imposerait une force cosmique anonyme et impersonnelle.
Dieu est pour l'homme le Saint (sanctum), et ce sentiment de la sainteté
comporte lui-même un double aspect.
D'abord, le Saint réclame
respect, vénération, humilité profonde : de lui dépend ma destinée.
Sous cet aspect, il est le Tremendum, le Dieu terrible, devant lequel
l'homme éprouve de l'angoisse.- Mais, d'autre part, le Saint exerce
sur l'homme une attirance, une sorte de fascination même, car il est le bien et la source de tout bien.
Il est donc aussi le Fascino sum 1
• Cette disposition vis-à-vis du Saint forme un tout complexe
dont les éléments ne peuvent se ramener à des dispositions plus
élémentaires (désir, peur, etc.).
C'est un sentiment original et irré
ductible, que traduit la notion commune de Dieu.
(Cf.
R.
OTTO, Le Sacré, trad.
fr., Paris, 1930.) ..
b) La notion philosophique.
La notion philosophique de
Dieu
n'ajoute rien d'essentiel à la notion commune, qu'elle
(1) S.
AuGUSTIN avait écrit dans le même sens, en parlant de Dieu : • Inhor· resco et ·inardesco.
Inhorresco, inquantum dissimilis ei sum.
Iuardesco, in quantum similis ei sum.
•.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La possibilité logique de l'existence de Dieu G. W. LEIBNIZ
- La preuve cosmologique de l'existence de Dieu SAINT THOMAS D'AQUIN
- La preuve ontologique de l'existence de Dieu SAINT ANSELME
- La beauté sensible est-elle une preuve de l’existence de Dieu?
- La critique kantienne de la preuve cosmologique de l existence de Dieu.