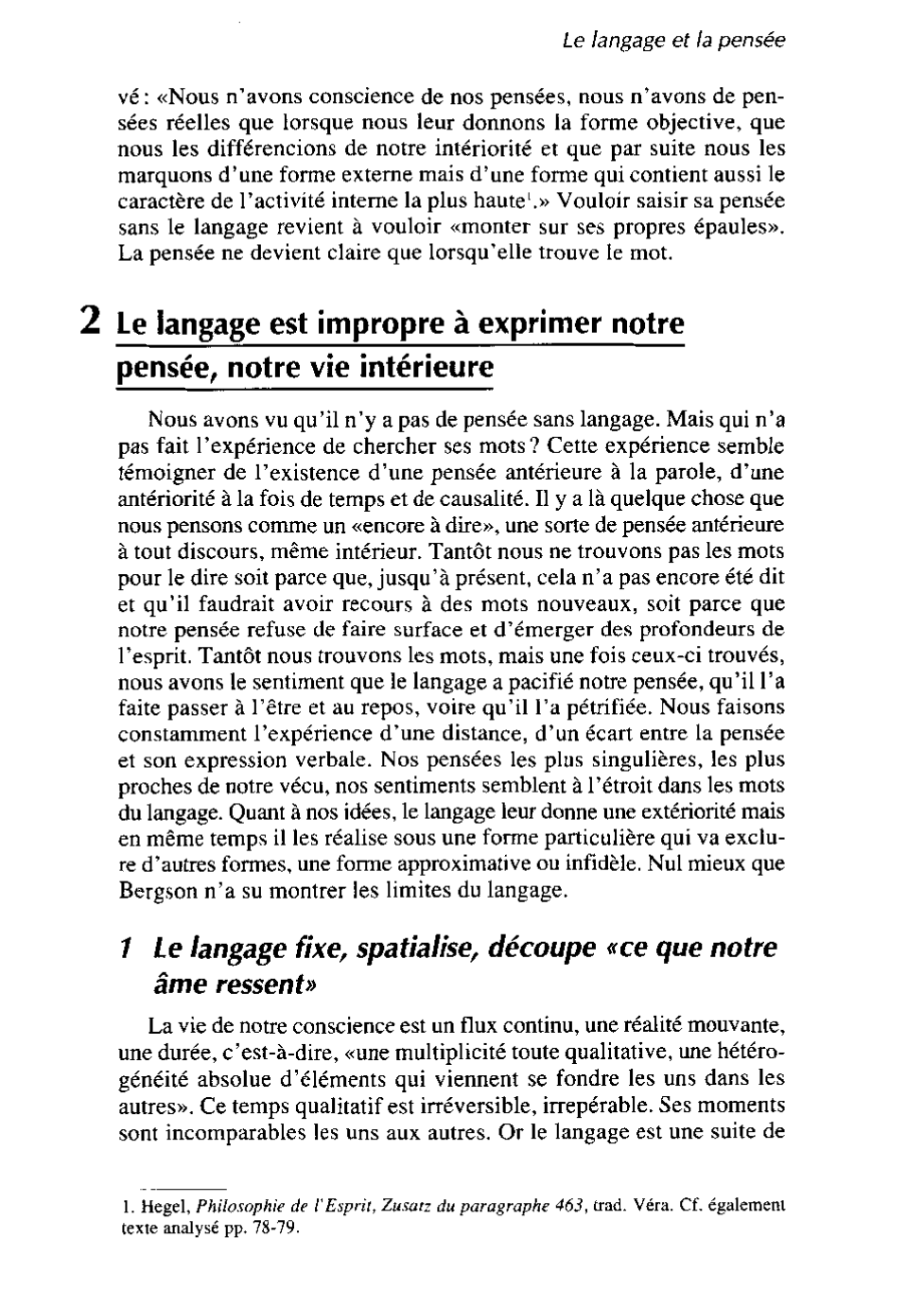Le langage et la pensée
Publié le 10/03/2015

Extrait du document

nous mettent en présence d'un langage déformé ou réformé, ne s'imposent
pas à nous inéluctablement. Ce que nous avons fait, nous pouvons
le défaire. Le papillon volant, vivant, ne trouve pas sa raison d'être et
son achèvement dans l'immutabilité de la pellicule. Ainsi, le poète ne
s'enferme pas dans ! 'enveloppe. Au contraire, il réveille la chrysalide
et restitue au langage toute sa fraîcheur. Le mot «fleur«, par delà cette
fleur-ci, renvoie à toutes les fleurs passées, présentes et futures. Le mot
«fleur«, libéré de son sens emprisonné dans la chose, rend enfin présente
1 '«absente de tous bouquets« :
«Je dis: une fleur! et, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun
contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement
se lève, idée même et suave, l'absente de tous bouquets1«.
Le langage ainsi libéré du réel, peut devenir métaphorique. De la
Fleur en soi, de l'idée de fleur, on passe à d'autres Idées: La beauté,

«
Le langage et la pensée
vé: «Nous n'avons conscience de nos pensées, nous n'avons de pen
sées réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que
nous les différencions de notre intériorité et que par suite nous les
marquons d'une forme externe mais d'une forme qui contient aussi le
caractère de l'activité interne la plus
haute 1.» Vouloir saisir sa pensée
sans le langage revient à vouloir «monter sur ses propres épaules».
La pensée ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot.
2 Le langage est impropre à exprimer notre
pensée, notre vie intérieure
Nous avons vu qu'il n'y a pas de pensée sans langage.
Mais qui n'a
pas fait l'expérience de chercher ses mots? Cette expérience semble
témoigner de l'existence
d'une pensée antérieure à la parole, d'une
antériorité à la fois de temps et de causalité.
Il y a là quelque chose que
nous pensons comme
un «encore à dire», une sorte de pensée antérieure
à tout discours, même intérieur.
Tantôt nous
ne trouvons pas les mots
pour le dire soit parce que, jusqu'à présent, cela n'a pas encore été dit
et qu'il faudrait avoir recours à des mots nouveaux, soit parce que
notre pensée refuse de faire surface et d'émerger des profondeurs de
l'esprit.
Tantôt nous trouvons les mots, mais une fois ceux-ci trouvés,
nous avons
le sentiment que le langage a pacifié notre pensée, qu'il l'a faite passer à l'être et au repos, voire qu'il l'a pétrifiée.
Nous faisons
constamment l'expérience
d'une distance, d'un écart entre la pensée
et son expression verbale.
Nos pensées les plus singulières, les plus
proches de notre vécu, nos sentiments semblent à l'étroit dans les mots
du langage.
Quant à nos idées, le langage leur donne une extériorité mais
en même temps
il les réalise sous une forme particulière qui va exclu re d'autres formes, une forme approximative ou infidèle.
Nul mieux que
Bergson
n'a su montrer les limites du langage.
1 Le langage fixe, spatialise, découpe «ce que notre
âme ressent»
La vie de notre conscience est un flux continu, une réalité mouvante,
une durée, c'est-à-dire,
«une multiplicité toute qualitative, une hétéro
généité absolue d'éléments qui viennent se fondre les uns dans les
autres».
Ce temps qualitatif est irréversible, irrepérable.
Ses moments
sont incomparables les uns aux autres.
Or le langage est une suite de
1.
Hegel, Philosophie de /'Esprit, Zusatz du paragraphe 463, trad.
Véra.
Cf.
également
texte analysé pp.
78-79.
31.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LANGAGE ET LA PENSÉE (LE), Language and . Noam Chomsky - résumé de l'oeuvre
- LANGAGE ET LA PENSÉE CHEZ L’ENFANT (Le). (résumé)
- Notre pensée pour s'élaborer et s'exprimer, passe-t-elle nécessairement par le langage?
- Notre pensée pour s'élaborer et s'exprimer, passe-t-elle nécessairement par le langage ?
- Notre pensée, pour s’exprimer, passe-t-elle nécessairement par le langage ?