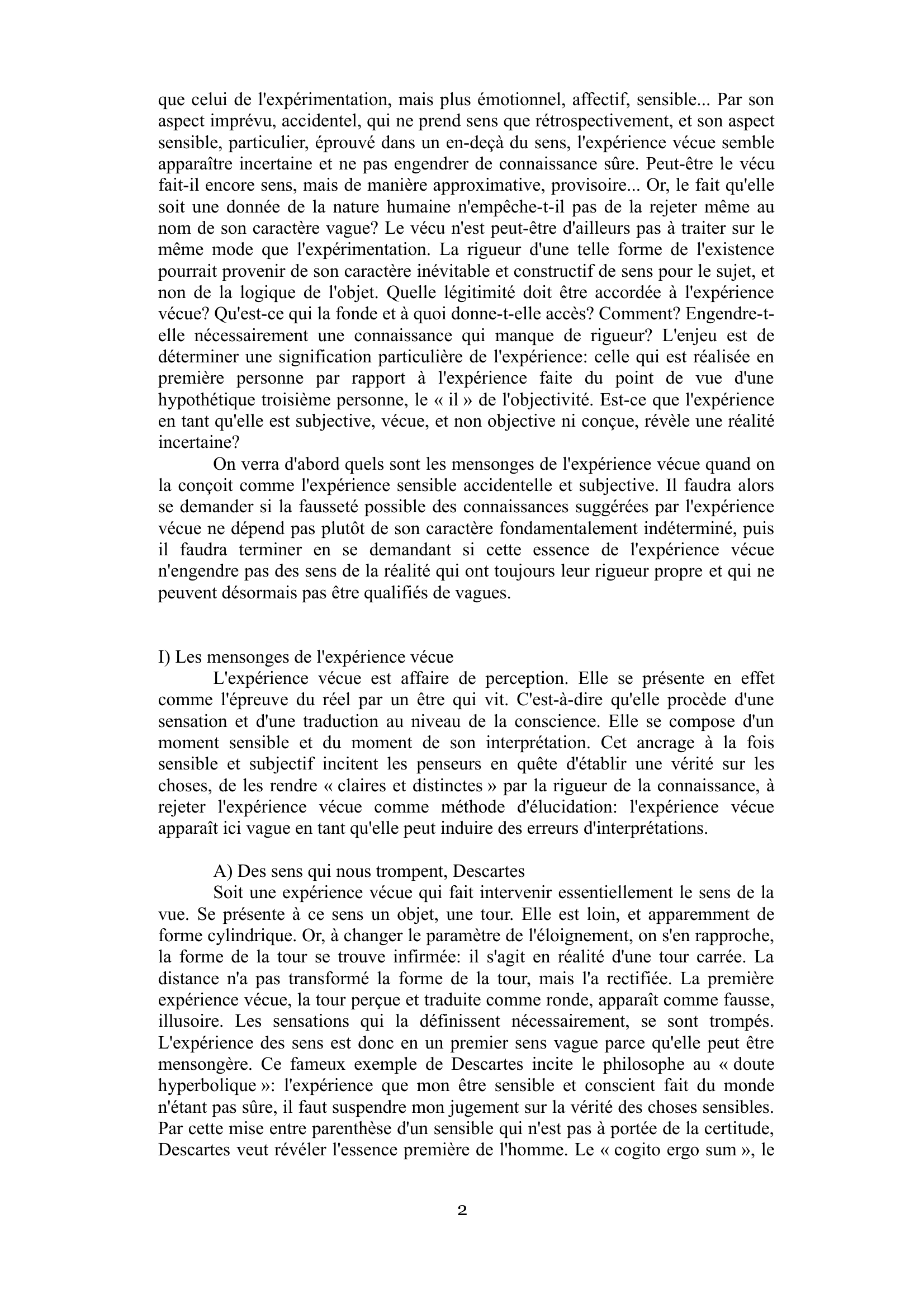l'experience vécue est elle nécessairement vague ?
Publié le 14/12/2012

Extrait du document


«
que
celui de l'expéri menta tion, ma is plus é mo tionnel, af fect if, sensible...
Par s on
aspec
t i mprévu, acc idente l, qui ne prend sens que rétrospect ivement, e t son aspect
sensible,
part iculier, éprouvé dans un en-deçà du sens, l'expéri ence vécue se mbl e
appar
aître in certa ine et ne pas engendrer de conna issanc e s ûre.
Peut-êtr e le vécu
fai
t-il encore sen s, m ais de m ani ère approx imative, provisoire...
Or , le fait qu'ell e
soit
une donnée de la nature hu main e n 'e mp êche- t-il pas de la rejeter m ême au
no
m de son cara ctère vague? Le vécu n 'est peut- être d'aill eurs pas à tra iter sur le
m
ême mo de que l'expéri menta tion.
La rigueur d'une te lle for me de l'existen ce
pourrai
t provenir de son carac tère inévit able et construc tif de sen s pour le s ujet, et
non
de la logiqu e de l'objet.
Quelle légi timi té doit ê tre ac cordée à l'expérien ce
vécu
e? Qu'e st-ce qui la fonde e t à quoi donne-t-el le accès? Co mme nt? Engendre- t- el
le néc essaire ment une connaissance qui ma nque de rigueur? L'en jeu est de
dét
erm iner une signifi cation particu lière de l'expéri ence: celle qui est réal isée en
pre
mière personne par rapport à l'expérien ce fa ite du point de vue d 'une
h
yp othé tique troisi ème personne, le « il »
de l'objectiv ité.
Est- ce que l'expér ience
en
tant qu'ell e est subjective, vécue, et non objective ni conçu e, révèl e une réa lité
inc
erta ine? O
n verra d'abord quels sont les m ensonges de l'expérienc e vécue quand on
la
conço it co mme l'expérienc e sen sibl e accid entelle et sub ject ive.
Il faudra alors
se
de ma nder si la faus seté possible de s conna issances suggérées par l'expér ience
vécu
e ne dépend pas plutôt de son caract ère fonda menta leme nt indé terminé, puis
il
faudra term iner en se dem andan t si cet te essence de l'expér ience vécue
n'engendre
pas de s sens de la réal ité qui ont tou jours leur rigueur propre
et qui ne
peuven
t désormais pas être qual ifiés de vagues.
I) Les
mensonges de l'expérien ce vécue L'expérien
ce vécue est af faire de percep tion.
Ell e se présente en ef fet
co
mme l'épreuv e du réel par un êtr e qui vi t.
C'est-à-dire qu 'elle procèd e d'une
sensation
et d'une traduct ion au niv eau de la conscience.
E lle se com pose d 'un
m
ome nt sensible et du mo ment de son int erprét ation.
Cet ancr age à la fois
sensible
et subjectif incit ent les penseur s en quête d 'étab lir une vérit é sur les
choses,
de les rendre « cl
aires et distinc tes »
par la rigueur de la connaissance, à
rejeter
l'expérienc e vécue co mme m éthode d'éluc idation : l'expér ience vécue
appar
aît ici vague en tan t qu'elle peut induire des erreurs d'int erpréta tions.
A
) Des sens qui nous trom pent, Descar tes Soit
une expér ience vécue qui fait interv enir essentie llement le sens de la
vue.
Se pré sen te à ce sens un ob jet, une tour .
Elle est loin, et appar emmen t de
for
me c y lindr ique.
Or , à chang er le para mètre de l'éloigne ment, on s 'en rapproche,
la
for me de la tour se trouve infir mée: il s'agit en réali té d 'une tour carrée.
L a
distan
ce n 'a pas transform é la for me de la tour , m ais l'a rectif iée.
La pre mière
expér
ience vécue, la tour perçue et tradui te co mme ronde, apparaî t co mme fausse,
il
lusoire.
Les sen sations qui la définissent nécessaire ment, se sont tro mpés.
L'expér
ience des sen s est donc en un pre mier sens vague parc e qu'elle peut êtr e
m
ensongèr e.
Ce fa me ux exe mple de De scar tes inc ite le philosophe au « doute
h
yp erbol ique »:
l'expérienc e que m on être s ensibl e et conscient fait du mond e
n'étan
t pa s sûre, i l faut s uspendre mo n j uge men t s ur la vérit é des choses sensibles.
Par
cett e mi se entre parenth èse d 'un sen sibl e qui n 'est pas à portée de la cer titude,
Descartes
veut révé ler l'es senc e prem ière de l'ho mme .
Le « cogito
er go s u m »,
le
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'expérience vécue est-elle nécessairement vague ?
- policier (roman), roman qui s'articule autour d'une énigme criminelle ; telle est la définition nécessairement vague à laquelle il faut se résoudre si l'on veut regrouper les multiples avatars de ce qui, au XIXe siècle, n'est pas même un genre.
- La foi implique-t-elle nécessairement une démission de la raison ?
- La poésie doit-elle nécessairement (obligatoirement) embellir le réel, « ennoblir les choses les plus viles » (C. Baudelaire) ?
- La vague. Différence film et livre.