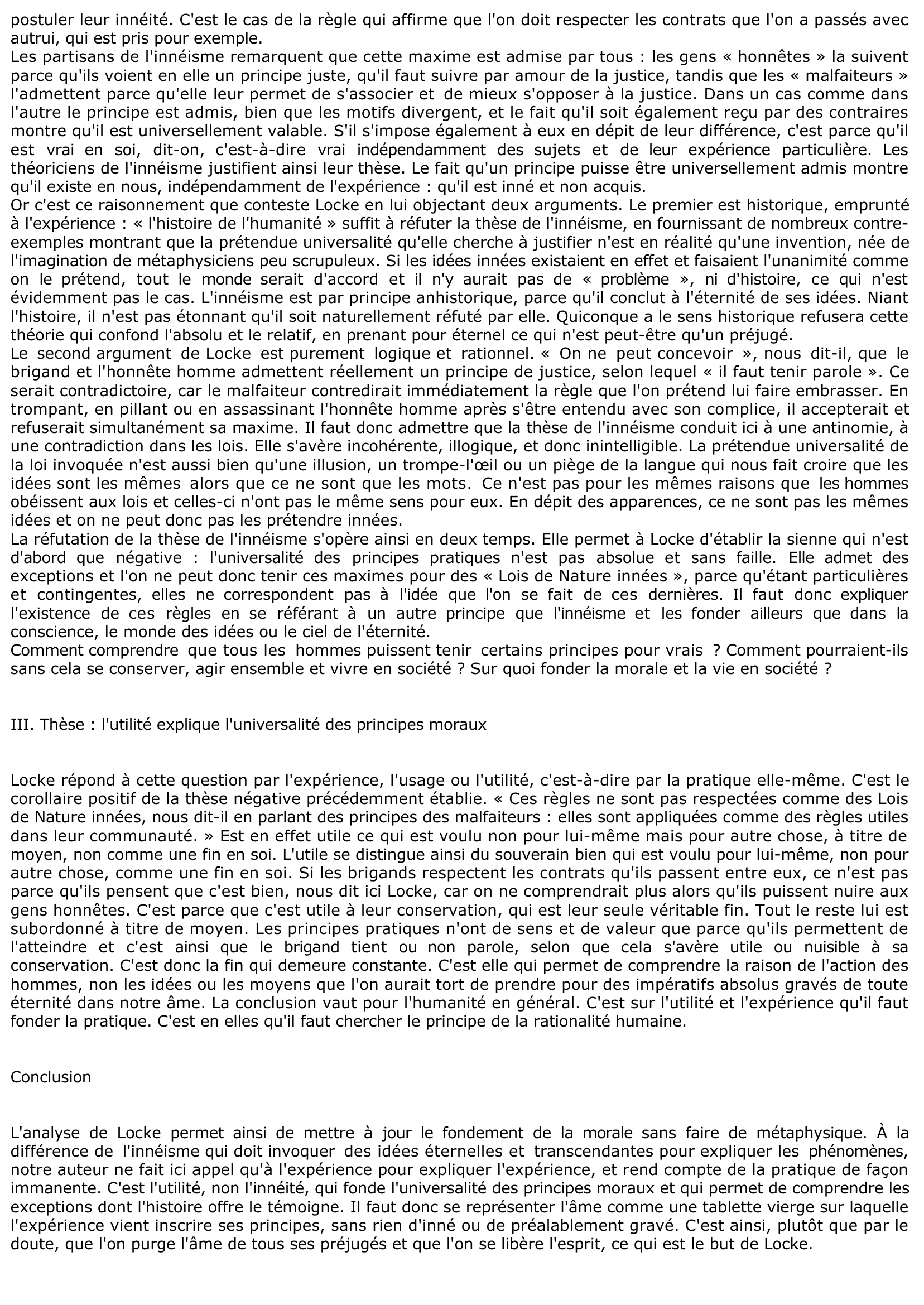Locke: Des principes innées de justice et de vérité ?
Publié le 18/04/2009

Extrait du document
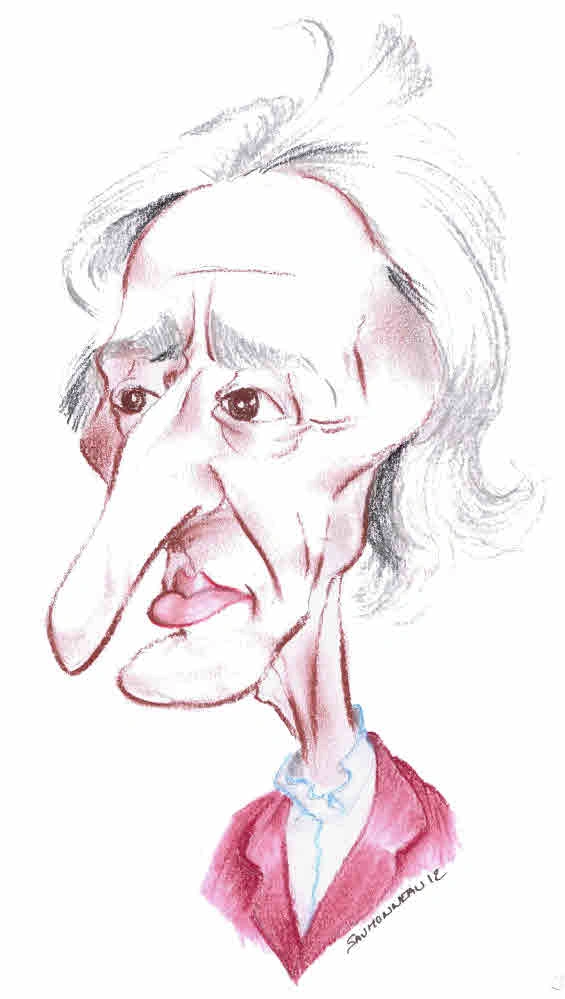
On distingue traditionnellement les connaissances innées des connaissances acquises. Le terme d'« inné « vient du latin in-esse, qui signifie « dans l'être «. Est inné tout ce qui est inscrit dans notre être même, c'est-à-dire tout ce qui nous appartient par définition ou par essence, ou au sens chronologique, et non plus ontologique, tout ce avec quoi on naît : tout ce qui est inhérent à la nature d'un être et n'est pas issu de son expérience particulière. Tout ce qui est inné est donc, premièrement, essentiel, parce qu'inhérent à notre nature, universel, car cette nature étant la même pour tous cette donnée doit se retrouver à l'identique en chacun, éternel enfin, parce que ce qui nous appartient par nature nous appartient indépendamment du temps. L'inné s'oppose en ce sens à l'acquis qui désigne l'ensemble des qualités ou des connaissances que l'on acquiert par expérience, qui nous viennent du dehors et ne sont donc pas inscrites dans notre être même. L'expérience étant particulière par opposition à la nature humaine, il s'en suit que l'acquis qui en dépend est lui-même particulier, c'est-à-dire susceptible de varier d'un individu à l'autre, puis accidentel et contingent, la variabilité des cas prouvant qu'aucun n'est par lui-même nécessaire, éphémère enfin, car tout ce qui a eu son début dans le temps y trouvera aussi sa fin. Cette distinction de l'inné et de l'acquis étant donnée, on comprend que toutes les connaissances universelles et nécessaires, ou plus généralement toutes les règles et les principes qui paraissent absolument certains, aient pu passer pour innés. Si un principe est universellement admis, nécessaire en soi, c'est parce qu'il est inné, dit-on, sans que l'on ait à chercher au-delà.
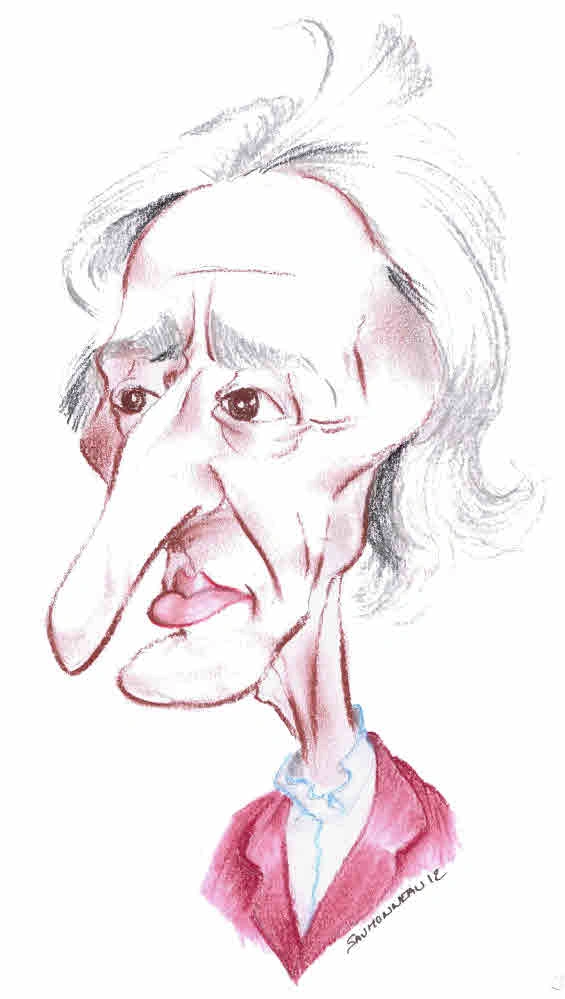
«
postuler leur innéité.
C'est le cas de la règle qui affirme que l'on doit respecter les contrats que l'on a passés avecautrui, qui est pris pour exemple.Les partisans de l'innéisme remarquent que cette maxime est admise par tous : les gens « honnêtes » la suiventparce qu'ils voient en elle un principe juste, qu'il faut suivre par amour de la justice, tandis que les « malfaiteurs »l'admettent parce qu'elle leur permet de s'associer et de mieux s'opposer à la justice.
Dans un cas comme dansl'autre le principe est admis, bien que les motifs divergent, et le fait qu'il soit également reçu par des contrairesmontre qu'il est universellement valable.
S'il s'impose également à eux en dépit de leur différence, c'est parce qu'ilest vrai en soi, dit-on, c'est-à-dire vrai indépendamment des sujets et de leur expérience particulière.
Lesthéoriciens de l'innéisme justifient ainsi leur thèse.
Le fait qu'un principe puisse être universellement admis montrequ'il existe en nous, indépendamment de l'expérience : qu'il est inné et non acquis.Or c'est ce raisonnement que conteste Locke en lui objectant deux arguments.
Le premier est historique, empruntéà l'expérience : « l'histoire de l'humanité » suffit à réfuter la thèse de l'innéisme, en fournissant de nombreux contre-exemples montrant que la prétendue universalité qu'elle cherche à justifier n'est en réalité qu'une invention, née del'imagination de métaphysiciens peu scrupuleux.
Si les idées innées existaient en effet et faisaient l'unanimité commeon le prétend, tout le monde serait d'accord et il n'y aurait pas de « problème », ni d'histoire, ce qui n'estévidemment pas le cas.
L'innéisme est par principe anhistorique, parce qu'il conclut à l'éternité de ses idées.
Niantl'histoire, il n'est pas étonnant qu'il soit naturellement réfuté par elle.
Quiconque a le sens historique refusera cettethéorie qui confond l'absolu et le relatif, en prenant pour éternel ce qui n'est peut-être qu'un préjugé.Le second argument de Locke est purement logique et rationnel.
« On ne peut concevoir », nous dit-il, que lebrigand et l'honnête homme admettent réellement un principe de justice, selon lequel « il faut tenir parole ».
Ceserait contradictoire, car le malfaiteur contredirait immédiatement la règle que l'on prétend lui faire embrasser.
Entrompant, en pillant ou en assassinant l'honnête homme après s'être entendu avec son complice, il accepterait etrefuserait simultanément sa maxime.
Il faut donc admettre que la thèse de l'innéisme conduit ici à une antinomie, àune contradiction dans les lois.
Elle s'avère incohérente, illogique, et donc inintelligible.
La prétendue universalité dela loi invoquée n'est aussi bien qu'une illusion, un trompe-l'œil ou un piège de la langue qui nous fait croire que lesidées sont les mêmes alors que ce ne sont que les mots.
Ce n'est pas pour les mêmes raisons que les hommesobéissent aux lois et celles-ci n'ont pas le même sens pour eux.
En dépit des apparences, ce ne sont pas les mêmesidées et on ne peut donc pas les prétendre innées.La réfutation de la thèse de l'innéisme s'opère ainsi en deux temps.
Elle permet à Locke d'établir la sienne qui n'estd'abord que négative : l'universalité des principes pratiques n'est pas absolue et sans faille.
Elle admet desexceptions et l'on ne peut donc tenir ces maximes pour des « Lois de Nature innées », parce qu'étant particulièreset contingentes, elles ne correspondent pas à l'idée que l'on se fait de ces dernières.
Il faut donc expliquerl'existence de ces règles en se référant à un autre principe que l'innéisme et les fonder ailleurs que dans laconscience, le monde des idées ou le ciel de l'éternité.Comment comprendre que tous les hommes puissent tenir certains principes pour vrais ? Comment pourraient-ilssans cela se conserver, agir ensemble et vivre en société ? Sur quoi fonder la morale et la vie en société ?
III.
Thèse : l'utilité explique l'universalité des principes moraux
Locke répond à cette question par l'expérience, l'usage ou l'utilité, c'est-à-dire par la pratique elle-même.
C'est lecorollaire positif de la thèse négative précédemment établie.
« Ces règles ne sont pas respectées comme des Loisde Nature innées, nous dit-il en parlant des principes des malfaiteurs : elles sont appliquées comme des règles utilesdans leur communauté.
» Est en effet utile ce qui est voulu non pour lui-même mais pour autre chose, à titre demoyen, non comme une fin en soi.
L'utile se distingue ainsi du souverain bien qui est voulu pour lui-même, non pourautre chose, comme une fin en soi.
Si les brigands respectent les contrats qu'ils passent entre eux, ce n'est pasparce qu'ils pensent que c'est bien, nous dit ici Locke, car on ne comprendrait plus alors qu'ils puissent nuire auxgens honnêtes.
C'est parce que c'est utile à leur conservation, qui est leur seule véritable fin.
Tout le reste lui estsubordonné à titre de moyen.
Les principes pratiques n'ont de sens et de valeur que parce qu'ils permettent del'atteindre et c'est ainsi que le brigand tient ou non parole, selon que cela s'avère utile ou nuisible à saconservation.
C'est donc la fin qui demeure constante.
C'est elle qui permet de comprendre la raison de l'action deshommes, non les idées ou les moyens que l'on aurait tort de prendre pour des impératifs absolus gravés de touteéternité dans notre âme.
La conclusion vaut pour l'humanité en général.
C'est sur l'utilité et l'expérience qu'il fautfonder la pratique.
C'est en elles qu'il faut chercher le principe de la rationalité humaine.
Conclusion
L'analyse de Locke permet ainsi de mettre à jour le fondement de la morale sans faire de métaphysique.
À ladifférence de l'innéisme qui doit invoquer des idées éternelles et transcendantes pour expliquer les phénomènes,notre auteur ne fait ici appel qu'à l'expérience pour expliquer l'expérience, et rend compte de la pratique de façonimmanente.
C'est l'utilité, non l'innéité, qui fonde l'universalité des principes moraux et qui permet de comprendre lesexceptions dont l'histoire offre le témoigne.
Il faut donc se représenter l'âme comme une tablette vierge sur laquellel'expérience vient inscrire ses principes, sans rien d'inné ou de préalablement gravé.
C'est ainsi, plutôt que par ledoute, que l'on purge l'âme de tous ses préjugés et que l'on se libère l'esprit, ce qui est le but de Locke..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VÉRITÉ ET JUSTICE (résumé & analyse de l’oeuvre)
- Locke, Traité du gouvernement civil: La liberté; la justice et le droit; la société et l'État; le bonheur; autrui (la politique).
- L'idée de vérité est-elle intégralement définie par les principes de la Logique ?
- Quels sont les principes de la justice ?
- LES PRINCIPES DE LA JUSTICE