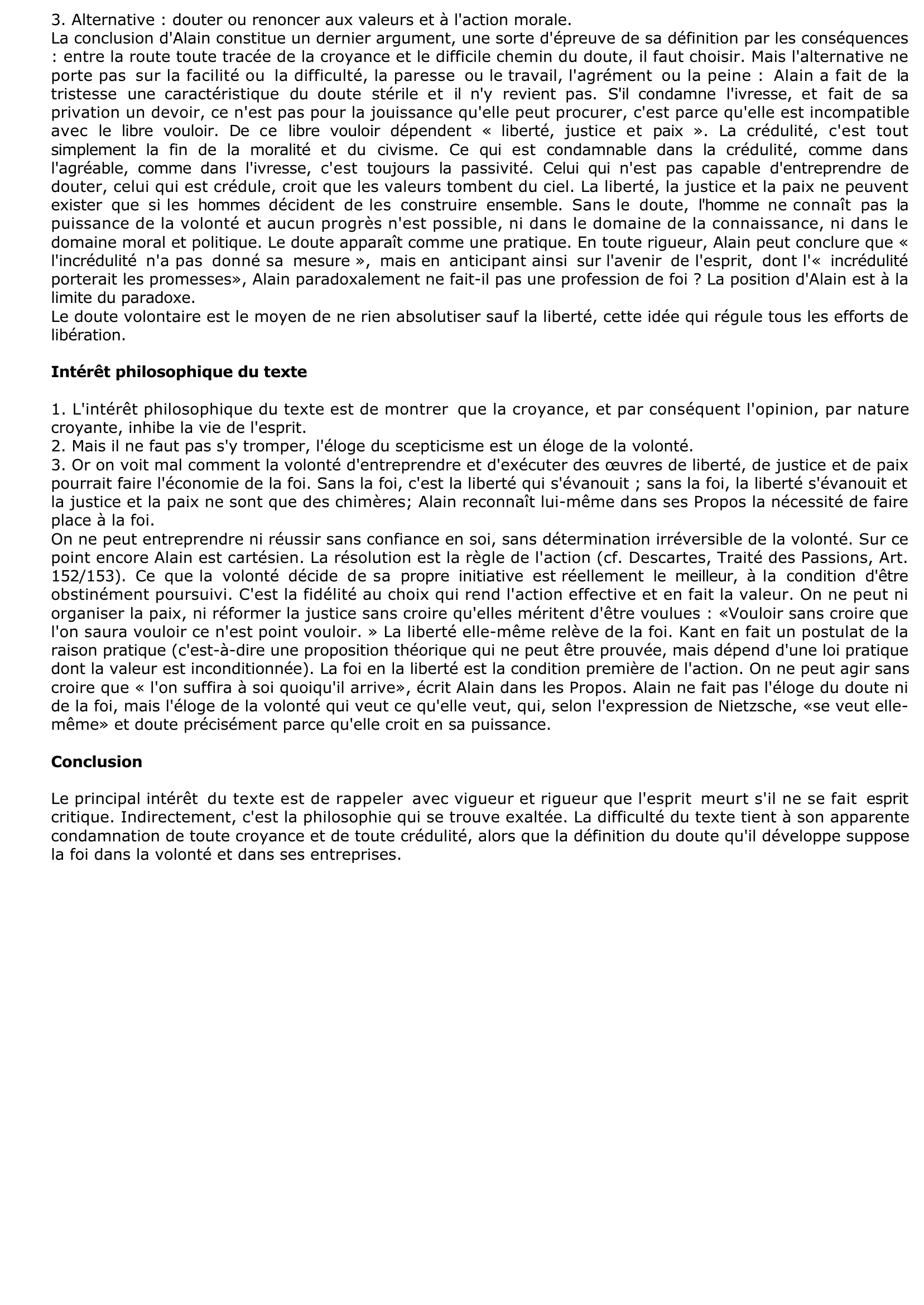Montesquieu: Un homme peut-il se vendre ?
Publié le 17/04/2009

Extrait du document
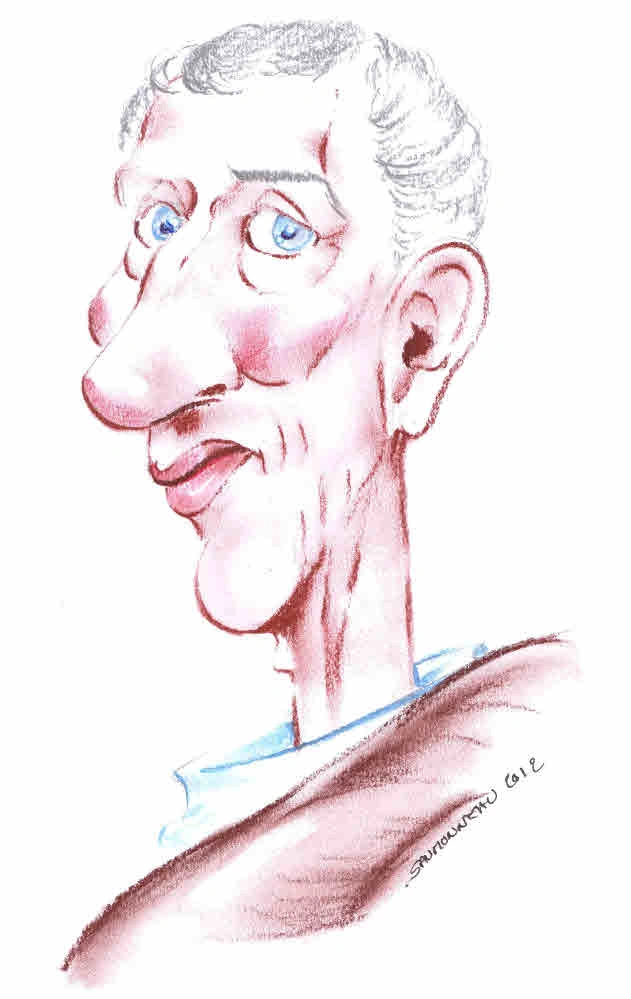
• Les arguments avancés par Montesquieu pour démontrer qu' « il n'est pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre « sont-ils tous de même nature ? Relèvent-ils tous du même domaine ? • Y a-t-il lieu d'opérer des distinctions entre se vendre ; être vendu; se louer; vendre sa force de travail, etc. ? — Qu'est-ce finalement, qui ne peut être vendu ? — Et par qui? • S'agit-il du fait? Ou de la légitimité du fait? • En quoi la formule « mais le pécule est accessoire à la personne « répond-elle à une objection ? • Y a-t-il contradiction entre affirmer « il n'est pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix « et « si la liberté a un prix pour celui qui l'achète... « ? • En quoi la phrase « cette qualité, dans l'Etat populaire, est même une partie de la souveraineté « intervient-elle dans l'argumentation de Montesquieu ? — Cela signifie-t-il que ce qu'il affirme n'est vrai que dans un Etat populaire ? • Signification des deux dernières phrases du texte dans l'argumentation de Montesquieu et dans la thèse qu'il cherche à établir ? • En définitive, quelle est cette thèse ? • En quoi présente-t-elle un intérêt philosophique ? • Que pensez-vous de l'argumentation de Montesquieu ?
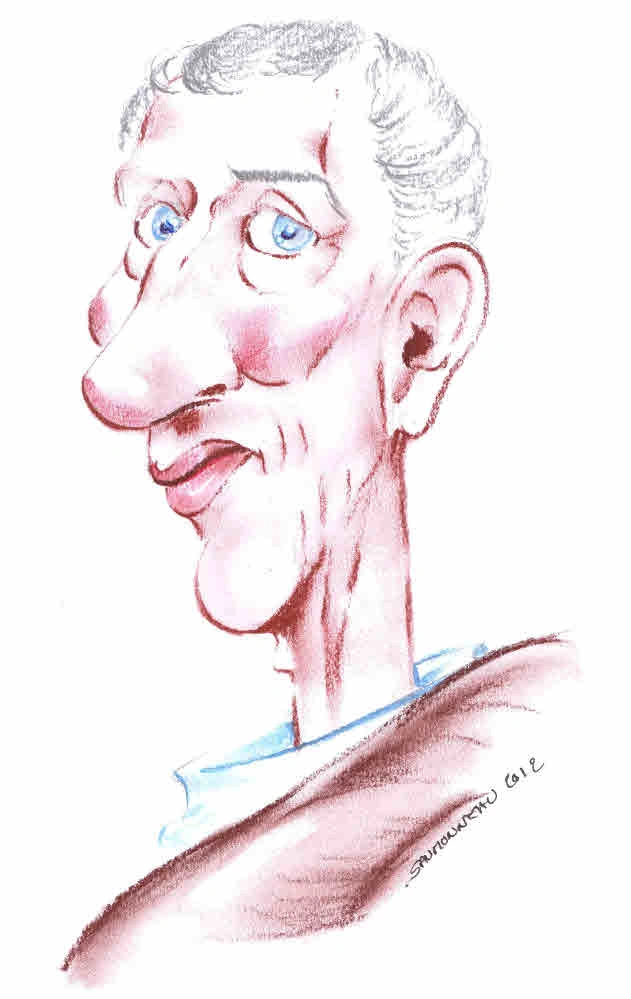
«
3.
Alternative : douter ou renoncer aux valeurs et à l'action morale.La conclusion d'Alain constitue un dernier argument, une sorte d'épreuve de sa définition par les conséquences: entre la route toute tracée de la croyance et le difficile chemin du doute, il faut choisir.
Mais l'alternative neporte pas sur la facilité ou la difficulté, la paresse ou le travail, l'agrément ou la peine : Alain a fait de latristesse une caractéristique du doute stérile et il n'y revient pas.
S'il condamne l'ivresse, et fait de saprivation un devoir, ce n'est pas pour la jouissance qu'elle peut procurer, c'est parce qu'elle est incompatibleavec le libre vouloir.
De ce libre vouloir dépendent « liberté, justice et paix ».
La crédulité, c'est toutsimplement la fin de la moralité et du civisme.
Ce qui est condamnable dans la crédulité, comme dansl'agréable, comme dans l'ivresse, c'est toujours la passivité.
Celui qui n'est pas capable d'entreprendre dedouter, celui qui est crédule, croit que les valeurs tombent du ciel.
La liberté, la justice et la paix ne peuventexister que si les hommes décident de les construire ensemble.
Sans le doute, l'homme ne connaît pas lapuissance de la volonté et aucun progrès n'est possible, ni dans le domaine de la connaissance, ni dans ledomaine moral et politique.
Le doute apparaît comme une pratique.
En toute rigueur, Alain peut conclure que «l'incrédulité n'a pas donné sa mesure », mais en anticipant ainsi sur l'avenir de l'esprit, dont l'« incrédulitéporterait les promesses», Alain paradoxalement ne fait-il pas une profession de foi ? La position d'Alain est à lalimite du paradoxe.Le doute volontaire est le moyen de ne rien absolutiser sauf la liberté, cette idée qui régule tous les efforts delibération.
Intérêt philosophique du texte
1.
L'intérêt philosophique du texte est de montrer que la croyance, et par conséquent l'opinion, par naturecroyante, inhibe la vie de l'esprit.2.
Mais il ne faut pas s'y tromper, l'éloge du scepticisme est un éloge de la volonté.3.
Or on voit mal comment la volonté d'entreprendre et d'exécuter des œuvres de liberté, de justice et de paixpourrait faire l'économie de la foi.
Sans la foi, c'est la liberté qui s'évanouit ; sans la foi, la liberté s'évanouit etla justice et la paix ne sont que des chimères; Alain reconnaît lui-même dans ses Propos la nécessité de faireplace à la foi.On ne peut entreprendre ni réussir sans confiance en soi, sans détermination irréversible de la volonté.
Sur cepoint encore Alain est cartésien.
La résolution est la règle de l'action (cf.
Descartes, Traité des Passions, Art.152/153).
Ce que la volonté décide de sa propre initiative est réellement le meilleur, à la condition d'êtreobstinément poursuivi.
C'est la fidélité au choix qui rend l'action effective et en fait la valeur.
On ne peut niorganiser la paix, ni réformer la justice sans croire qu'elles méritent d'être voulues : «Vouloir sans croire quel'on saura vouloir ce n'est point vouloir.
» La liberté elle-même relève de la foi.
Kant en fait un postulat de laraison pratique (c'est-à-dire une proposition théorique qui ne peut être prouvée, mais dépend d'une loi pratiquedont la valeur est inconditionnée).
La foi en la liberté est la condition première de l'action.
On ne peut agir sanscroire que « l'on suffira à soi quoiqu'il arrive», écrit Alain dans les Propos.
Alain ne fait pas l'éloge du doute nide la foi, mais l'éloge de la volonté qui veut ce qu'elle veut, qui, selon l'expression de Nietzsche, «se veut elle-même» et doute précisément parce qu'elle croit en sa puissance.
Conclusion
Le principal intérêt du texte est de rappeler avec vigueur et rigueur que l'esprit meurt s'il ne se fait espritcritique.
Indirectement, c'est la philosophie qui se trouve exaltée.
La difficulté du texte tient à son apparentecondamnation de toute croyance et de toute crédulité, alors que la définition du doute qu'il développe supposela foi dans la volonté et dans ses entreprises..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte de Montesquieu - De l'esprit des lois: « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » ... « par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir »
- Commentaire de texte de Montesquieu : De l'esprit des lois : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'à point de Constitution ». Cette disposition de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 que l'on trouve en son article 16 constitue encore de nos jours une valeur essentielle.
- Montesquieu : Ce qui différencie l'homme de l'animal
- Arrias, L'homme universel, de La Bruyère (Caractères, chap. v, n° 9), et le Décisionnaire des Lettres Persanes de Montesquieu (LXXII).
- Arrias, l'homme universel, de La Bruyère (Caractères, chap. V, n° 9), et le Décisionnaire des Lettres Persanes de Montesquieu (LXXII)