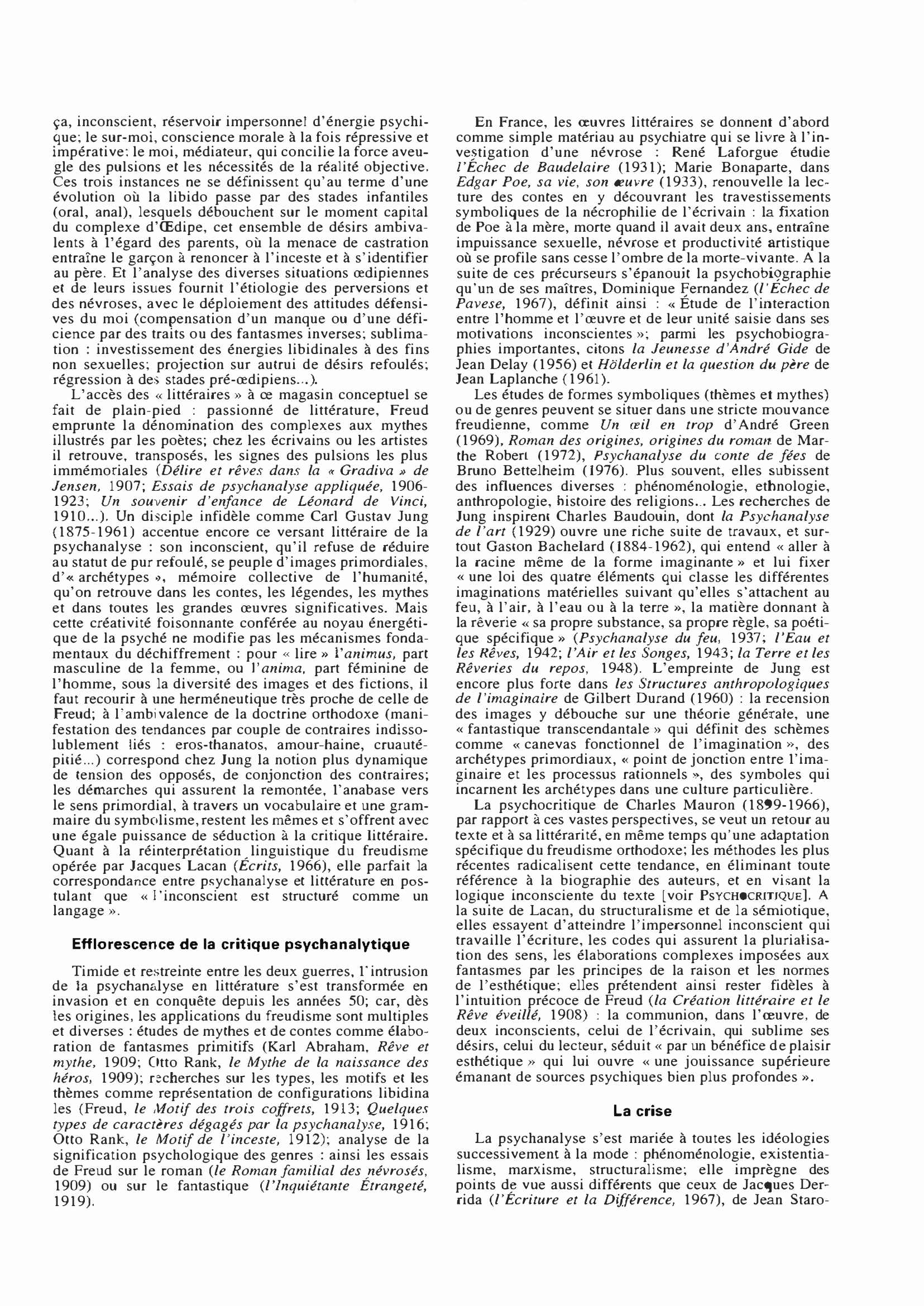PSYCHANALYSE ET LITTÉRATURE
Publié le 27/11/2018

Extrait du document
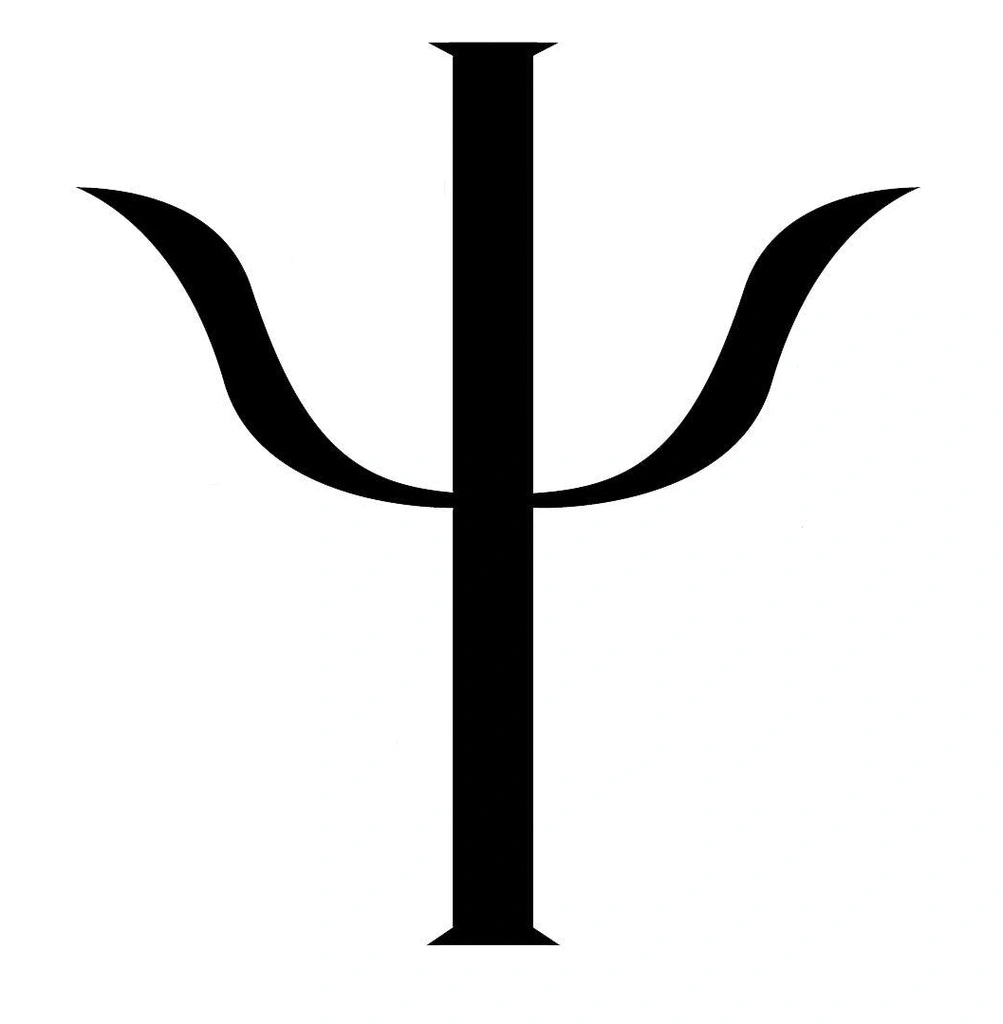
PSYCHANALYSE ET LITTÉRATURE. La psychana-lyse apporte moins à la recherche et à la critique littéraires une méthode ou des outils précis qu’un sentiment de
puissance et d’euphorie. Depuis deux millénaires, les moralistes avaient répertorié intentions, volontés, passions et raffiné dans la cartographie théorique de l’esprit et du cœur humains; l’histoire littéraire, au xixe siècle, pouvait employer ces mécanismes psychologiques pour expliquer les hommes et les œuvres; or, à l’époque même où triomphe le positivisme, à la suite de Schopenhauer et de Nietzsche, on commence de pressentir les motivations inconscientes des comportements conscients : si le véritable «je » est un autre, le rationalisme analytique de la psychologie classique est un leurre. Proust sépare radicalement le moi social du moi créateur, et Paul Valéry écrit que l'acte de création « est indépendant des aventures, du genre de vie, des incidents, et de tout ce qui peut figurer dans une biographie. Tout ce que l’histoire littéraire peut observer est insignifiant ». Freud apparaît alors; véritable Newton de l’explication psychologique et textuelle, il ouvre à la critique un espace nouveau : celui de l’inconscient, qui affleure en symboles dans l’œuvre littéraire; il rend à l’herméneute ses droits, son prestige, et un territoire vierge à posséder. Mais les déceptions et les interrogations suivent de près l’ivresse de la découverte et l’efflorescence des théories ou des interprétations.
L'herméneutique freudienne
Élaborée à partir de 1900 par le médecin viennois Sigmund Freud (1856-1939), la psychanalyse est d’abord une thérapeutique fondée sur une investigation psychologique; elle se propose de ramener à la conscience les événements ou les sentiments refoulés et d’atténuer ainsi certaines perturbations mentales. Elle considère la vie intérieure comme une scène où les pulsions — et leurs représentations idéatives —, refoulées par un mécanisme de censure, rusent ou se déguisent pour s’exprimer, et où le moi se contorsionne pour les repousser ou les rendre compatibles avec les exigences sociales : la libido se trahit dans le rire, les lapsus, les actes manqués, et surtout dans les rêves que le psychiatre doit décrypter pour en découvrir le sens latent sous leur agencement manifeste. Dans ses premiers ouvrages (l'Interprétation des rêves, 1900; le Rêve et son interprétation, 1901), Freud établit les règles de transformation (« processus primaires ») qui régissent le passage des contenus inconscients aux représentations fantasmatiques de la vie onirique : la figuration par l’image; la condensation (un symbolisant peut condenser plusieurs symbolisés et, inversement, plusieurs symboles peuvent ne renvoyer qu’à un seul symbolisé); le déplacement, qui dissimule l’important en le réduisant au rang d'accessoire; l’élaboration secondaire, organisation des images symboliques en un ensemble ou une histoire grossièrement rationnels. Or Freud lui-même souligne la ressemblance entre le rêve éveillé et la création littéraire « en laquelle les désirs profonds, infantiles, archaïques, inconscients de l’artiste trouvent, sur un mode fictif et plus ou moins déguisé, à se satisfaire »; et Marie Bonaparte, sa disciple, postule une analogie : « Les œuvres littéraires et artistiques des hommes révèlent leur plus intime psychologie et sont édifiées [...] à la façon des rêves de nous tous ».
Ainsi l’herméneutique freudienne — science et art de l’interprétation —, appliquée aux textes littéraires, retrouve une des sources de l’intuition psychanalytique, tout en bénéficiant des outils théoriques complexes qu’ont forgés la lecture des rêves et le traitement des névroses : une dynamique, avec la théorie des pulsions (sources somatiques de la vie psychique); à l’instinct de mort (thanatos), qui tend à ramener le biologique à l’inorganique, s’opposent les pulsions de vie (eros, libido), elles-mêmes partagées en pulsion sexuelle et pulsion du moi (instinct de conservation). Une topique : le ça, inconscient, réservoir impersonnel d’énergie psychique; le sur-moi, conscience morale à la fois répressive et impérative; le moi, médiateur, qui concilie la force aveugle des pulsions et les nécessités de la réalité objective. Ces trois instances ne se définissent qu’au terme d’une évolution où la libido passe par des stades infantiles (oral, anal), lesquels débouchent sur le moment capital du complexe d’Œdipe, cet ensemble de désirs ambivalents à l’égard des parents, où la menace de castration entraîne le garçon à renoncer à l’inceste et à s’identifier au père. Et l’analyse des diverses situations œdipiennes et de leurs issues fournit l’étiologie des perversions et des névroses, avec le déploiement des attitudes défensives du moi (compensation d’un manque ou d’une déficience par des traits ou des fantasmes inverses; sublimation : investissement des énergies libidinales à des fins non sexuelles; projection sur autrui de désirs refoulés; régression à des stades pré-œdipiens...).
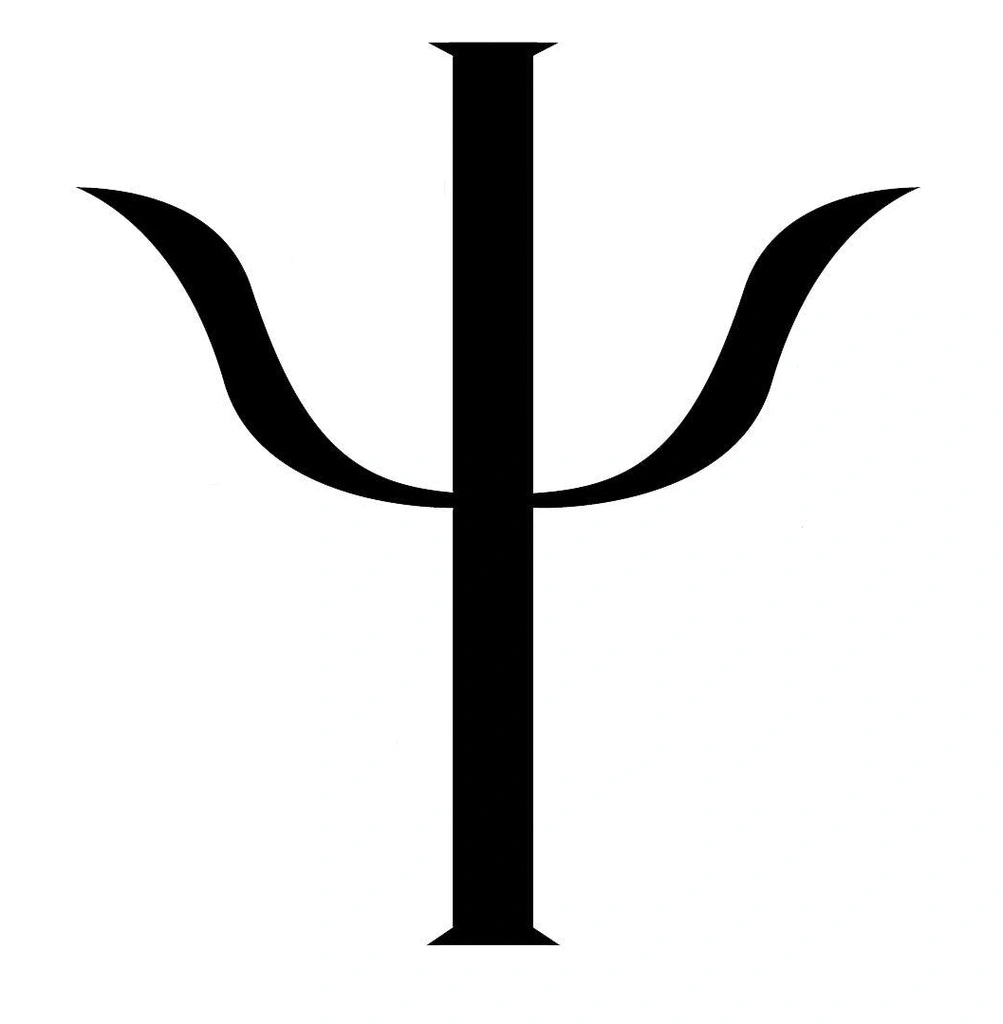
«
ça,
inconscient, réservoir impersonnel d'énergie psychi
que; le sur-moi, conscience morale à la fois répressive et
impérative; le moi, médiateur, qui concilie la force aveu
gle des pulsions et les nécessités de la réalité objective.
Ces trois instances ne se définissent qu'au terme d'une
évolution où la libido passe par des stades infantiles
(oral, anal), lesquels débouchent sur le moment capital
du complexe d'Œdipe, cet ensemble de désirs ambiva
lents à 1 'égard des parents, où la menace de castration
entraîne le garçon à renoncer à l'inceste et à s'identifier
au père.
Et l'analyse des diverses situations œdipiennes
et de leurs issues fournit l'étiologie des perversions et
des névroses, avec le déploiement des attitudes défensi
ves du moi (compensation d'un manque ou d'une défi
cience par des traits ou des fantasmes inverses; sublima
tion : investissement des énergies libidinales à des fins
non sexuelles; projection sur autrui de désirs refoulés;
régression à de:; stades pré-œdipiens ...
).
L'accès des «littéraires» à ce magasin conceptuel se
fait de plain-pied : passionné de littérature, Freud
emprunte la dénomination des complexes aux mythes
illustrés par les poètes; chez les écrivains ou les artistes
il retrouve, transposés, les signes des pulsions les plus
immémoriales (Délire et rêves dans la > de
Jensen, 1907; Essais de psychanalyse appliquée, 1906-
1923; Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci,
1910 ...
).
Un disciple infidèle comme Carl Gustav Jung
(1875-1961) accentue encore ce versant littéraire de la
psychanalyse : son inconscient, qu'il refuse de réduire
au statut de pur refoulé, se peuple d'images primordiales,
d'« archétypes •>, mémoire collective de l'humanité,
qu'on retrouve dans les contes, les légendes, les mythes
et dans toutes les grandes œuvres significatives.
Mais
cette créativité foisonnante conférée au noyau énergéti
que de la psyché ne modifie pas les mécanismes fonda
mentaux du déchiffrement : pour.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame Bovary et la littérature sentimentale
- l'histoire de la littérature
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)
- Fiche pédagogique Littérature francophone
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?