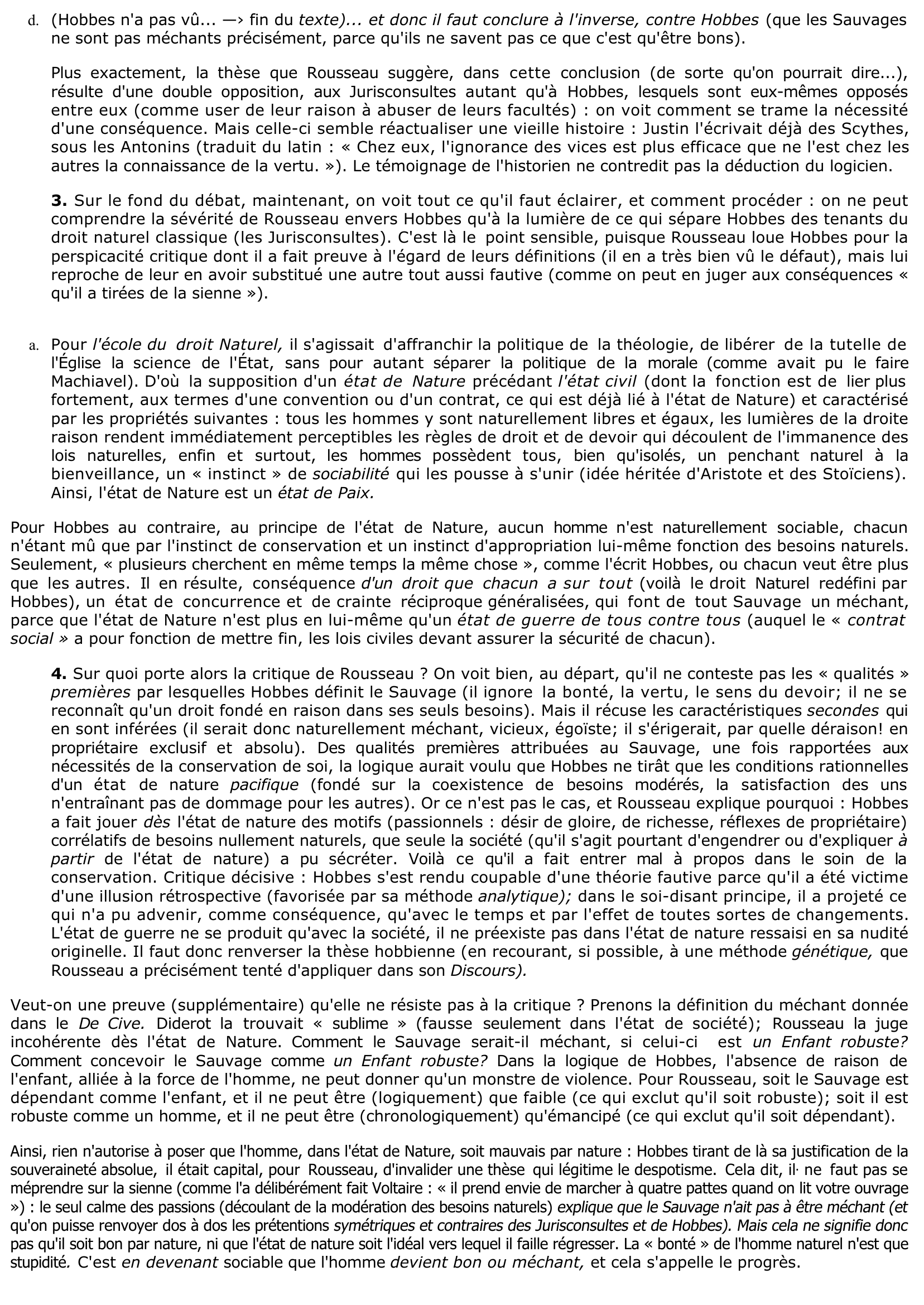ROUSSEAU ET HOBBES
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
c.
(Hobbes n'a pas vû...
—› fin du texte)...
et donc il faut conclure à l'inverse, contre Hobbes (que les Sauvages ne sont pas méchants précisément, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être bons).d.
Plus exactement, la thèse que Rousseau suggère, dans cette conclusion (de sorte qu'on pourrait dire...),résulte d'une double opposition, aux Jurisconsultes autant qu'à Hobbes, lesquels sont eux-mêmes opposésentre eux (comme user de leur raison à abuser de leurs facultés) : on voit comment se trame la nécessitéd'une conséquence.
Mais celle-ci semble réactualiser une vieille histoire : Justin l'écrivait déjà des Scythes,sous les Antonins (traduit du latin : « Chez eux, l'ignorance des vices est plus efficace que ne l'est chez lesautres la connaissance de la vertu.
»).
Le témoignage de l'historien ne contredit pas la déduction du logicien.
3.
Sur le fond du débat, maintenant, on voit tout ce qu'il faut éclairer, et comment procéder : on ne peutcomprendre la sévérité de Rousseau envers Hobbes qu'à la lumière de ce qui sépare Hobbes des tenants dudroit naturel classique (les Jurisconsultes).
C'est là le point sensible, puisque Rousseau loue Hobbes pour laperspicacité critique dont il a fait preuve à l'égard de leurs définitions (il en a très bien vû le défaut), mais luireproche de leur en avoir substitué une autre tout aussi fautive (comme on peut en juger aux conséquences «qu'il a tirées de la sienne »).
Pour l'école du droit Naturel, il s'agissait d'affranchir la politique de la théologie, de libérer de la tutelle de l'Église la science de l'État, sans pour autant séparer la politique de la morale (comme avait pu le faireMachiavel).
D'où la supposition d'un état de Nature précédant l'état civil (dont la fonction est de lier plus fortement, aux termes d'une convention ou d'un contrat, ce qui est déjà lié à l'état de Nature) et caractérisépar les propriétés suivantes : tous les hommes y sont naturellement libres et égaux, les lumières de la droiteraison rendent immédiatement perceptibles les règles de droit et de devoir qui découlent de l'immanence deslois naturelles, enfin et surtout, les hommes possèdent tous, bien qu'isolés, un penchant naturel à labienveillance, un « instinct » de sociabilité qui les pousse à s'unir (idée héritée d'Aristote et des Stoïciens). Ainsi, l'état de Nature est un état de Paix.
a.
Pour Hobbes au contraire, au principe de l'état de Nature, aucun homme n'est naturellement sociable, chacunn'étant mû que par l'instinct de conser vation et un instinct d'appropriation lui-même fonction des besoins naturels. Seulement, « plusieurs cherchent en même temps la même chose », comme l'écrit Hobbes, ou chacun veut être plusque les autres.
Il en résulte, conséquence d'un droit que chacun a sur tout (voilà le droit Naturel redéfini par Hobbes), un état de concurrence et de crainte réciproque généralisées, qui font de tout Sauvage un méchant,parce que l'état de Nature n'est plus en lui-même qu'un état de guerre de tous contre tous (auquel le « contrat social » a pour fonction de mettre fin, les lois civiles devant assurer la sécurité de chacun).
4.
Sur quoi porte alors la critique de Rousseau ? On voit bien, au départ, qu'il ne conteste pas les « qualités »premières par lesquelles Hobbes définit le Sauvage (il ignore la bonté, la vertu, le sens du devoir; il ne se reconnaît qu'un droit fondé en raison dans ses seuls besoins).
Mais il récuse les caractéristiques secondes qui en sont inférées (il serait donc naturellement méchant, vicieux, égoïste; il s'érigerait, par quelle déraison! enpropriétaire exclusif et absolu).
Des qualités premières attribuées au Sauvage, une fois rapportées auxnécessités de la conservation de soi, la logique aurait voulu que Hobbes ne tirât que les conditions rationnellesd'un état de nature pacifique (fondé sur la coexistence de besoins modérés, la satisfaction des uns n'entraînant pas de dommage pour les autres).
Or ce n'est pas le cas, et Rousseau explique pourquoi : Hobbesa fait jouer dès l'état de nature des motifs (passionnels : désir de gloire, de richesse, réflexes de propriétaire) corrélatifs de besoins nullement naturels, que seule la société (qu'il s'agit pourtant d'engendrer ou d'expliquer à partir de l'état de nature) a pu sécréter.
Voilà ce qu'il a fait entrer mal à propos dans le soin de la conservation.
Critique décisive : Hobbes s'est rendu coupable d'une théorie fautive parce qu'il a été victimed'une illusion rétrospective (favorisée par sa méthode analytique); dans le soi-disant principe, il a projeté ce qui n'a pu advenir, comme conséquence, qu'avec le temps et par l'effet de toutes sortes de changements.L'état de guerre ne se produit qu'avec la société, il ne préexiste pas dans l'état de nature ressaisi en sa nuditéoriginelle.
Il faut donc renverser la thèse hobbienne (en recourant, si possible, à une méthode génétique, que Rousseau a précisément tenté d'appliquer dans son Discours).
Veut-on une preuve (supplémentaire) qu'elle ne résiste pas à la critique ? Prenons la définition du méchant donnéedans le De Cive.
Diderot la trouvait « sublime » (fausse seulement dans l'état de société); Rousseau la juge incohérente dès l'état de Nature.
Comment le Sauvage serait-il méchant, si celui-ci est un Enfant robuste? Comment concevoir le Sauvage comme un Enfant robuste? Dans la logique de Hobbes, l'absence de raison de l'enfant, alliée à la force de l'homme, ne peut donner qu'un monstre de violence.
Pour Rousseau, soit le Sauvage estdépendant comme l'enfant, et il ne peut être (logiquement) que faible (ce qui exclut qu'il soit robuste); soit il estrobuste comme un homme, et il ne peut être (chronologiquement) qu'émancipé (ce qui exclut qu'il soit dépendant).
Ainsi, rien n'autorise à poser que l'homme, dans l'état de Nature, soit mauvais par nature : Hobbes tirant de là sa justification de lasouveraineté absolue, il était capital, pour Rousseau, d'invalider une thèse qui légitime le despotisme.
Cela dit, il .
ne faut pas se méprendre sur la sienne (comme l'a délibérément fait Voltaire : « il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage») : le seul calme des passions (découlant de la modération des besoins naturels) explique que le Sauvage n'ait pas à être méchant (et qu'on puisse renvoyer dos à dos les prétentions symétriques et contraires des Jurisconsultes et de Hobbes).
Mais cela ne signifie donc pas qu'il soit bon par nature, ni que l'état de nature soit l'idéal vers lequel il faille régresser.
La « bonté » de l'homme naturel n'est questupidité .
C'est en devenant sociable que l'homme devient bon ou méchant, et cela s'appelle le progrès..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quelle conception de la nature humaine vous semble la plus crédible? La guerre de chacun contre chacun de Hobbes ou la bonté naturelle de Rousseau? L’état de nature est hobbésien ou rousseauiste?
- Dissertation sur Hobbes et Rousseau
- fiche de lecture sur Rousseau, du contrat social chapitre 1 et 4, Hobbes le léviathan chapitre 13 et 14
- Rousseau, disciple de Hobbes ?
- Rousseau versus Hobbes