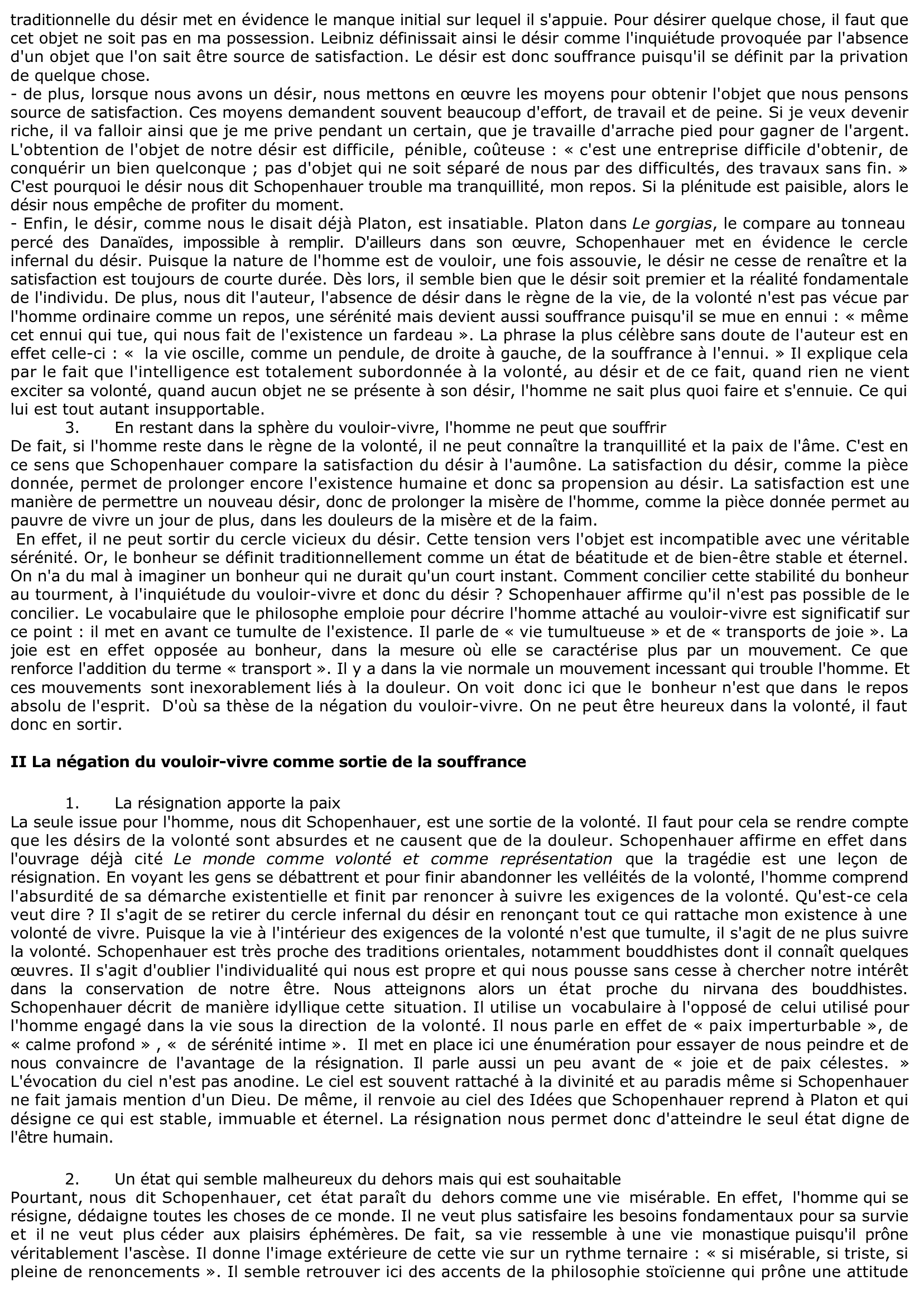Schopenhauer et la négation du vouloir-vivre
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
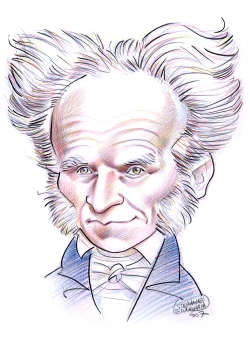
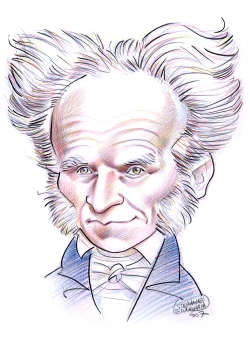
«
traditionnelle du désir met en évidence le manque initial sur lequel il s'appuie.
Pour désirer quelque chose, il faut quecet objet ne soit pas en ma possession.
Leibniz définissait ainsi le désir comme l'inquiétude provoquée par l'absenced'un objet que l'on sait être source de satisfaction.
Le désir est donc souffrance puisqu'il se définit par la privationde quelque chose.- de plus, lorsque nous avons un désir, nous mettons en œuvre les moyens pour obtenir l'objet que nous pensonssource de satisfaction.
Ces moyens demandent souvent beaucoup d'effort, de travail et de peine.
Si je veux devenirriche, il va falloir ainsi que je me prive pendant un certain, que je travaille d'arrache pied pour gagner de l'argent.L'obtention de l'objet de notre désir est difficile, pénible, coûteuse : « c'est une entreprise difficile d'obtenir, deconquérir un bien quelconque ; pas d'objet qui ne soit séparé de nous par des difficultés, des travaux sans fin.
»C'est pourquoi le désir nous dit Schopenhauer trouble ma tranquillité, mon repos.
Si la plénitude est paisible, alors ledésir nous empêche de profiter du moment.- Enfin, le désir, comme nous le disait déjà Platon, est insatiable.
Platon dans Le gorgias , le compare au tonneau percé des Danaïdes, impossible à remplir.
D'ailleurs dans son œuvre, Schopenhauer met en évidence le cercleinfernal du désir.
Puisque la nature de l'homme est de vouloir, une fois assouvie, le désir ne cesse de renaître et lasatisfaction est toujours de courte durée.
Dès lors, il semble bien que le désir soit premier et la réalité fondamentalede l'individu.
De plus, nous dit l'auteur, l'absence de désir dans le règne de la vie, de la volonté n'est pas vécue parl'homme ordinaire comme un repos, une sérénité mais devient aussi souffrance puisqu'il se mue en ennui : « mêmecet ennui qui tue, qui nous fait de l'existence un fardeau ».
La phrase la plus célèbre sans doute de l'auteur est eneffet celle-ci : « la vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui.
» Il explique celapar le fait que l'intelligence est totalement subordonnée à la volonté, au désir et de ce fait, quand rien ne vientexciter sa volonté, quand aucun objet ne se présente à son désir, l'homme ne sait plus quoi faire et s'ennuie.
Ce quilui est tout autant insupportable. 3.
En restant dans la sphère du vouloir-vivre, l'homme ne peut que souffrir De fait, si l'homme reste dans le règne de la volonté, il ne peut connaître la tranquillité et la paix de l'âme.
C'est ence sens que Schopenhauer compare la satisfaction du désir à l'aumône.
La satisfaction du désir, comme la piècedonnée, permet de prolonger encore l'existence humaine et donc sa propension au désir.
La satisfaction est unemanière de permettre un nouveau désir, donc de prolonger la misère de l'homme, comme la pièce donnée permet aupauvre de vivre un jour de plus, dans les douleurs de la misère et de la faim.
En effet, il ne peut sortir du cercle vicieux du désir.
Cette tension vers l'objet est incompatible avec une véritablesérénité.
Or, le bonheur se définit traditionnellement comme un état de béatitude et de bien-être stable et éternel.On n'a du mal à imaginer un bonheur qui ne durait qu'un court instant.
Comment concilier cette stabilité du bonheurau tourment, à l'inquiétude du vouloir-vivre et donc du désir ? Schopenhauer affirme qu'il n'est pas possible de leconcilier.
Le vocabulaire que le philosophe emploie pour décrire l'homme attaché au vouloir-vivre est significatif surce point : il met en avant ce tumulte de l'existence.
Il parle de « vie tumultueuse » et de « transports de joie ».
Lajoie est en effet opposée au bonheur, dans la mesure où elle se caractérise plus par un mouvement.
Ce querenforce l'addition du terme « transport ».
Il y a dans la vie normale un mouvement incessant qui trouble l'homme.
Etces mouvements sont inexorablement liés à la douleur.
On voit donc ici que le bonheur n'est que dans le reposabsolu de l'esprit.
D'où sa thèse de la négation du vouloir-vivre.
On ne peut être heureux dans la volonté, il fautdonc en sortir.
II La négation du vouloir-vivre comme sortie de la souffrance 1.
La résignation apporte la paix La seule issue pour l'homme, nous dit Schopenhauer, est une sortie de la volonté.
Il faut pour cela se rendre compteque les désirs de la volonté sont absurdes et ne causent que de la douleur.
Schopenhauer affirme en effet dansl'ouvrage déjà cité Le monde comme volonté et comme représentation que la tragédie est une leçon de résignation.
En voyant les gens se débattrent et pour finir abandonner les velléités de la volonté, l'homme comprendl'absurdité de sa démarche existentielle et finit par renoncer à suivre les exigences de la volonté.
Qu'est-ce celaveut dire ? Il s'agit de se retirer du cercle infernal du désir en renonçant tout ce qui rattache mon existence à unevolonté de vivre.
Puisque la vie à l'intérieur des exigences de la volonté n'est que tumulte, il s'agit de ne plus suivrela volonté.
Schopenhauer est très proche des traditions orientales, notamment bouddhistes dont il connaît quelquesœuvres.
Il s'agit d'oublier l'individualité qui nous est propre et qui nous pousse sans cesse à chercher notre intérêtdans la conservation de notre être.
Nous atteignons alors un état proche du nirvana des bouddhistes.Schopenhauer décrit de manière idyllique cette situation.
Il utilise un vocabulaire à l'opposé de celui utilisé pourl'homme engagé dans la vie sous la direction de la volonté.
Il nous parle en effet de « paix imperturbable », de« calme profond » , « de sérénité intime ».
Il met en place ici une énumération pour essayer de nous peindre et denous convaincre de l'avantage de la résignation.
Il parle aussi un peu avant de « joie et de paix célestes.
»L'évocation du ciel n'est pas anodine.
Le ciel est souvent rattaché à la divinité et au paradis même si Schopenhauerne fait jamais mention d'un Dieu.
De même, il renvoie au ciel des Idées que Schopenhauer reprend à Platon et quidésigne ce qui est stable, immuable et éternel.
La résignation nous permet donc d'atteindre le seul état digne del'être humain.
2.
Un état qui semble malheureux du dehors mais qui est souhaitable Pourtant, nous dit Schopenhauer, cet état paraît du dehors comme une vie misérable.
En effet, l'homme qui serésigne, dédaigne toutes les choses de ce monde.
Il ne veut plus satisfaire les besoins fondamentaux pour sa survieet il ne veut plus céder aux plaisirs éphémères.
De fait, sa vie ressemble à une vie monastique puisqu'il prônevéritablement l'ascèse.
Il donne l'image extérieure de cette vie sur un rythme ternaire : « si misérable, si triste, sipleine de renoncements ».
Il semble retrouver ici des accents de la philosophie stoïcienne qui prône une attitude.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- IV LE NÉANT : LE TERME OU ABOUTIT LA NÉGATION DU VOULOIR-VIVRE A) SENS RELATIF ET SENS POSITIF OPTIMISME ?
- « Vouloir vivre, c'est aussi être sûr de vivre, et tant que la volonté de vivre nous anime, nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre existence, même à l'heure de la mort. » Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, 1818. Commentez cette citation.
- Peut-on vivre sans vouloir chercher la vérité ?
- Peut-on ne pas vouloir vivre en société ?
- Peut-on vouloir vivre dans l'illusion ?