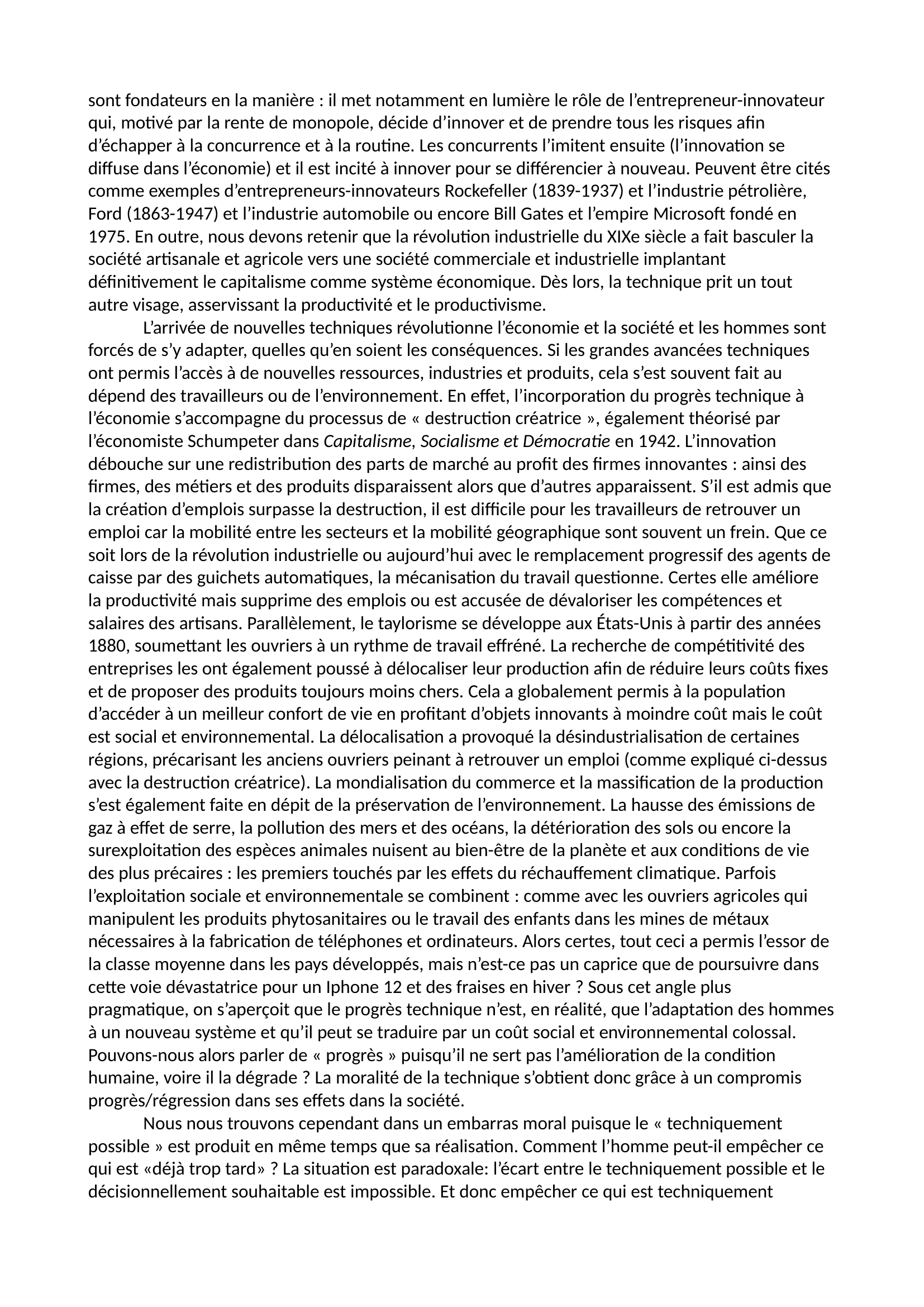Tout ce qui est techniquement possible est-il moralement admissible?
Publié le 10/01/2021

Extrait du document
«
sont fondateurs en la manière : il met notamment en lumière le rôle de l’entrepreneur-innovateur
qui, motivé par la rente de monopole, décide d’innover et de prendre tous les risques afin
d’échapper à la concurrence et à la routine.
Les concurrents l’imitent ensuite (l’innovation se
diffuse dans l’économie) et il est incité à innover pour se différencier à nouveau.
Peuvent être cités
comme exemples d’entrepreneurs-innovateurs Rockefeller (1839-1937) et l’industrie pétrolière,
Ford (1863-1947) et l’industrie automobile ou encore Bill Gates et l’empire Microsoft fondé en
1975.
En outre, nous devons retenir que la révolution industrielle du XIXe siècle a fait basculer la
société artisanale et agricole vers une société commerciale et industrielle implantant
définitivement le capitalisme comme système économique.
Dès lors, la technique prit un tout
autre visage, asservissant la productivité et le productivisme.
L’arrivée de nouvelles techniques révolutionne l’économie et la société et les hommes sont
forcés de s’y adapter, quelles qu’en soient les conséquences.
Si les grandes avancées techniques
ont permis l’accès à de nouvelles ressources, industries et produits, cela s’est souvent fait au
dépend des travailleurs ou de l’environnement.
En effet, l’incorporation du progrès technique à
l’économie s’accompagne du processus de « destruction créatrice », également théorisé par
l’économiste Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie en 1942.
L’innovation
débouche sur une redistribution des parts de marché au profit des firmes innovantes : ainsi des
firmes, des métiers et des produits disparaissent alors que d’autres apparaissent.
S’il est admis que
la création d’emplois surpasse la destruction, il est difficile pour les travailleurs de retrouver un
emploi car la mobilité entre les secteurs et la mobilité géographique sont souvent un frein.
Que ce
soit lors de la révolution industrielle ou aujourd’hui avec le remplacement progressif des agents de
caisse par des guichets automatiques, la mécanisation du travail questionne.
Certes elle améliore
la productivité mais supprime des emplois ou est accusée de dévaloriser les compétences et
salaires des artisans.
Parallèlement, le taylorisme se développe aux États-Unis à partir des années
1880, soumettant les ouvriers à un rythme de travail effréné.
La recherche de compétitivité des
entreprises les ont également poussé à délocaliser leur production afin de réduire leurs coûts fixes
et de proposer des produits toujours moins chers.
Cela a globalement permis à la population
d’accéder à un meilleur confort de vie en profitant d’objets innovants à moindre coût mais le coût
est social et environnemental.
La délocalisation a provoqué la désindustrialisation de certaines
régions, précarisant les anciens ouvriers peinant à retrouver un emploi (comme expliqué ci-dessus
avec la destruction créatrice).
La mondialisation du commerce et la massification de la production
s’est également faite en dépit de la préservation de l’environnement.
La hausse des émissions de
gaz à effet de serre, la pollution des mers et des océans, la détérioration des sols ou encore la
surexploitation des espèces animales nuisent au bien-être de la planète et aux conditions de vie
des plus précaires : les premiers touchés par les effets du réchauffement climatique.
Parfois
l’exploitation sociale et environnementale se combinent : comme avec les ouvriers agricoles qui
manipulent les produits phytosanitaires ou le travail des enfants dans les mines de métaux
nécessaires à la fabrication de téléphones et ordinateurs.
Alors certes, tout ceci a permis l’essor de
la classe moyenne dans les pays développés, mais n’est-ce pas un caprice que de poursuivre dans
cette voie dévastatrice pour un Iphone 12 et des fraises en hiver ? Sous cet angle plus
pragmatique, on s’aperçoit que le progrès technique n’est, en réalité, que l’adaptation des hommes
à un nouveau système et qu’il peut se traduire par un coût social et environnemental colossal.
Pouvons-nous alors parler de « progrès » puisqu’il ne sert pas l’amélioration de la condition
humaine, voire il la dégrade ? La moralité de la technique s’obtient donc grâce à un compromis
progrès/régression dans ses effets dans la société.
Nous nous trouvons cependant dans un embarras moral puisque le « techniquement
possible » est produit en même temps que sa réalisation.
Comment l’homme peut-il empêcher ce
qui est «déjà trop tard» ? La situation est paradoxale: l’écart entre le techniquement possible et le
décisionnellement souhaitable est impossible.
Et donc empêcher ce qui est techniquement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Manger de la viande est-il moralement acceptable
- « suffit-il d'être techniquement doué pour être un artiste ? »
- faut –il réaliser tout ce qui est techniquement possible ?
- La vérité est-elle toujours moralement exigible ? de KANT
- A-t-on toujours la force d’agir moralement ? Comment définir la morale ? Savons-nous toujours ce qui est moral ?