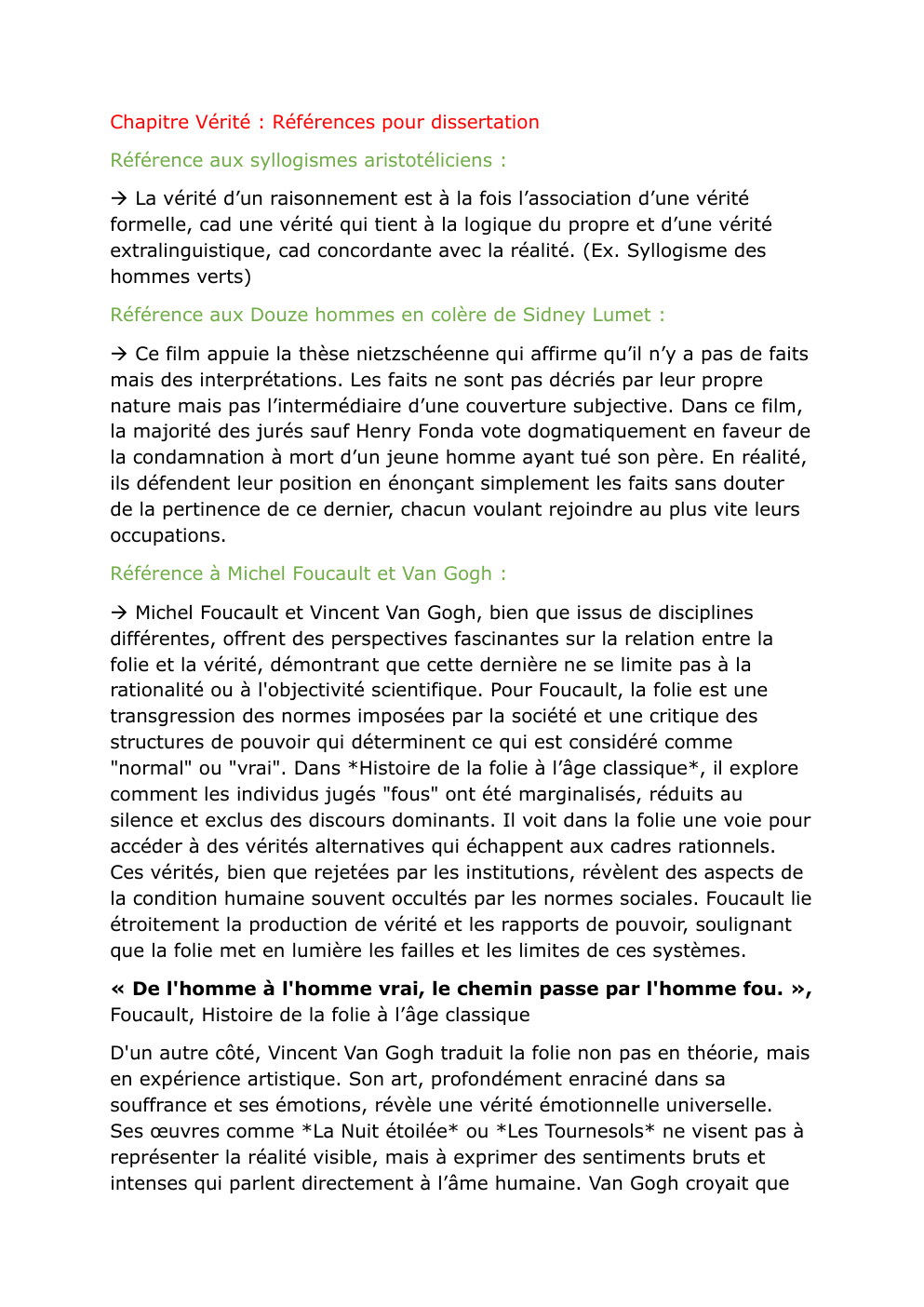Vérité en philo
Publié le 13/04/2025
Extrait du document
«
Chapitre Vérité : Références pour dissertation
Référence aux syllogismes aristotéliciens :
La vérité d’un raisonnement est à la fois l’association d’une vérité
formelle, cad une vérité qui tient à la logique du propre et d’une vérité
extralinguistique, cad concordante avec la réalité.
(Ex.
Syllogisme des
hommes verts)
Référence aux Douze hommes en colère de Sidney Lumet :
Ce film appuie la thèse nietzschéenne qui affirme qu’il n’y a pas de faits
mais des interprétations.
Les faits ne sont pas décriés par leur propre
nature mais pas l’intermédiaire d’une couverture subjective.
Dans ce film,
la majorité des jurés sauf Henry Fonda vote dogmatiquement en faveur de
la condamnation à mort d’un jeune homme ayant tué son père.
En réalité,
ils défendent leur position en énonçant simplement les faits sans douter
de la pertinence de ce dernier, chacun voulant rejoindre au plus vite leurs
occupations.
Référence à Michel Foucault et Van Gogh :
Michel Foucault et Vincent Van Gogh, bien que issus de disciplines
différentes, offrent des perspectives fascinantes sur la relation entre la
folie et la vérité, démontrant que cette dernière ne se limite pas à la
rationalité ou à l'objectivité scientifique.
Pour Foucault, la folie est une
transgression des normes imposées par la société et une critique des
structures de pouvoir qui déterminent ce qui est considéré comme
"normal" ou "vrai".
Dans *Histoire de la folie à l’âge classique*, il explore
comment les individus jugés "fous" ont été marginalisés, réduits au
silence et exclus des discours dominants.
Il voit dans la folie une voie pour
accéder à des vérités alternatives qui échappent aux cadres rationnels.
Ces vérités, bien que rejetées par les institutions, révèlent des aspects de
la condition humaine souvent occultés par les normes sociales.
Foucault lie
étroitement la production de vérité et les rapports de pouvoir, soulignant
que la folie met en lumière les failles et les limites de ces systèmes.
« De l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou.
»,
Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique
D'un autre côté, Vincent Van Gogh traduit la folie non pas en théorie, mais
en expérience artistique.
Son art, profondément enraciné dans sa
souffrance et ses émotions, révèle une vérité émotionnelle universelle.
Ses œuvres comme *La Nuit étoilée* ou *Les Tournesols* ne visent pas à
représenter la réalité visible, mais à exprimer des sentiments bruts et
intenses qui parlent directement à l’âme humaine.
Van Gogh croyait que
l'art devait transmettre une authenticité émotionnelle, une vérité profonde
sur la beauté, la douleur et la complexité de la vie.
Sa folie, loin d’être un
obstacle, a amplifié sa capacité à capturer une vérité existentielle qui
transcende les mots et les explications rationnelles.
Il dît : « Je ressens
profondément, et je veux que mes peintures parlent aux cœurs
des gens.
»
Bien que leurs approches diffèrent, les visions de Foucault et Van Gogh se
complètent.
Foucault adopte une perspective critique et analytique,
montrant comment la société marginalise les vérités issues de la folie.
Van
Gogh, lui, incarne la dimension personnelle et intuitive de cette quête,
utilisant l'art comme un moyen de communiquer des vérités émotionnelles
inaccessibles à la raison pure.
Référence à Foucault et sa vérité évolutive :
"Il n'y a pas d'exercice du pouvoir sans une certaine économie
des discours de vérité fonctionnant dans, à partir de et à travers
ce pouvoir"
Foucault, "Il faut défendre la société"....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- vérité - cours de philo
- PREVISIONS Semaine 1 Période 5 03/05 07/05 Semaine 2 10/05 14/05 Lecture La vérité sur les fessées Ateliers philo Pourquoi on se écoute parle ?
- EXPOSE PHILO : PLATON ET LA VÉRITÉ (Le Parménide) - Commentaire
- LA VÉRITÉ : QCM DE PHILO
- Une vérité scientifique peut-elle être dangereuse ? (Bac philo - TES)