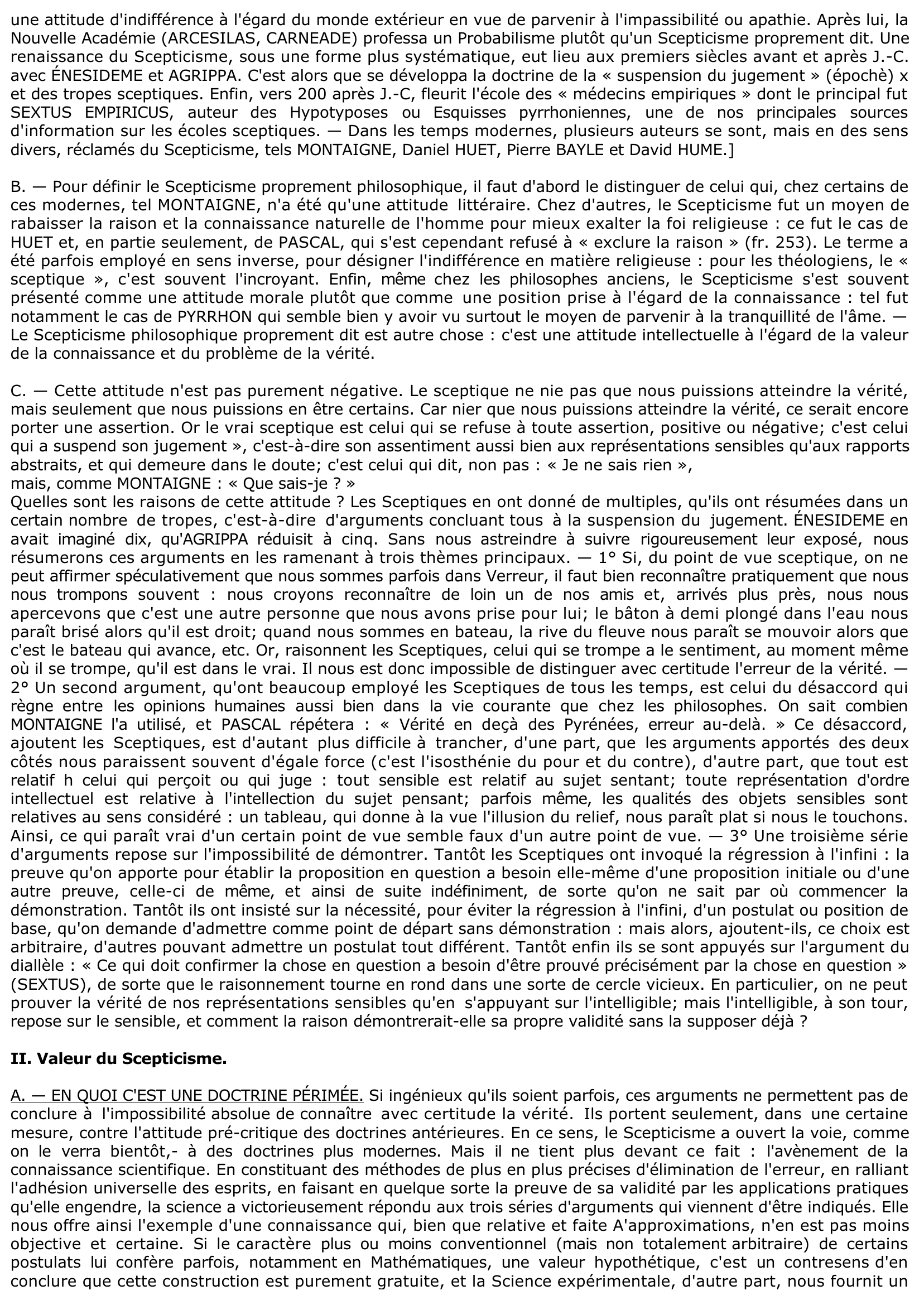VÉRITÉ ET SCEPTICISME ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
xxx ?
Si, par définition même, le scepticisme implique toujours à un degré ou à un autre, une négation portant sur la possibilité même de l'existence de la Vérité, il convient cependant de distinguer soigneusement entre ces divers degrés. En effet, le scepticisme qui se veut absolu ne peut que nier radicalement la possibilité pour l'esprit humain de parvenir à la connaissance de quelque vérité que ce soit et ce, dans tous les domaines. C'est en ce sens extrême que le scepticisme est synonyme de ce que l'on appelle aussi parfois l'agnosticisme Mais il existe également un scepticisme moins radical, et dont la nature porte plutôt sur la capacité de certitude à laquelle l'homme peut légitimement prétendre. Ce dernier aspect se rapproche au fond du « doute « qui, comme on le voit notamment chez Descartes, est même susceptible d'acquérir une certaine valeur philosophique, à cause des questions qu'il nous contraint à se poser et de la remise en cause des préjugés du sens commun qui constituent autant d'obstacles sur la voie susceptible de nous conduire à la vérité.
«
une attitude d'indifférence à l'égard du monde extérieur en vue de parvenir à l'impassibilité ou apathie.
Après lui, laNouvelle Académie (ARCESILAS, CARNEADE) professa un Probabilisme plutôt qu'un Scepticisme proprement dit.
Unerenaissance du Scepticisme, sous une forme plus systématique, eut lieu aux premiers siècles avant et après J.-C.avec ÉNESIDEME et AGRIPPA.
C'est alors que se développa la doctrine de la « suspension du jugement » (épochè) xet des tropes sceptiques.
Enfin, vers 200 après J.-C, fleurit l'école des « médecins empiriques » dont le principal futSEXTUS EMPIRICUS, auteur des Hypotyposes ou Esquisses pyrrhoniennes, une de nos principales sourcesd'information sur les écoles sceptiques.
— Dans les temps modernes, plusieurs auteurs se sont, mais en des sensdivers, réclamés du Scepticisme, tels MONTAIGNE, Daniel HUET, Pierre BAYLE et David HUME.]
B.
— Pour définir le Scepticisme proprement philosophique, il faut d'abord le distinguer de celui qui, chez certains deces modernes, tel MONTAIGNE, n'a été qu'une attitude littéraire.
Chez d'autres, le Scepticisme fut un moyen derabaisser la raison et la connaissance naturelle de l'homme pour mieux exalter la foi religieuse : ce fut le cas deHUET et, en partie seulement, de PASCAL, qui s'est cependant refusé à « exclure la raison » (fr.
253).
Le terme aété parfois employé en sens inverse, pour désigner l'indifférence en matière religieuse : pour les théologiens, le «sceptique », c'est souvent l'incroyant.
Enfin, même chez les philosophes anciens, le Scepticisme s'est souventprésenté comme une attitude morale plutôt que comme une position prise à l'égard de la connaissance : tel futnotamment le cas de PYRRHON qui semble bien y avoir vu surtout le moyen de parvenir à la tranquillité de l'âme.
—Le Scepticisme philosophique proprement dit est autre chose : c'est une attitude intellectuelle à l'égard de la valeurde la connaissance et du problème de la vérité.
C.
— Cette attitude n'est pas purement négative.
Le sceptique ne nie pas que nous puissions atteindre la vérité,mais seulement que nous puissions en être certains.
Car nier que nous puissions atteindre la vérité, ce serait encoreporter une assertion.
Or le vrai sceptique est celui qui se refuse à toute assertion, positive ou négative; c'est celuiqui a suspend son jugement », c'est-à-dire son assentiment aussi bien aux représentations sensibles qu'aux rapportsabstraits, et qui demeure dans le doute; c'est celui qui dit, non pas : « Je ne sais rien »,mais, comme MONTAIGNE : « Que sais-je ? »Quelles sont les raisons de cette attitude ? Les Sceptiques en ont donné de multiples, qu'ils ont résumées dans uncertain nombre de tropes, c'est-à-dire d'arguments concluant tous à la suspension du jugement.
ÉNESIDEME enavait imaginé dix, qu'AGRIPPA réduisit à cinq.
Sans nous astreindre à suivre rigoureusement leur exposé, nousrésumerons ces arguments en les ramenant à trois thèmes principaux.
— 1° Si, du point de vue sceptique, on nepeut affirmer spéculativement que nous sommes parfois dans Verreur, il faut bien reconnaître pratiquement que nousnous trompons souvent : nous croyons reconnaître de loin un de nos amis et, arrivés plus près, nous nousapercevons que c'est une autre personne que nous avons prise pour lui; le bâton à demi plongé dans l'eau nousparaît brisé alors qu'il est droit; quand nous sommes en bateau, la rive du fleuve nous paraît se mouvoir alors quec'est le bateau qui avance, etc.
Or, raisonnent les Sceptiques, celui qui se trompe a le sentiment, au moment mêmeoù il se trompe, qu'il est dans le vrai.
Il nous est donc impossible de distinguer avec certitude l'erreur de la vérité.
—2° Un second argument, qu'ont beaucoup employé les Sceptiques de tous les temps, est celui du désaccord quirègne entre les opinions humaines aussi bien dans la vie courante que chez les philosophes.
On sait combienMONTAIGNE l'a utilisé, et PASCAL répétera : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
» Ce désaccord,ajoutent les Sceptiques, est d'autant plus difficile à trancher, d'une part, que les arguments apportés des deuxcôtés nous paraissent souvent d'égale force (c'est l'isosthénie du pour et du contre), d'autre part, que tout estrelatif h celui qui perçoit ou qui juge : tout sensible est relatif au sujet sentant; toute représentation d'ordreintellectuel est relative à l'intellection du sujet pensant; parfois même, les qualités des objets sensibles sontrelatives au sens considéré : un tableau, qui donne à la vue l'illusion du relief, nous paraît plat si nous le touchons.Ainsi, ce qui paraît vrai d'un certain point de vue semble faux d'un autre point de vue.
— 3° Une troisième séried'arguments repose sur l'impossibilité de démontrer.
Tantôt les Sceptiques ont invoqué la régression à l'infini : lapreuve qu'on apporte pour établir la proposition en question a besoin elle-même d'une proposition initiale ou d'uneautre preuve, celle-ci de même, et ainsi de suite indéfiniment, de sorte qu'on ne sait par où commencer ladémonstration.
Tantôt ils ont insisté sur la nécessité, pour éviter la régression à l'infini, d'un postulat ou position debase, qu'on demande d'admettre comme point de départ sans démonstration : mais alors, ajoutent-ils, ce choix estarbitraire, d'autres pouvant admettre un postulat tout différent.
Tantôt enfin ils se sont appuyés sur l'argument dudiallèle : « Ce qui doit confirmer la chose en question a besoin d'être prouvé précisément par la chose en question »(SEXTUS), de sorte que le raisonnement tourne en rond dans une sorte de cercle vicieux.
En particulier, on ne peutprouver la vérité de nos représentations sensibles qu'en s'appuyant sur l'intelligible; mais l'intelligible, à son tour,repose sur le sensible, et comment la raison démontrerait-elle sa propre validité sans la supposer déjà ?
II.
Valeur du Scepticisme.
A.
— EN QUOI C'EST UNE DOCTRINE PÉRIMÉE. Si ingénieux qu'ils soient parfois, ces arguments ne permettent pas de conclure à l'impossibilité absolue de connaître avec certitude la vérité.
Ils portent seulement, dans une certainemesure, contre l'attitude pré-critique des doctrines antérieures.
En ce sens, le Scepticisme a ouvert la voie, commeon le verra bientôt,- à des doctrines plus modernes.
Mais il ne tient plus devant ce fait : l'avènement de laconnaissance scientifique.
En constituant des méthodes de plus en plus précises d'élimination de l'erreur, en ralliantl'adhésion universelle des esprits, en faisant en quelque sorte la preuve de sa validité par les applications pratiquesqu'elle engendre, la science a victorieusement répondu aux trois séries d'arguments qui viennent d'être indiqués.
Ellenous offre ainsi l'exemple d'une connaissance qui, bien que relative et faite A'approximations, n'en est pas moinsobjective et certaine.
Si le caractère plus ou moins conventionnel (mais non totalement arbitraire) de certainspostulats lui confère parfois, notamment en Mathématiques, une valeur hypothétique, c'est un contresens d'enconclure que cette construction est purement gratuite, et la Science expérimentale, d'autre part, nous fournit un.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Constater que la vérité change avec le temps doit-il incliner au scepticisme?
- Constater que la vérité change avec le temps conduit-il nécessairement au scepticisme?
- Montaigne, philosophe: ironie, scepticisme, vérité, éducation, morale
- Constater que la vérité change avec le temps conduit-il nécessairement au scepticisme ?
- Constater que la vérité change avec le temps conduit il nécessairement au scepticisme ?