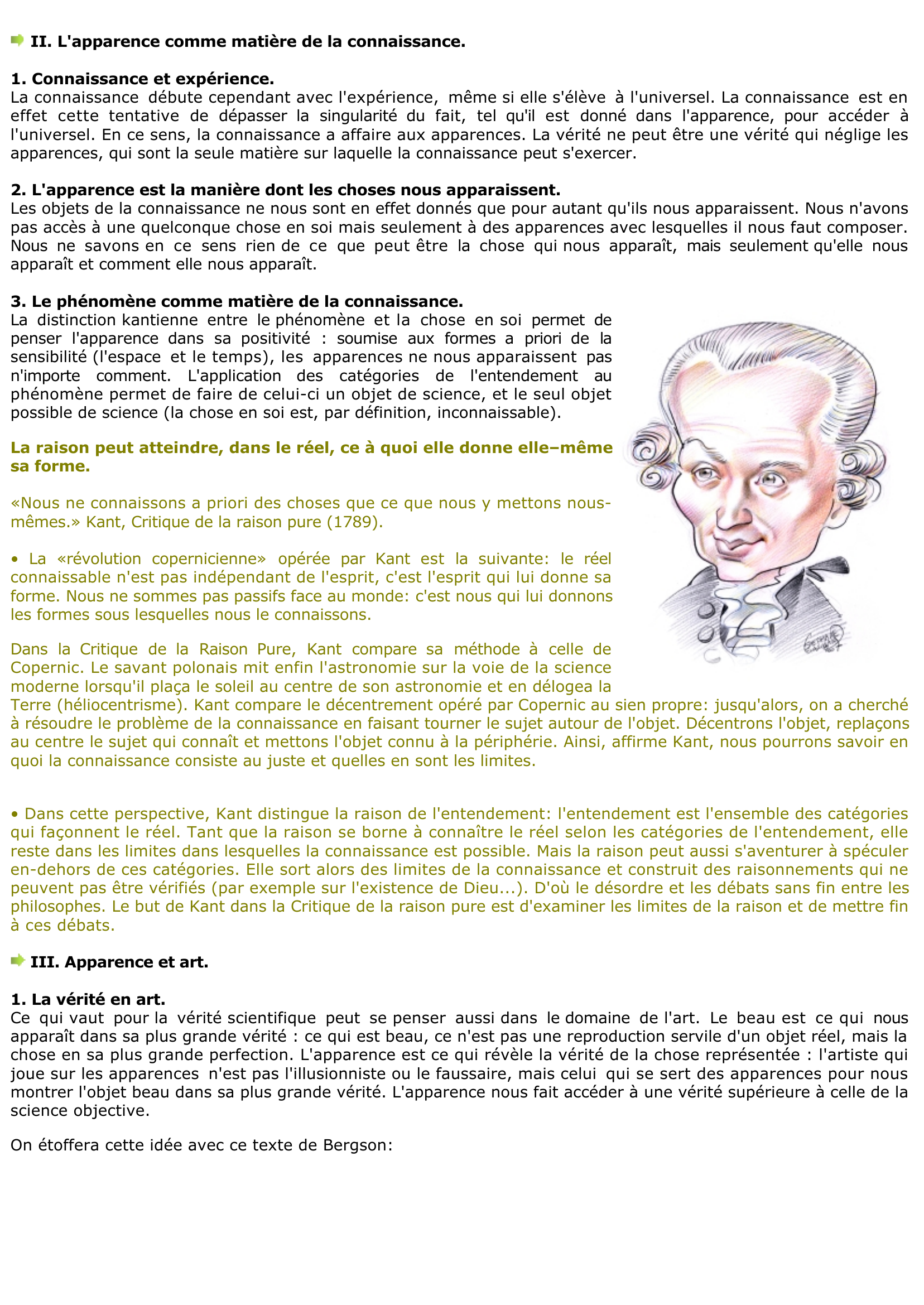Y a-t-il une vérité des apparences ?
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
II.
L'apparence comme matière de la connaissance.
1.
Connaissance et expérience.La connaissance débute cependant avec l'expérience, même si elle s'élève à l'universel.
La connaissance est eneffet cette tentative de dépasser la singularité du fait, tel qu'il est donné dans l'apparence, pour accéder àl'universel.
En ce sens, la connaissance a affaire aux apparences.
La vérité ne peut être une vérité qui néglige lesapparences, qui sont la seule matière sur laquelle la connaissance peut s'exercer.
2.
L'apparence est la manière dont les choses nous apparaissent.Les objets de la connaissance ne nous sont en effet donnés que pour autant qu'ils nous apparaissent.
Nous n'avonspas accès à une quelconque chose en soi mais seulement à des apparences avec lesquelles il nous faut composer.Nous ne savons en ce sens rien de ce que peut être la chose qui nous apparaît, mais seulement qu'elle nousapparaît et comment elle nous apparaît.
3.
Le phénomène comme matière de la connaissance.La distinction kantienne entre le phénomène et la chose en soi permet depenser l'apparence dans sa positivité : soumise aux formes a priori de lasensibilité (l'espace et le temps), les apparences ne nous apparaissent pasn'importe comment.
L'application des catégories de l'entendement auphénomène permet de faire de celui-ci un objet de science, et le seul objetpossible de science (la chose en soi est, par définition, inconnaissable).
La raison peut atteindre, dans le réel, ce à quoi elle donne elle–mêmesa forme.
«Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes.» Kant, Critique de la raison pure (1789).
• La «révolution copernicienne» opérée par Kant est la suivante: le réelconnaissable n'est pas indépendant de l'esprit, c'est l'esprit qui lui donne saforme.
Nous ne sommes pas passifs face au monde: c'est nous qui lui donnonsles formes sous lesquelles nous le connaissons.
Dans la Critique de la Raison Pure, Kant compare sa méthode à celle deCopernic.
Le savant polonais mit enfin l'astronomie sur la voie de la sciencemoderne lorsqu'il plaça le soleil au centre de son astronomie et en délogea laTerre (héliocentrisme).
Kant compare le décentrement opéré par Copernic au sien propre: jusqu'alors, on a cherchéà résoudre le problème de la connaissance en faisant tourner le sujet autour de l'objet.
Décentrons l'objet, replaçonsau centre le sujet qui connaît et mettons l'objet connu à la périphérie.
Ainsi, affirme Kant, nous pourrons savoir enquoi la connaissance consiste au juste et quelles en sont les limites.
• Dans cette perspective, Kant distingue la raison de l'entendement: l'entendement est l'ensemble des catégoriesqui façonnent le réel.
Tant que la raison se borne à connaître le réel selon les catégories de l'entendement, ellereste dans les limites dans lesquelles la connaissance est possible.
Mais la raison peut aussi s'aventurer à spéculeren-dehors de ces catégories.
Elle sort alors des limites de la connaissance et construit des raisonnements qui nepeuvent pas être vérifiés (par exemple sur l'existence de Dieu...).
D'où le désordre et les débats sans fin entre lesphilosophes.
Le but de Kant dans la Critique de la raison pure est d'examiner les limites de la raison et de mettre finà ces débats.
III.
Apparence et art.
1.
La vérité en art.Ce qui vaut pour la vérité scientifique peut se penser aussi dans le domaine de l'art.
Le beau est ce qui nousapparaît dans sa plus grande vérité : ce qui est beau, ce n'est pas une reproduction servile d'un objet réel, mais lachose en sa plus grande perfection.
L'apparence est ce qui révèle la vérité de la chose représentée : l'artiste quijoue sur les apparences n'est pas l'illusionniste ou le faussaire, mais celui qui se sert des apparences pour nousmontrer l'objet beau dans sa plus grande vérité.
L'apparence nous fait accéder à une vérité supérieure à celle de lascience objective.
On étoffera cette idée avec ce texte de Bergson:.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ChappéLa vérité des apparences ECS1 Antoine Qu'est-ce que sont les apparences ?
- Les apparences peuvent-elles dire la vérité ?
- Y'a-t-il une vérité des apparences?
- Schopenhauer, extrait de l'Art d'avoir toujours raison. « La vanité innée, particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas accepter que notre affirmation se révèle fausse, ni que celle de l'adversaire soit juste. Par conséquent, chacun devrait simplement s'efforcer de n'exprimer que des jugements justes, ce qui devrait inciter à penser d'abord et à parler ensuite. Mais chez la plupart des hommes, la vanité innée s'accompagne d'un besoin de bavard
- Chercher la vérité, est-ce renoncer aux apparences ?