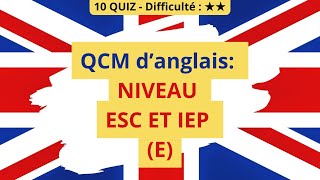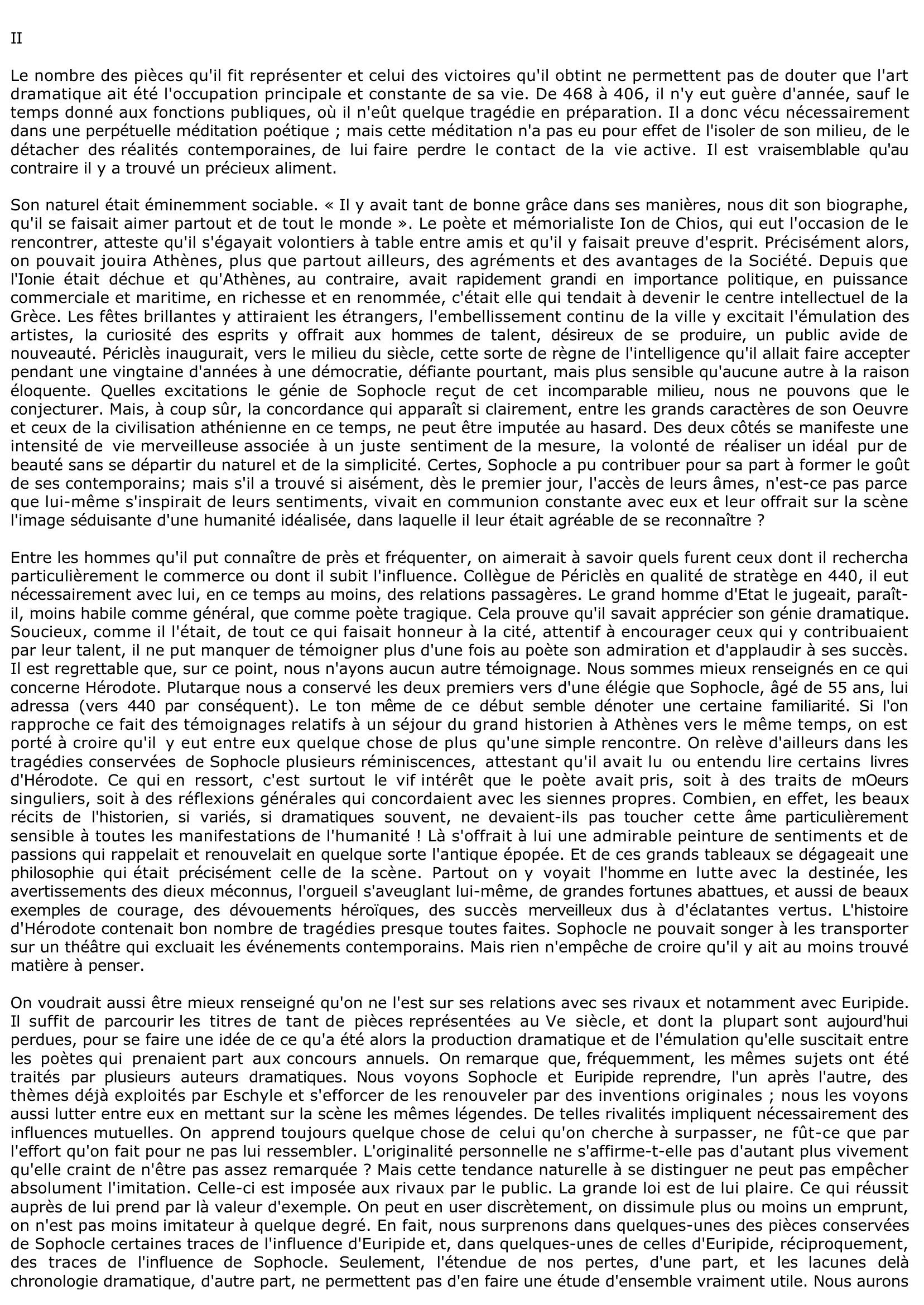SOPHOCLE: L'homme, son temps et son œuvre.
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
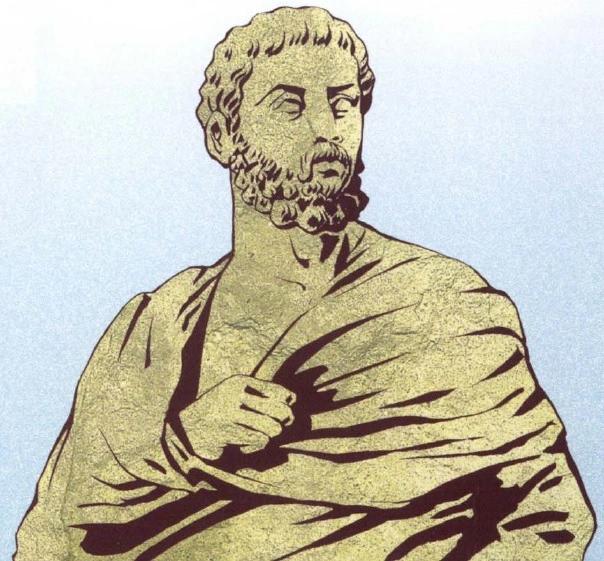
I S'il y a des hommes qui, par une sorte de privilège, sont particulièrement représentatifs de leur pays, de leur siècle et de leur milieu, Sophocle est un de ceux-là. Il fut le plus purement Athénien des Athéniens de son temps. Il naquit à Colone, bourg voisin d'Athènes, en 496/494 ; cinq ans environ avant la victoire de Marathon Comme beaucoup de localités de l'Attique, Colone était un lieu consacré par la religion et par d'antiques légendes. On y honorait spécialement le dieu Poséidon, Prométhée porteur du feu et le héros cavalier Colonos, éponyme du dème. On racontait aussi qu'Œdipe proscrit et errant y avait trouvé asile et qu'après sa disparition mystérieuse, il y habitait sous la terre. L'enfance de Sophocle dut être charmée de ces récits. A cette poésie des souvenirs s'ajoutait celle du paysage. Ce qu'était alors ce coin de l'Attique, assez aride aujourd'hui, il nous l'a dit lui-même, dans les vers délicieux et pleins de fraîcheur qu'il a prêtés aux rustiques habitants du voisinage dans son Œdipe à Colone : Etranger, ces lieux où tu arrives sont les plus beaux de cette contrée, fière de ses coursiers de noble race. C'est la blanche Colone, où se fait entendre, léger et sonore, le chant des nombreux rossignols cachés dans son vallon verdoyant sous le feuillage sombre du lierre, sous les arbres sacrés chargés de fruits, à l'abri des rayons du soleil et des coups de l'orage. C'est là que Dionysos aime à bondir, joyeux, escorté des nymphes qui ont veillé sur son enfance.
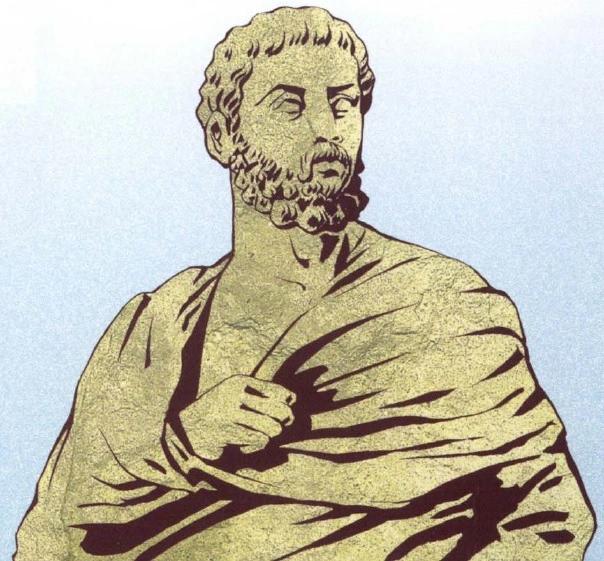
«
II
Le nombre des pièces qu'il fit représenter et celui des victoires qu'il obtint ne permettent pas de douter que l'artdramatique ait été l'occupation principale et constante de sa vie.
De 468 à 406, il n'y eut guère d'année, sauf letemps donné aux fonctions publiques, où il n'eût quelque tragédie en préparation.
Il a donc vécu nécessairementdans une perpétuelle méditation poétique ; mais cette méditation n'a pas eu pour effet de l'isoler de son milieu, de ledétacher des réalités contemporaines, de lui faire perdre le contact de la vie active.
Il est vraisemblable qu'aucontraire il y a trouvé un précieux aliment.
Son naturel était éminemment sociable.
« Il y avait tant de bonne grâce dans ses manières, nous dit son biographe,qu'il se faisait aimer partout et de tout le monde ».
Le poète et mémorialiste Ion de Chios, qui eut l'occasion de lerencontrer, atteste qu'il s'égayait volontiers à table entre amis et qu'il y faisait preuve d'esprit.
Précisément alors,on pouvait jouira Athènes, plus que partout ailleurs, des agréments et des avantages de la Société.
Depuis quel'Ionie était déchue et qu'Athènes, au contraire, avait rapidement grandi en importance politique, en puissancecommerciale et maritime, en richesse et en renommée, c'était elle qui tendait à devenir le centre intellectuel de laGrèce.
Les fêtes brillantes y attiraient les étrangers, l'embellissement continu de la ville y excitait l'émulation desartistes, la curiosité des esprits y offrait aux hommes de talent, désireux de se produire, un public avide denouveauté.
Périclès inaugurait, vers le milieu du siècle, cette sorte de règne de l'intelligence qu'il allait faire accepterpendant une vingtaine d'années à une démocratie, défiante pourtant, mais plus sensible qu'aucune autre à la raisonéloquente.
Quelles excitations le génie de Sophocle reçut de cet incomparable milieu, nous ne pouvons que leconjecturer.
Mais, à coup sûr, la concordance qui apparaît si clairement, entre les grands caractères de son Oeuvreet ceux de la civilisation athénienne en ce temps, ne peut être imputée au hasard.
Des deux côtés se manifeste uneintensité de vie merveilleuse associée à un juste sentiment de la mesure, la volonté de réaliser un idéal pur debeauté sans se départir du naturel et de la simplicité.
Certes, Sophocle a pu contribuer pour sa part à former le goûtde ses contemporains; mais s'il a trouvé si aisément, dès le premier jour, l'accès de leurs âmes, n'est-ce pas parceque lui-même s'inspirait de leurs sentiments, vivait en communion constante avec eux et leur offrait sur la scènel'image séduisante d'une humanité idéalisée, dans laquelle il leur était agréable de se reconnaître ?
Entre les hommes qu'il put connaître de près et fréquenter, on aimerait à savoir quels furent ceux dont il recherchaparticulièrement le commerce ou dont il subit l'influence.
Collègue de Périclès en qualité de stratège en 440, il eutnécessairement avec lui, en ce temps au moins, des relations passagères.
Le grand homme d'Etat le jugeait, paraît-il, moins habile comme général, que comme poète tragique.
Cela prouve qu'il savait apprécier son génie dramatique.Soucieux, comme il l'était, de tout ce qui faisait honneur à la cité, attentif à encourager ceux qui y contribuaientpar leur talent, il ne put manquer de témoigner plus d'une fois au poète son admiration et d'applaudir à ses succès.Il est regrettable que, sur ce point, nous n'ayons aucun autre témoignage.
Nous sommes mieux renseignés en ce quiconcerne Hérodote.
Plutarque nous a conservé les deux premiers vers d'une élégie que Sophocle, âgé de 55 ans, luiadressa (vers 440 par conséquent).
Le ton même de ce début semble dénoter une certaine familiarité.
Si l'onrapproche ce fait des témoignages relatifs à un séjour du grand historien à Athènes vers le même temps, on estporté à croire qu'il y eut entre eux quelque chose de plus qu'une simple rencontre.
On relève d'ailleurs dans lestragédies conservées de Sophocle plusieurs réminiscences, attestant qu'il avait lu ou entendu lire certains livresd'Hérodote.
Ce qui en ressort, c'est surtout le vif intérêt que le poète avait pris, soit à des traits de mOeurssinguliers, soit à des réflexions générales qui concordaient avec les siennes propres.
Combien, en effet, les beauxrécits de l'historien, si variés, si dramatiques souvent, ne devaient-ils pas toucher cette âme particulièrementsensible à toutes les manifestations de l'humanité ! Là s'offrait à lui une admirable peinture de sentiments et depassions qui rappelait et renouvelait en quelque sorte l'antique épopée.
Et de ces grands tableaux se dégageait unephilosophie qui était précisément celle de la scène.
Partout on y voyait l'homme en lutte avec la destinée, lesavertissements des dieux méconnus, l'orgueil s'aveuglant lui-même, de grandes fortunes abattues, et aussi de beauxexemples de courage, des dévouements héroïques, des succès merveilleux dus à d'éclatantes vertus.
L'histoired'Hérodote contenait bon nombre de tragédies presque toutes faites.
Sophocle ne pouvait songer à les transportersur un théâtre qui excluait les événements contemporains.
Mais rien n'empêche de croire qu'il y ait au moins trouvématière à penser.
On voudrait aussi être mieux renseigné qu'on ne l'est sur ses relations avec ses rivaux et notamment avec Euripide.Il suffit de parcourir les titres de tant de pièces représentées au Ve siècle, et dont la plupart sont aujourd'huiperdues, pour se faire une idée de ce qu'a été alors la production dramatique et de l'émulation qu'elle suscitait entreles poètes qui prenaient part aux concours annuels.
On remarque que, fréquemment, les mêmes sujets ont ététraités par plusieurs auteurs dramatiques.
Nous voyons Sophocle et Euripide reprendre, l'un après l'autre, desthèmes déjà exploités par Eschyle et s'efforcer de les renouveler par des inventions originales ; nous les voyonsaussi lutter entre eux en mettant sur la scène les mêmes légendes.
De telles rivalités impliquent nécessairement desinfluences mutuelles.
On apprend toujours quelque chose de celui qu'on cherche à surpasser, ne fût-ce que parl'effort qu'on fait pour ne pas lui ressembler.
L'originalité personnelle ne s'affirme-t-elle pas d'autant plus vivementqu'elle craint de n'être pas assez remarquée ? Mais cette tendance naturelle à se distinguer ne peut pas empêcherabsolument l'imitation.
Celle-ci est imposée aux rivaux par le public.
La grande loi est de lui plaire.
Ce qui réussitauprès de lui prend par là valeur d'exemple.
On peut en user discrètement, on dissimule plus ou moins un emprunt,on n'est pas moins imitateur à quelque degré.
En fait, nous surprenons dans quelques-unes des pièces conservéesde Sophocle certaines traces de l'influence d'Euripide et, dans quelques-unes de celles d'Euripide, réciproquement,des traces de l'influence de Sophocle.
Seulement, l'étendue de nos pertes, d'une part, et les lacunes delàchronologie dramatique, d'autre part, ne permettent pas d'en faire une étude d'ensemble vraiment utile.
Nous aurons.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le role de Lorenzo joué par une femme, est ce trahir la pièce? De Sarah Benhardt en 1896 à Marguerite Jamois en 1945 , le rôle de Lorenzaccio a toujours été joué par des femmes. C’est seulement en 1952 dans la pièce montée par Jean Vilar que le rôle du personnage principal sera joué par un homme : Gérard Philipe. Il a fallu plus d’un siècle après l’écriture de la pièce pour qu’un hom
- Les extraits des quatre œuvres littéraires que sont le Chef-d'œuvre inconnu de Balzac, L'Homme qui rit de Victor Hugo, L'Assommoir d'Émile Zola et Le Temps retrouvé de Marcel Proust ont, en commun, de dresser le portrait d’un personnage et tout en prenant racine dans le réel, de transposer celui-ci.
- Vous supposerez que peu de temps avant la Révolution un jeune homme, sensible à la gloire de Jean-Jacques Rousseau, et grand admirateur de ses principaux ouvrages, a été faire un pèlerinage à la tombe du philosophe située dans Vile des peupliers, au milieu du lac qui ornait le domaine d'Ermenonville. Rentré à Paris, il écrit à un ami pour lui rendre compte de son voyage. Sur la tombe de Rousseau, il croit avoir mieux compris et l'œuvre de son auteur préféré, et l'œuvre même du siècle q
- Dans ses Propos sur l'éducation, Alain affirme : « Il n'y a point d'expérience qui élève mieux un homme que la découverte d'un plaisir supérieur, qu'il aurait toujours ignoré s'il n'avait point pris d'abord un peu de peine. » Avez-vous fait, au cours de vos études littéraires, l'expérience du plaisir « supérieur » apporté par un écrivain, ou une œuvre en particulier, que vous avez découverts après un temps d'exploration difficile ?
- Paul Valéry écrit dans le Préambule pour le Catalogue