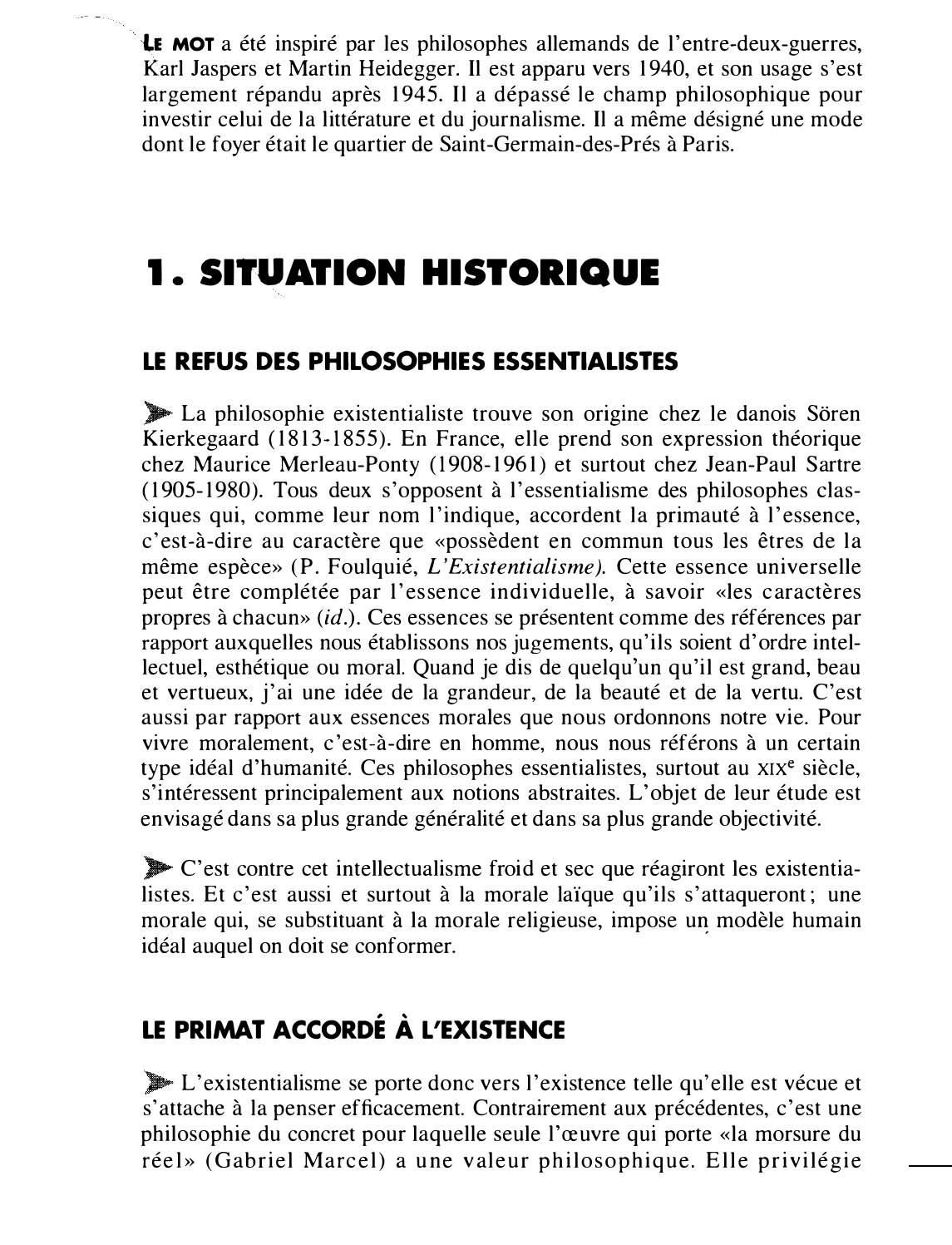EXISTENTIALISME - Histoire de la littérature
Publié le 30/01/2018
Extrait du document

Jean-Paul Sartre
Albert Camus (1905 1980)
(1913-1960)
La Nausée ( 1 938) J.-P. Sartre (roman)
Le Mur (1939) (recueil de cinq nouvelles : Le Mur, La Chambre, Erostrate,
Intimité, L'Enfance d'un chef)
.L'Étranger (1942)
Le Mythe de Sisyphe (1942)
Caligula ( 1944)
Huis-Clos ( 1945)
L'existentialisme est un humanisme (1946)
La Peste (1947)
J. P. Sartre A. Camus (roman) A. Camus (essai philosophique) A. Camus (pièce de théâtre) J. P. Sartre (pièce de théâtre) J.-P. Sartre (essai philosophique) A. Camus (roman)
1939-1945 Seconde Guerre mondiale.
1954-1962 Guerre d'Algérie.
«Pas besoin de gril, l'enfer c'est les autres.»
(Sartre, Huis-Clos.)
«Serions-nous muets et cois comme des cailloux, notre passivité même serait une
action.»
(Sartre, Situations !.)
«La grandeur de l'homme est d'être plus fort que sa condition.»
(Camus, Chroniques.)
«]e me révolte, donc je suis.»
(Camus, L'Été.)

«
LE MOT a été inspiré par les philosophes allemands de l'entre-deux-guerres,
Karl Jas pers et Martin Heidegger.
Il est apparu vers 1940, et son usage s'est
largement répandu après 1945.
Il a dépassé le champ philosophique pour
investir celui de la littérature et du journalisme.
Il a même désigné une mode
dont le foyer était le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris.
1 • SIT UATION HISTORI QUE
LE REFUS DES PHILOSOP HIES ESSENTIALISTES
La philosophie existentialiste trouve son origine chez le danois St:iren
Kier kegaard (1813-1855).
En France, elle prend son expression théorique
chez Maurice Merleau-Ponty (1908- 1961) et surtout chez Jean-Paul Sartre
(19 05- 1980).
Tous deux s'opposent à l'e ssentialisme des philosophes clas
siques qui, comme leur nom l'indique, accordent la primauté à l'e ssence,
c' est-à-dire au caractère que «possèdent en commun tous les êtres de la
même espèce» (P.
Foulquié, L'Existentialisme).
Cette essence universelle
peut être complétée par 1 'e ss ence individuelle, à savoir «les caractères
propres à chacun» (id.).
Ces essences se présentent comme des référ ences par
rapport auxquelles nous établissons nos jugements, qu'ils soient d'ordre intel
lectuel, esthétique ou moral.
Quand je dis de quelqu'un qu'il est grand, beau
et vertueux, j'ai une idée de la grandeur, de la beauté et de la vertu.
C'est
aussi par rapport aux essences morales que nous ordonnons notre vie.
Pour
vivre moralement, c'es t-à-d ire en homme, nous nous référons à un certain
type idéal d'humanité.
Ces philosophes essentialistes, surtout au xrx e siècle,
s'in téressent principalement aux notions abstraites.
L'objet de leur étude est
envisagé dans sa plus grande généralité et dans sa plus grande objectivité.
C'est contre cet intellectualisme froid et sec que réagiront les existentia
listes.
Et c'est aussi et surtout à la morale laïque qu'ils s'attaqueront ; une
morale qui, se substit uant à la morale religieuse, impose u� modèle humain
idéal auquel on doit se conformer.
LE PRI MAT ACCORDÉ À L'EXI STENCE
L' exis tentialisme se porte donc vers l'exis tence telle qu'elle est vécue et
s' attache à la penser efficacement.
Contrairement aux précédentes, c'est une
philosophie du concret pour laquelle seule l'œuvre qui porte «la morsure du
ré el» (Gabriel Marcel) a un e va leur philosophique.
Elle privilégie.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours
- ARTHUR et la légende arthurienne (Histoire de la littérature)
- OVIDE MORALISÉ (Histoire de la littérature)