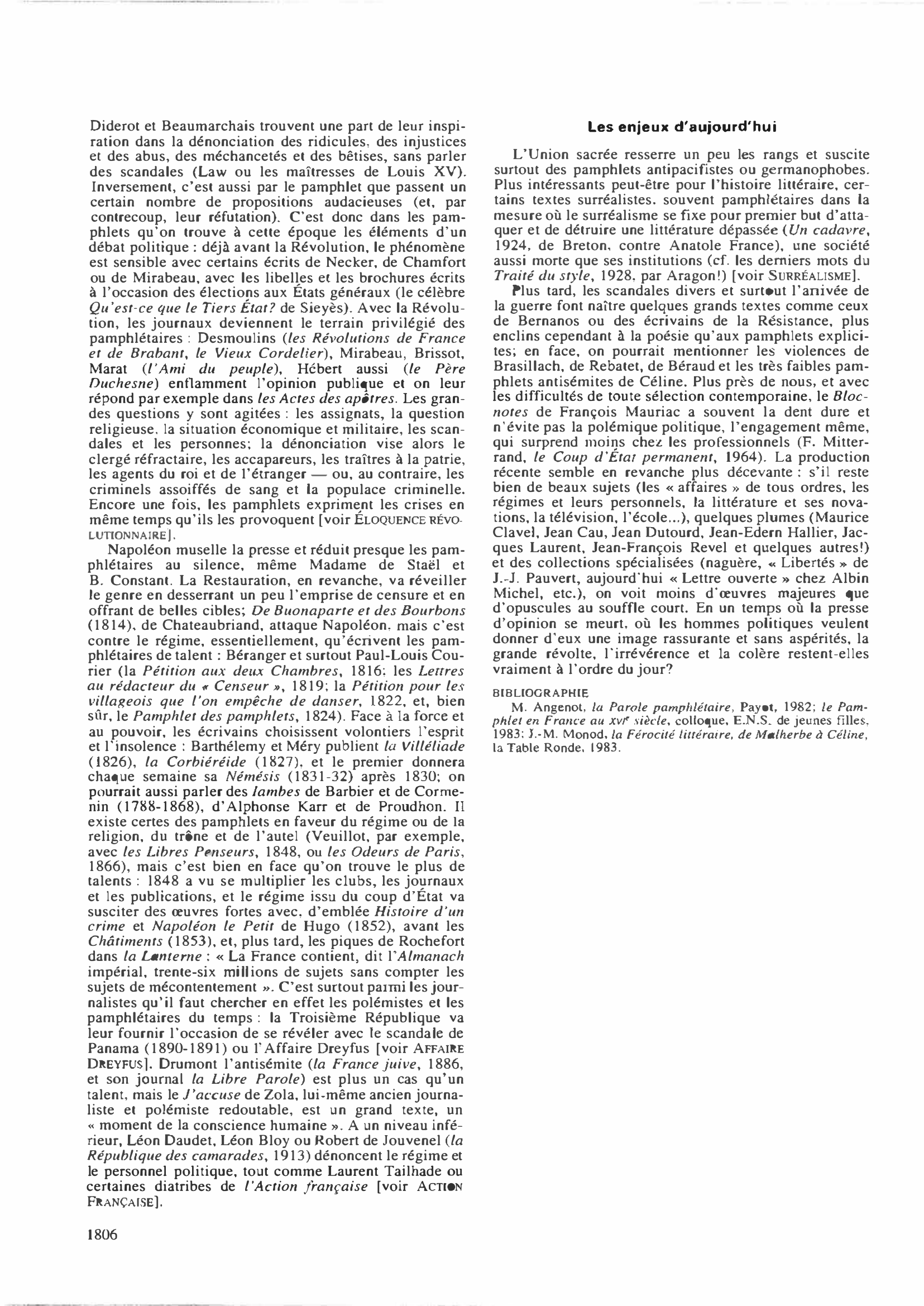LE PAMPHLET (Histoire de la littérature)
Publié le 28/11/2018

Extrait du document


«
Diderot
et Beaumarchais trouvent une part de leur inspi
ration dans la dénonciation des ridicules, des injustices
et des abus, des méchancetés et des bêtises, sans parler
des scandales (Law ou les maîtresses de Louis XV).
Inversement, c'est aussi par le pamphlet que passent un
certain nombre de propositions audacieuses (et, par
contrecoup, leur réfutation).
C'est donc dans les pam
phlets qu'on trouve à cette époque les éléments d'un
débat politique : déjà avant la Révolution, le phénomène
est sensible avec certains écrits de Necker, de Chamfort
ou de Mirabeau, avec les libelles et les brochures écrits
à l'occasion des élections aux États généraux (le célèbre
Qu'est-ce que le Tiers État? de Sieyès).
Avec la Révolu
tion, les journaux deviennent le terrain privilégié des
pamphlétaires : Desmoulins (les Révolutions de France
et de Brabant, le Vieux Cordelier), Mirabeau, Brissot,
Marat (l'Ami du peuple), Hébert aussi (le Père
Duchesne) enflamment l'opinion publique et on leur
répond par exemple dans les Actes des apôtres.
Les gran
des questions y sont agitées : les assignats, la question
religieuse, la situation économique et militaire, les scan
dales et les personnes; la dénonciation vise alors le
clergé réfractaire, les accapareurs, les traîtres à la patrie,
les agents du roi et de 1 'étranger -ou, au contraire, les
criminels assoiffés de sang et la populace criminelle.
Encore une fois, les pamphlets expriment les crises en
même temps qu'ils les provoquent [voir ÉLOQUENCE RÉVO·
LUTIONNAIREl.
Napoléon muselle la presse et réduit presque les pam
phlétaires au silence, même Madame de Staël et
B.
Constant.
La Restauration, en revanche, va réveiller
le genre en desserrant un peu l'emprise de censure et en
offrant de belles cibles; De Buonaparte et des Bourbons
( 1814), de Chateaubriand, attaque Napoléon, mais c'est
contre le régime, essentiellement, qu'écrivent les pam
phlétaires de talent : Béranger et surtout Paul-Louis Cou
rier (la Pétition aux deux Chambres, 1816; les Lettres
au rédacteur du« Censeur», 1819; la Pétition pour les
villageois que l'on empêche de danser, 1822, et, bien
sûr, le Pamphlet des pamphlets, 1824).
Face à la force et
au pouvoir, les écrivains choisissent volontiers l'esprit
et l'insolence : Barthélemy et Méry publient la Villéliade
(1826), la Corbiéréide ( 1827), et le premier donnera
chaque semaine sa Némésis (1831-32) après 1830; on
pourrait aussi parler des Iambes de Barbier et de Corme
nin (1788-1868), d'Alphonse Karr et de Proudhon.
Il
existe certes des pamphlets en faveur du régime ou de la
religion, du trône et de l'autel (Veuillot, par exemple,
avec les Libres Penseurs, 1848, ou les Odeurs de Paris,
1866), mais c'est bien en face qu'on trouve le plus de
talents : l848 a vu se multiplier les clubs, les journaux
et les publications, et le régime issu du coup d'État va
susciter des œuvres fortes avec, d'emblée Histoire d'un
crime et Napoléon le Petit de Hugo (1852), avant les
Châtiments ( 1853), et, plus tard, les piques de Rochefort
dans la Lam erne : « La France contient, dit l'Almanach
impérial, Lrente-six mill ions de sujets sans compter les
sujets de mécontentement ».
C'est surtout parmi les jour
nalistes qu'il faut chercher en effet les polémistes et les
pamphlétaires du temps : la Troisième République va
leur fournir l'occasion de se révéler avec le scandale de
Panama (1890-1891) ou 1' Affaire Dreyfus [voir AFFAIRE
DREYFUSl.
Drumont l'antisémite (la France juive, 1886,
et son journal la Libre Parole) est plus un cas qu'un
talent, mais le J'accuse de Zola, lui-même ancien journa
liste et polémiste redoutable, est un grand texte, un.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours
- ARTHUR et la légende arthurienne (Histoire de la littérature)
- OVIDE MORALISÉ (Histoire de la littérature)