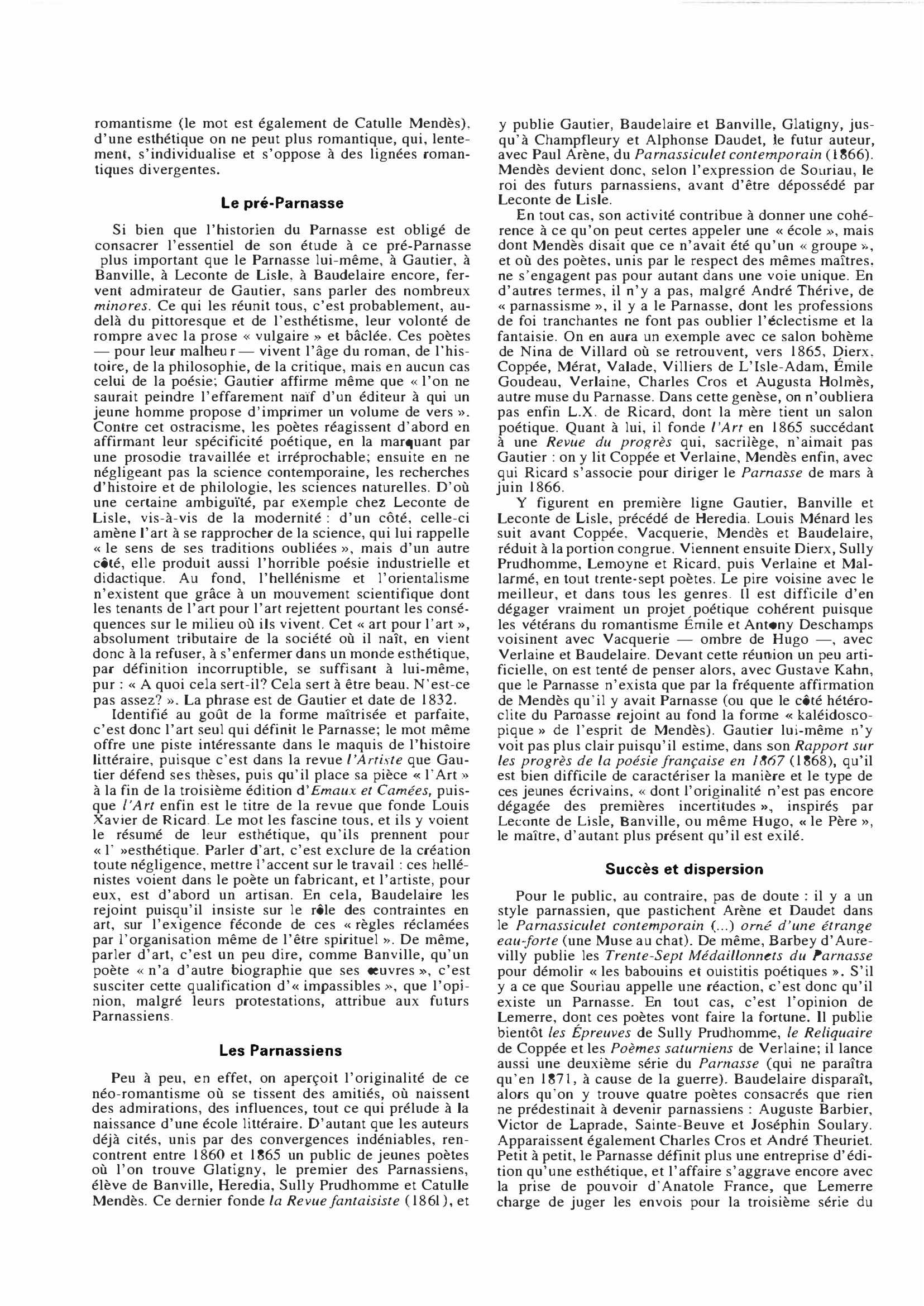LE PARNASSE (Histoire de la littérature)
Publié le 27/11/2018

Extrait du document


«
romantisme
(le mot est également de Catulle Mendès),
d'une esthétique on ne peut plus romantique, qui, lente
ment, s'individualise et s'oppose à des lignées roman
tiques divergentes.
Le pré-Parnasse
Si bien que l'historien du Parnasse est obligé de
consacrer l'essentiel de son étude à ce pré-Parnasse
plus important que le Parnasse lui-même, à Gautier, à
Banville, à Leconte de Lisle, à Baudelaire encore, fer
vent admirateur de Gautier, sans parler des nombreux
minores.
Ce qui les réunit tous, c'est probablement, au
delà du pittoresque et de l'esthétisme, leur volonté de
rompre avec la prose « vulgaire» et bâclée.
Ces poètes
-p our leur malhe ur-vivent l'âge du roman, de l'his
toire, de la philosophie, de la critique, mais en aucun cas
celui de la poésie; Gautier affirme même que «l'on ne
saurait peindre l'effarement naïf d'un éditeur à qui un
jeune homme propose d'imprimer un volume de vers>> .
Contre cet ostracisme, les poètes réagissent d'abord en
affirmant leur spécificité poétique, en la marquant par
une prosodie travaillée et irréprochable; ensuite en ne
négligeant pas la science contemporaine, les recherches
d'histoire et de philologie, les sciences naturelles.
D'où
une certaine ambiguïté, par exemple chez Leconte de
Lisle, vis-à-vis de la moderni té: d'un côté, celle-ci
amène l'art à se rapprocher de la science, qui lui rappelle
«le sens de ses traditions oubliées>>, mais d'un autre
côté, elle produit aussi l'horrible poésie industrielle et
didactique.
Au fond, l'hellénisme et l'orientalisme
n'existent que grâce à un mouvement scientifique dont
les tenants de l'art pour l'art rejettent pourtant les consé
quences sur le milieu où ils vivent.
Cet« art pour l'art>>,
absolument tributaire de la société où il naît, en vient
donc à la refuser, à s'enfermer dans un monde esthétique,
par définition incorruptible, se suffisant à lui-même,
pur : «A quoi cela sert-il? Cela sert à être beau.
N'est-ce
pas assez? >>.
La phrase est de Gautier et date de 1832.
Identifié au goût de la forme maîtrisée et parfaite,
c'est donc l'art seul qui définit le Parnasse; le mot même
offre une piste intéressante dans le maquis de l'histoire
littéraire, puisque c'est dans la revue l'Artiste que Gau
tier défend ses thèses, puis qu'il place sa pièce « l'Art »
à la fin de la troisième édition d'Emaux et Camées, puis
que l'Art enfin est le titre de la revue que fonde Louis
Xavier de Ricard.
Le mot les fascine tous, et ils y voient
le résumé de leur esthétique, qu'ils prennent pour
«l' »esthétique.
Parler d'art, c'est exclure de la création
toute négligence, mettre 1 'accent sur le travail : ces hellé
nistes voient dans le poète un fabricant, et l'artiste, pour
eux, est d'abord un artisan.
En cela, Baudelaire les
rejoint puisqu'il insiste sur le rôle des contraintes en
art, sur l'exigence féconde de ces «règles réclamées
par l'organisation même de l'être spirituel >>.
De même,
parler d'art, c'est un peu dire, comme Banville, qu'un
poète «n'a d'autre biographie que ses œuvres», c'est
susciter cette qualification d'« impassibles>>, que l'opi
nion, malgré leurs protestations, attribue aux futurs
Parnassiens.
Les Parnassiens
Peu à peu, en effet, on aperçoit l'originalité de ce
néo-romantisme où se tissent des amitiés, où naissent
des admirations, des influences, tout ce qui prélude à la
naissance d'une école littéraire.
D'autant que les auteurs
déjà cités, unis par des convergences indéniables, ren
contrent entre 1860 et 1865 un public de jeunes poètes
où l'on trouve Glatigny, Je premier des Parnassiens,
élève de Banville, Heredia, Sully Prudhomme et Catulle
Mendès.
Ce dernier fonde la Revue fantaisiste (1861), et y
publie Gautier, Baudelaire et Banville, Glatigny, jus
qu'à Champfleury et Alphonse Daudet, le futur auteur,
avec Paul Arène, du Parnassiculet contemporain (1866).
Mendès devient donc, selon J'expression de Souriau, le
roi des futurs parnassiens, avant d'être dépossédé par
Leconte de Lisle.
En tout cas, son activité contribue à donner une cohé
rence à ce qu'on peut certes appeler une «école », mais
dont Mendès disait que ce n'avait été qu'un « groupe>>,
et où des poètes, unis par le respect des mêmes maîtres,
ne s'engagent pas pour autant dans une voie unique.
En
d'autres termes, il n'y a pas, malgré André Thérive, de
« parnassisme >>, il y a le Parnasse, dont les professions
de foi tranchantes ne font pas oublier l'éclectisme et la
fantaisie.
On en aura un exemple avec ce salon bohème
de Nina de Villard où se retrouvent, vers 1865, Dierx,
Coppée, Mérat, Valade, Villiers de L'Isle-Adam, Émile
Goudeau, Verlaine, Charles Cros et Augusta Holmès,
autre muse du Parnasse.
Dans cette genèse, on n'oubliera
pas enfin L.X.
de Ricard, dont la mère tient un salon
poétique.
Quant à lui, il fonde l'Art en 1865 succédant
à une Revue du progrès qui, sacrilège, n'aimait pas
Gautier : on y lit Coppée et Verlaine, Mendès enfin, avec
qui Ricard s'associe pour diriger le Parnasse de mars à
juin 1866.
Y figurent en première ligne Gautier, Banville et
Leconte de Lisle, précédé de Heredia.
Louis Ménard les
suit avant Coppée, Vacquerie, Mendès et Baudelaire,
réduit à la portion congrue.
Viennent ensuite Dierx, Sully
Prudhomme, Lemoyne et Ricard, puis Verlaine et Mal
larmé, en tout trente-sept poètes.
Le pire voisine avec le
meilleur, et dans tous les genres.
Il est difficile d'en
dégager vraiment un projet poétique cohérent puisque
les vétérans du romantisme Émile et Antony Deschamps
voisinent avec Vacquerie -ombre de Hugo -, avec
Verlaine et Baudelaire.
Devant cette réunion un peu arti
ficielle, on est tenté de penser alors, avec Gustave Kahn,
que le Parnasse n'exista que par la fréquente affirmation
de Mendès qu'il y avait Parnasse (ou que le côté hétéro
clite du Parnasse rejoint au fond la forme « kaléidosco
pique» de l'esprit de Mendès).
Gautier lui-même n'y
voit pas plus clair puisqu'il estime, dans son Rapport sur
les progrès de la poésie française en 1867 (1868), qu'il
est bien difficile de caractériser la manière et le type de
ces jeunes écrivains, «dont 1 'originalité n'est pas encore
dégagée des premières incertitudes >>, inspirés par
Leconte de Lisle, Banville, ou même Hugo, « le Père>>,
le maître, d'autant plus présent qu'il est exilé.
Succès et dispersion
Pour le public, au contraire, pas de doute : il y a un
style parnassien, que pastichent Arène et Daudet dans
le Parnassiculet contemporain ( ...
) orné d'une étrange
eau-forte (une Muse au chat).
De même, Barbey d'Aure
villy publie les Trente-Sept Médaillonnets du Parnasse
pour démolir «les babouins et ouistitis poétiques >>.
S'il
y a ce que Souriau appelle une réaction, c'est donc qu'il
existe un Parnasse.
En tout cas, c'est l'opinion de
Lemerre, dont ces poètes vont faire la fortune.
Il publie
bientôt les Épreuves de Sully Prudhomme, le Reliquaire
de Coppée et les Poèmes saturniens de Verlaine; il lance
aussi une deuxième série du Parnasse (qui ne paraîtra
qu'en 1871, à cause de la guerre).
Baudelaire disparaît,
alors qu'on y trouve quatre poètes consacrés que rien
ne prédestinait à devenir parnassiens : Auguste Barbier,
Victor de Laprade, Sainte-Beuve et Joséphin Soulary.
Apparaissent également Charles Cros et André Theuriet.
Petit à petit, Je Parnasse définit plus une entreprise d' édi
tion qu'une esthétique, et l'affaire s'aggrave encore avec
la prise de pouvoir d'Anatole France, que Lemerre
charge de juger les envois pour la troisième série du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'HISTOIRE DU PARNASSE - Histoire de la littérature
- « Le romantisme a été la grande révolution littéraire moderne. On a parlé souvent de réactions contre le romantisme. On a donné ce nom à des mouvements comme le Parnasse, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, le néoclassicisme. Mais il ne serait pas difficile de montrer qu'ils sont bien plutôt des décompositions ou des transformations du romantisme.» (Thibaudet, Histoire de la littérature française, Stock, 1936). Commentez ce jugement.
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours