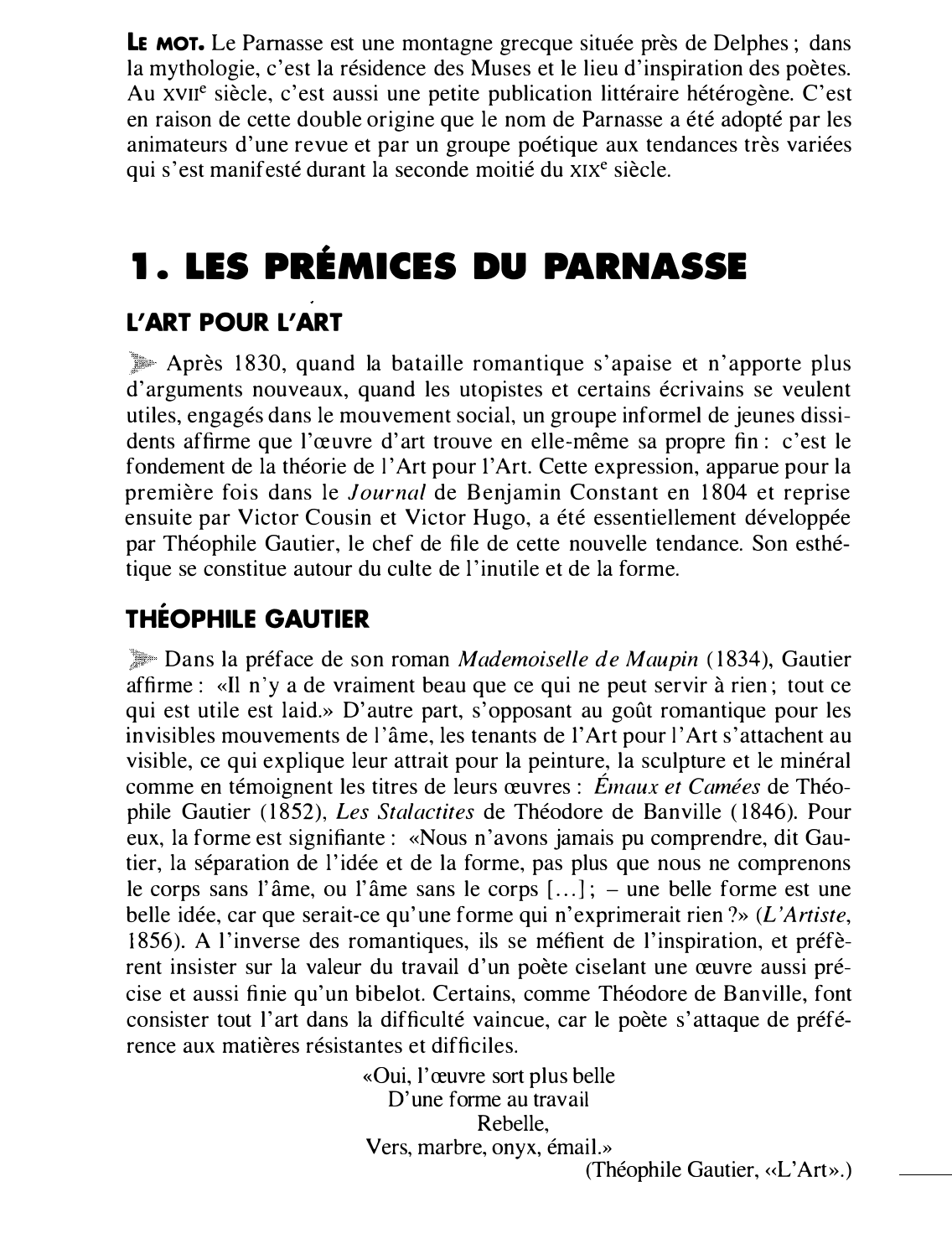L'HISTOIRE DU PARNASSE - Histoire de la littérature
Publié le 30/01/2018

Extrait du document

«Nous n'avons jamais pu comprendre, dit Gautier, la séparation de l'idée et de la forme, pas plus que nous ne comprenons le corps sans l’ âme, ou l’ âme sans le corps [ . . . ] ; - une belle forme est une belle idée, car que serait-ce qu'une forme qui n'exprimerait rien ?» (L'Artiste, 1 856)
Théophile Gautier
Charles-Marie-René Leconte de Lisle José-Maria de Heredia
Émaux et Camées (1852)
Les poèmes barbares (1862)
Les Trophées (1893)
1830-1860
1860-1876 Développement de la théorie de l’ Art pour l’ Art. Limites du Parnasse proprement dit.
< D'une forme au travail Rebelle Vers, marbre, onyx, émail.» (Théophile Gautier, Émaux et Camées.) «Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid.» (Théophile Gautier, préface de Mademoiselle de Maupin.) < Dussé-je m'engloutir pour l'éternité noire, Je ne te vendrai pas mon ivresse ou mon mal, Je ne livrerai pas ma vie à tes huées, Je ne danserai pas sur ton tréteau banal Avec tes histrions et tes prostituées.»

«
LE MOT.
Le Parnasse est une montagne grecque située près de Delphes ; dans
la mythologie, c'est la résidence des Muses et le lieu d'inspiration des poètes.
Au xv n e siècle, c'est aussi une petite publication littéraire hétérogène.
C'est
en raison de cette double origine que le nom de Parnasse a été adopté par les
animateurs d'une revue et par un groupe poétique aux tendances très variées
qui s'est manifesté durant la seconde moitié du xrx e siècle.
1 • LES PR ÉMICES DU PARNASSE
L'ART POUR L'ART
Après 1830, quand la bataille romantique s'apaise et n'apporte plus
d' arguments nouveaux, quand les utopistes et certains écrivains se veulent
utiles, engagés dans le mouvement social, un groupe informel de jeunes dissi
dents affirme que l'œuvre d'art trouve en elle-m ême sa propre f n : c'est le
fondement de la théorie de 1 'A rt pour 1 'Art.
Cette expression, apparue pour la
première fois dans le Journal de Benjamin Constant en 1804 et reprise
ensuite par Victor Cousin et Victor Hugo, a été essentiel lement développée
par Théophile Gautier, le chef de f le de cette nouvelle tendance.
Son esthé
tique se constitue autour du culte de l'inutile et de la forme.
THÉOPHILE GAUTIER
Dans la préface de son roman Madem oiselle de Maupin (1834), Gautier
aff rme : «Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce
qui est utile est laid.» D'autre part, s'opposant au goût romantique pour les
invisibles mouvements de 1' âme, les tenants de 1' Art pour 1' Art s'attachent au
visible, ce qui explique leur attrait pour la peinture, la sculpt ure et le minéral
comme en témoignent les titres de leurs œuvres : Émaux et Camées de Théo
phile Gautier (1852), Les Stalactites de Théodore de Banville (1846).
Pour
eux, la forme est signif ante: «Nous n'avons jamais pu comprendre, dit Gau
tier, la séparation de l'idée et de la forme, pas plus que nous ne comprenons
le corps sans 1' âme, ou 1' âme sans le corps [ ...
] ; - une belle forme est une
belle idée, car que serait-ce qu'une forme qui n'exprimerait rien?» (L'Ar tiste,
18 56).
A l'inverse des romantiques, ils se méf ent de l'inspiration, et préfè
rent insister sur la valeur du travail d'un poète ciselant une œuvre aussi pré
cise et aussi f nie qu'un bibelot.
Certains, comme Théodore de Banville, font
consister tout l'art dans la diff culté vaincue, car le poète s'attaque de préfé
rence aux matières résistantes et diff ciles.
>
(Théoph ile Gautier,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE PARNASSE (Histoire de la littérature)
- « Le romantisme a été la grande révolution littéraire moderne. On a parlé souvent de réactions contre le romantisme. On a donné ce nom à des mouvements comme le Parnasse, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, le néoclassicisme. Mais il ne serait pas difficile de montrer qu'ils sont bien plutôt des décompositions ou des transformations du romantisme.» (Thibaudet, Histoire de la littérature française, Stock, 1936). Commentez ce jugement.
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours