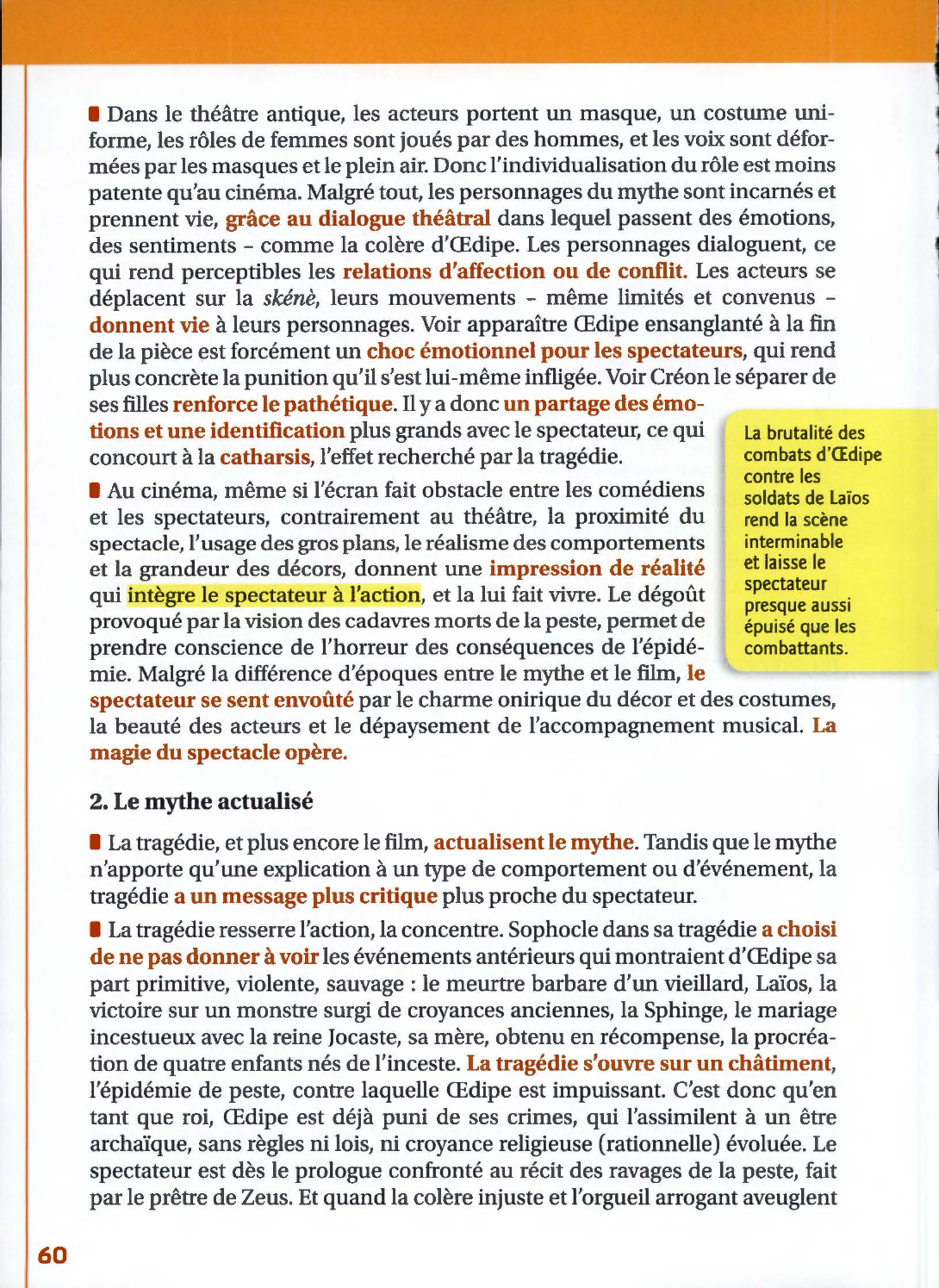Qu'apporte au mythe d’œdipe le fait d'être représenté comme un spectacle, tant dans la pièce de Sophocle que dans le film de Pasolini ?
Publié le 02/01/2020

Extrait du document
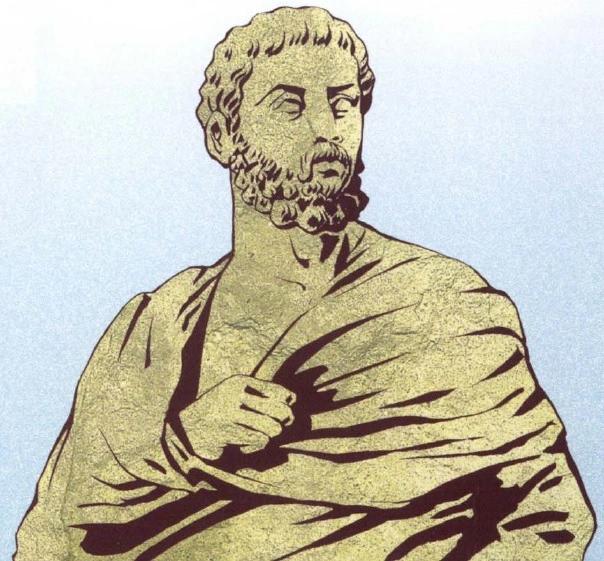
le héros, le spectateur du ve siècle comprend que l'individu archaïque qu’il a devant lui, est condamné par les dieux et rejeté par la société, comme la dernière manifestation d’un chaos rétrograde, rejeté par la civilisation mesurée et respectueuse, incarnée en Créon.
■ L’actualisation du mythe opérée par la tragédie n’a pas de caractère politique, au sens premier du terme, mais plutôt une valeur anthropologique et sociologique, en montrant la nécessaire évolution de l’être humain vers la civilisation : on ne tue plus son père pour prendre sa place, on ne se marie plus à l’intérieur de la famille, on ne croit plus en des divinités monstrueuses, on ne règne plus par la crainte, la violence et l’arbitraire. C’est ce changement auquel adhère le spectateur contemporain de Sophocle, parce que c’est celui qu’il vit avec la démocratie athénienne et le gouvernement de Périclès. En effet le spectacle est montré au pied de l’Acropole d’Athènes, dans le théâtre de Dionysos, lieux symboliques de la culture pour l’homme du Ve siècle.
■ Au contraire de la tragédie, le film peut étirer l’action en étant plus fidèle au mythe, mais aussi en faisant des choix.
■ Il rend plus explicite l’actualisation du mythe, en lui ajoutant un prologue et un épilogue situés au xxe siècle, sans ambiguïté possible. Le sens du mythe est tiré vers la psychanalyse, découverte majeure du XXe siècle, au travers de la relation père-fils et mère-fils, et vers la métaphysique par l’allusion à la mort du personnage : «là où tout a commencé». La liberté du réalisateur lui permet de situer le contexte spatiotemporel du film à l’époque moderne et même contemporaine et, grâce au montage du film, d’enchaîner les époques en enchaînant les plans sans ménager de transition. Il n’y a pas de rupture entre lui-même et Œdipe, si bien qu’à la fin du film on ne sait plus si c’est Œdipe qui disparaît ou si c’est lui, Pasolini.
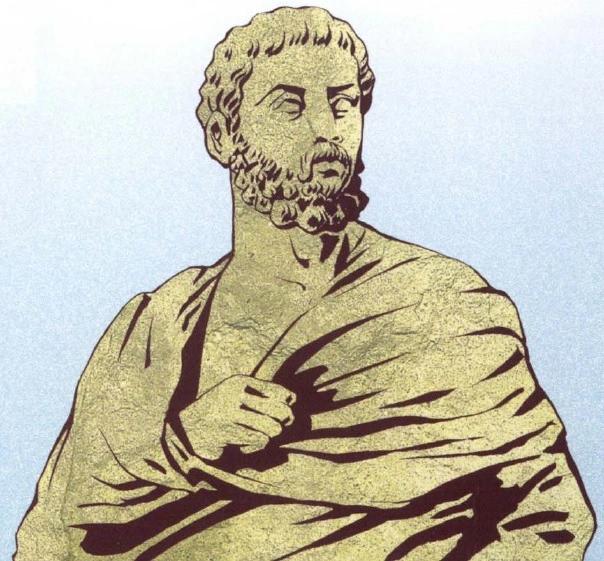
«
60
1 Dans le théâtre antique, les acteurs portent un masque, un costume uni
forme, les rôles de femmes sont joués
par des hommes, et les voix sont défor
mées
par les masques et le plein air.
Donc l'individualisation du rôle est moins
patente qu'au cinéma.
Malgré tout, les personnages
du mythe sont incarnés et
prennent vie, grâce au dialogue théâtral dans lequel passent des émotions,
des sentiments -comme la colère d'Œdipe.
Les personnages dialoguent, ce
qui rend perceptibles les relations d'affection
ou de conflit.
Les acteurs se
déplacent sur la
skénè, leurs mouvements - même limités et convenus -
donnent vie à leurs personnages.
Voir apparaître Œdipe ensanglanté à la fin
de la pièce est forcément un choc émotionnel pour les spectateurs , qui rend
plus concrète la punition qu'il s'est lui-même infligée.
Voir Créon le séparer de
ses filles renforce le
pathétique .
Il y a donc un partage des émo
tions
et une identification plus grands avec le spectateur, ce qui
concourt à la catharsis , l'effet recherché
par la tragédie.
1 Au cinéma, même si l'écran fait obstacle entre les comédiens
et les spectateurs, contrairement au théâtre, la proximité du
spectacle, l'usage des gros plans, le réalisme des comportements
et la grandeur des décors,
donnent une impression de réalité
qui intègre le spectateur à l'action , et la lui fait vivre.
Le dégoût
provoqué
par la vision des cadavres morts de la peste, permet de
prendre conscience de l'horreur des conséquences de l'épidé
mie.
Malgré la différence d'époques entre le mythe et le film, le
La brutalité des
combats d'Œdipe
contre
les
soldats de Laïos rend la scène interminable et laisse le spectateur presque aussi
épuisé que
les combattants.
spectateur se sent envoûté par le charme onirique du décor et des costumes ,
la beauté des acteurs et le dépaysement de l'accompagnement musical.
La
magie
du spectacle opère.
2.
Le mythe actualisé
1 La tragédie, et plus encore le film, actualisent le mythe .
Tandis que le mythe
n'apporte
qu'une explication à un type de comportement ou d'événement, la
tragédie a
un message plus critique plus proche du spectateur.
1 La tragédie resserre l'action, la concentre.
Sophocle dans sa tragédie a choisi
de ne pas donner à voir les événements antérieurs qui montraient d'Œdipe sa
part primitive, violente, sauvage: le meurtre barbare d'un vieillard, Laïos, la
victoire sur
un monstre surgi de croyances anciennes, la Sphinge, le mariage
incestueux avec la reine Jocaste, sa mère, obtenu
en récompense, la procréa
tion de quatre enfants nés de l'inceste.
La tragédie s'ouvre
sur un châtiment ,
l'épidémie de peste, contre laquelle Œdipe est impuissant.
C'est donc qu'en
tant
que roi, Œdipe est déjà puni de ses crimes, qui l'assimilent à un être
archaïque, sans règles ni lois, ni croyance religieuse (rationnelle) évoluée.
Le
spectateur est dès le prologue confronté au récit des ravages de la peste, fait
par le prêtre de Zeus.
Et quand la colère injuste et l'orgueil arrogant aveuglent.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le film de Pasolini, en montrant l’histoire d’œdipe dans sa continuité, modifie l’approche de Sophocle, focalisée sur une progressive révélation.
- œdipe Roi de Pasolini et Sophocle
- SOPHOCLE ET PASOLINI, œDIPE ROI - Résumé des œuvres
- Sophocle et Pasolini apportent-ils une réponse à la question de la culpabilité ou de l'innocence d'œdipe, selon vous ?
- SOPHOCLE ET PASOLINI, œDIPE ROI: De la tragédie au drame