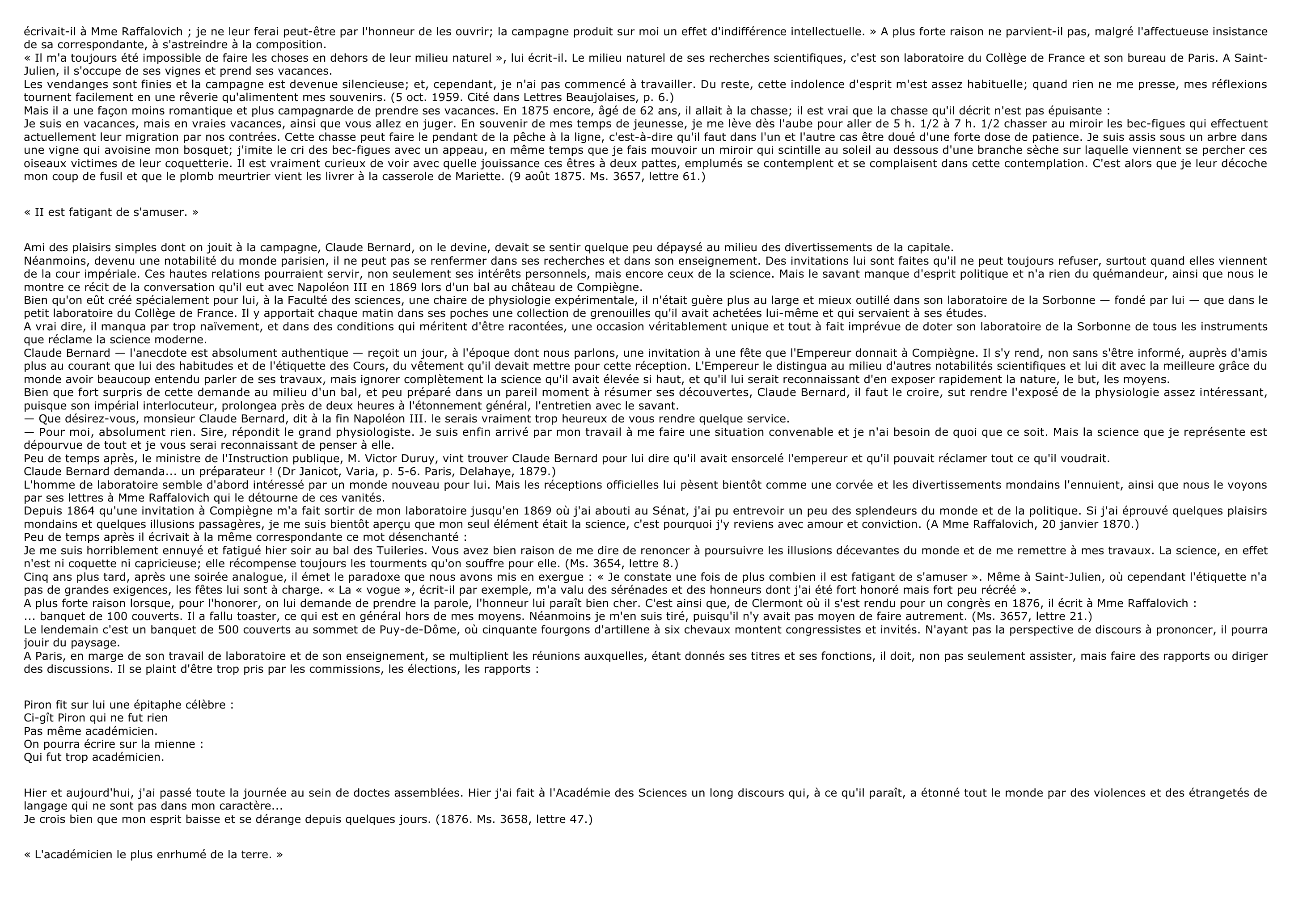CLAUDE BERNARD: L'HOMME, LE PROFESSEUR. L'ECRIVAIN
Publié le 12/07/2011

Extrait du document


«
écrivait-il à Mme Raffalovich ; je ne leur ferai peut-être par l'honneur de les ouvrir; la campagne produit sur moi un effet d'indifférence intellectuelle.
» A plus forte raison ne parvient-il pas, malgré l'affectueuse insistancede sa correspondante, à s'astreindre à la composition.« Il m'a toujours été impossible de faire les choses en dehors de leur milieu naturel », lui écrit-il.
Le milieu naturel de ses recherches scientifiques, c'est son laboratoire du Collège de France et son bureau de Paris.
A Saint-Julien, il s'occupe de ses vignes et prend ses vacances.Les vendanges sont finies et la campagne est devenue silencieuse; et, cependant, je n'ai pas commencé à travailler.
Du reste, cette indolence d'esprit m'est assez habituelle; quand rien ne me presse, mes réflexionstournent facilement en une rêverie qu'alimentent mes souvenirs.
(5 oct.
1959.
Cité dans Lettres Beaujolaises, p.
6.)Mais il a une façon moins romantique et plus campagnarde de prendre ses vacances.
En 1875 encore, âgé de 62 ans, il allait à la chasse; il est vrai que la chasse qu'il décrit n'est pas épuisante :Je suis en vacances, mais en vraies vacances, ainsi que vous allez en juger.
En souvenir de mes temps de jeunesse, je me lève dès l'aube pour aller de 5 h.
1/2 à 7 h.
1/2 chasser au miroir les bec-figues qui effectuentactuellement leur migration par nos contrées.
Cette chasse peut faire le pendant de la pêche à la ligne, c'est-à-dire qu'il faut dans l'un et l'autre cas être doué d'une forte dose de patience.
Je suis assis sous un arbre dansune vigne qui avoisine mon bosquet; j'imite le cri des bec-figues avec un appeau, en même temps que je fais mouvoir un miroir qui scintille au soleil au dessous d'une branche sèche sur laquelle viennent se percher cesoiseaux victimes de leur coquetterie.
Il est vraiment curieux de voir avec quelle jouissance ces êtres à deux pattes, emplumés se contemplent et se complaisent dans cette contemplation.
C'est alors que je leur décochemon coup de fusil et que le plomb meurtrier vient les livrer à la casserole de Mariette.
(9 août 1875.
Ms.
3657, lettre 61.)
« II est fatigant de s'amuser.
»
Ami des plaisirs simples dont on jouit à la campagne, Claude Bernard, on le devine, devait se sentir quelque peu dépaysé au milieu des divertissements de la capitale.Néanmoins, devenu une notabilité du monde parisien, il ne peut pas se renfermer dans ses recherches et dans son enseignement.
Des invitations lui sont faites qu'il ne peut toujours refuser, surtout quand elles viennentde la cour impériale.
Ces hautes relations pourraient servir, non seulement ses intérêts personnels, mais encore ceux de la science.
Mais le savant manque d'esprit politique et n'a rien du quémandeur, ainsi que nous lemontre ce récit de la conversation qu'il eut avec Napoléon III en 1869 lors d'un bal au château de Compiègne.Bien qu'on eût créé spécialement pour lui, à la Faculté des sciences, une chaire de physiologie expérimentale, il n'était guère plus au large et mieux outillé dans son laboratoire de la Sorbonne — fondé par lui — que dans lepetit laboratoire du Collège de France.
Il y apportait chaque matin dans ses poches une collection de grenouilles qu'il avait achetées lui-même et qui servaient à ses études.A vrai dire, il manqua par trop naïvement, et dans des conditions qui méritent d'être racontées, une occasion véritablement unique et tout à fait imprévue de doter son laboratoire de la Sorbonne de tous les instrumentsque réclame la science moderne.Claude Bernard — l'anecdote est absolument authentique — reçoit un jour, à l'époque dont nous parlons, une invitation à une fête que l'Empereur donnait à Compiègne.
Il s'y rend, non sans s'être informé, auprès d'amisplus au courant que lui des habitudes et de l'étiquette des Cours, du vêtement qu'il devait mettre pour cette réception.
L'Empereur le distingua au milieu d'autres notabilités scientifiques et lui dit avec la meilleure grâce dumonde avoir beaucoup entendu parler de ses travaux, mais ignorer complètement la science qu'il avait élevée si haut, et qu'il lui serait reconnaissant d'en exposer rapidement la nature, le but, les moyens.Bien que fort surpris de cette demande au milieu d'un bal, et peu préparé dans un pareil moment à résumer ses découvertes, Claude Bernard, il faut le croire, sut rendre l'exposé de la physiologie assez intéressant,puisque son impérial interlocuteur, prolongea près de deux heures à l'étonnement général, l'entretien avec le savant.— Que désirez-vous, monsieur Claude Bernard, dit à la fin Napoléon III.
le serais vraiment trop heureux de vous rendre quelque service.— Pour moi, absolument rien.
Sire, répondit le grand physiologiste.
Je suis enfin arrivé par mon travail à me faire une situation convenable et je n'ai besoin de quoi que ce soit.
Mais la science que je représente estdépourvue de tout et je vous serai reconnaissant de penser à elle.Peu de temps après, le ministre de l'Instruction publique, M.
Victor Duruy, vint trouver Claude Bernard pour lui dire qu'il avait ensorcelé l'empereur et qu'il pouvait réclamer tout ce qu'il voudrait.Claude Bernard demanda...
un préparateur ! (Dr Janicot, Varia, p.
5-6.
Paris, Delahaye, 1879.)L'homme de laboratoire semble d'abord intéressé par un monde nouveau pour lui.
Mais les réceptions officielles lui pèsent bientôt comme une corvée et les divertissements mondains l'ennuient, ainsi que nous le voyonspar ses lettres à Mme Raffalovich qui le détourne de ces vanités.Depuis 1864 qu'une invitation à Compiègne m'a fait sortir de mon laboratoire jusqu'en 1869 où j'ai abouti au Sénat, j'ai pu entrevoir un peu des splendeurs du monde et de la politique.
Si j'ai éprouvé quelques plaisirsmondains et quelques illusions passagères, je me suis bientôt aperçu que mon seul élément était la science, c'est pourquoi j'y reviens avec amour et conviction.
(A Mme Raffalovich, 20 janvier 1870.)Peu de temps après il écrivait à la même correspondante ce mot désenchanté :Je me suis horriblement ennuyé et fatigué hier soir au bal des Tuileries.
Vous avez bien raison de me dire de renoncer à poursuivre les illusions décevantes du monde et de me remettre à mes travaux.
La science, en effetn'est ni coquette ni capricieuse; elle récompense toujours les tourments qu'on souffre pour elle.
(Ms.
3654, lettre 8.)Cinq ans plus tard, après une soirée analogue, il émet le paradoxe que nous avons mis en exergue : « Je constate une fois de plus combien il est fatigant de s'amuser ».
Même à Saint-Julien, où cependant l'étiquette n'apas de grandes exigences, les fêtes lui sont à charge.
« La « vogue », écrit-il par exemple, m'a valu des sérénades et des honneurs dont j'ai été fort honoré mais fort peu récréé ».A plus forte raison lorsque, pour l'honorer, on lui demande de prendre la parole, l'honneur lui paraît bien cher.
C'est ainsi que, de Clermont où il s'est rendu pour un congrès en 1876, il écrit à Mme Raffalovich :...
banquet de 100 couverts.
Il a fallu toaster, ce qui est en général hors de mes moyens.
Néanmoins je m'en suis tiré, puisqu'il n'y avait pas moyen de faire autrement.
(Ms.
3657, lettre 21.)Le lendemain c'est un banquet de 500 couverts au sommet de Puy-de-Dôme, où cinquante fourgons d'artillene à six chevaux montent congressistes et invités.
N'ayant pas la perspective de discours à prononcer, il pourrajouir du paysage.A Paris, en marge de son travail de laboratoire et de son enseignement, se multiplient les réunions auxquelles, étant donnés ses titres et ses fonctions, il doit, non pas seulement assister, mais faire des rapports ou dirigerdes discussions.
Il se plaint d'être trop pris par les commissions, les élections, les rapports :
Piron fit sur lui une épitaphe célèbre :Ci-gît Piron qui ne fut rienPas même académicien.On pourra écrire sur la mienne :Qui fut trop académicien.
Hier et aujourd'hui, j'ai passé toute la journée au sein de doctes assemblées.
Hier j'ai fait à l'Académie des Sciences un long discours qui, à ce qu'il paraît, a étonné tout le monde par des violences et des étrangetés delangage qui ne sont pas dans mon caractère...Je crois bien que mon esprit baisse et se dérange depuis quelques jours.
(1876.
Ms.
3658, lettre 47.)
« L'académicien le plus enrhumé de la terre.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Claude Bernard : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (fiche de lecture)
- HOMME DE DÉSIR (L'), Louis Claude de Saint-Martin - étude de l'œuvre
- INTRODUCTION A L’ÉTUDE DE LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE, 1865. Claude Bernard - résumé de l'oeuvre
- HOMME, DE SES FACULTÉS INTELLECTUELLES ET DE SON ÉDUCATION (DE L'), 1772. Claude Adrien Helvétius
- INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA MÉDECINE EXPÉRIMENTALE de Claude Bernard (résumé & analyse)