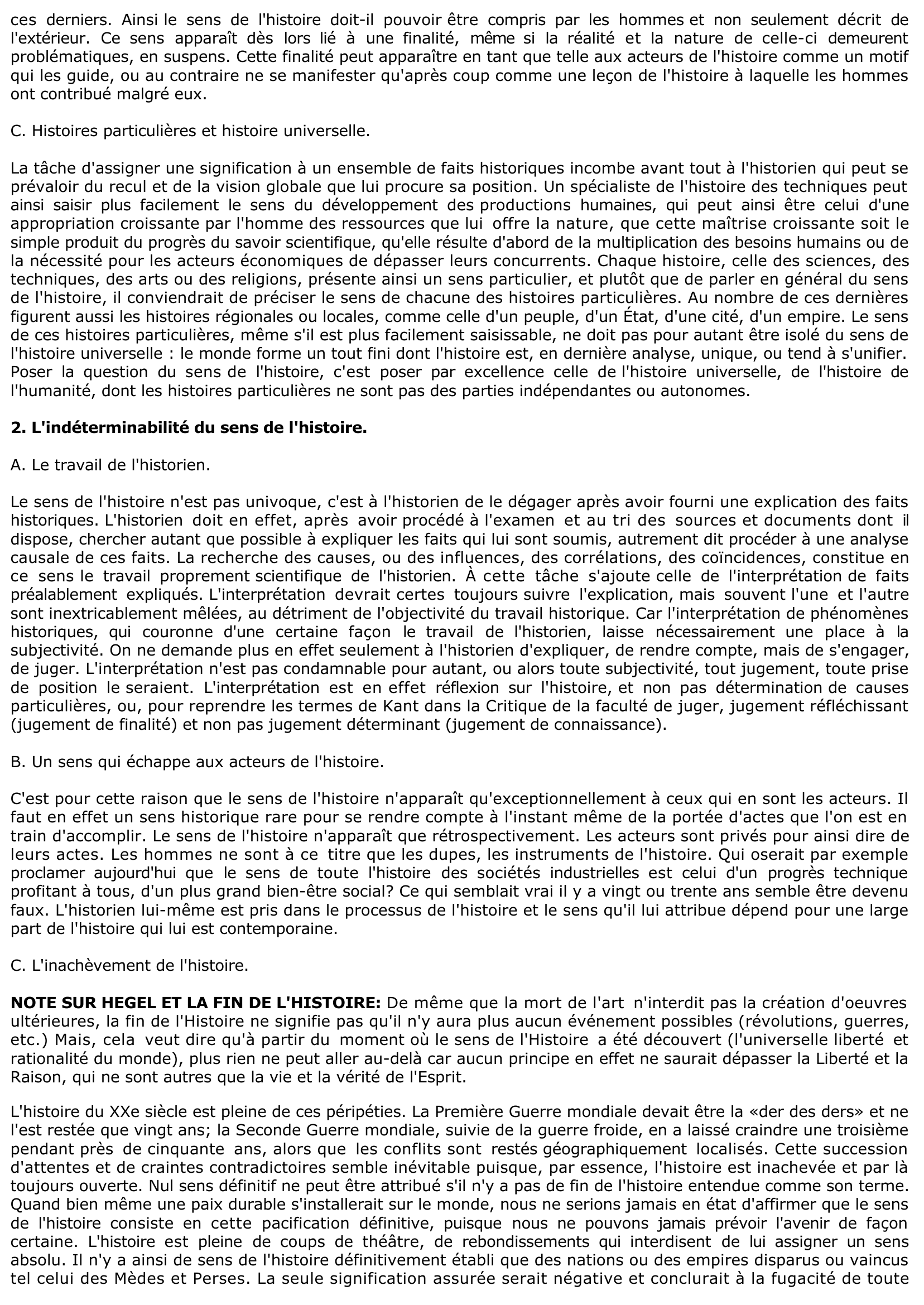Faut-il croire que l'histoire a un sens ?
Publié le 17/01/2022

Extrait du document

• Le besoin de croire en un sens de l'histoire - Dans une première partie, englobez l'histoire collective et l'histoire individuelle. Si l'une a un sens, l'autre en a nécessairement un aussi. L'homme, chacun de nous, est inséparable de l'Homme, l'espèce humaine. • Les dangers d'une croyance à tout prix - Mais à faire dépendre le sens de l'histoire individuelle de l'histoire collective, n'occultons-nous pas la liberté ? Et à trop vouloir trouver du sens, ne risquons-nous pas de tomber dans une logique « terroriste « ? • Croire en l'homme avant tout - Enfin, insistez sur l'histoire de l'individu, pris dans le filet du temps, mais porteur d'un projet moral.
Y-a-t-il une nécessité logique ou vitale à postuler que l'histoire va quelque part, qu'elle n'est pas absurde ? Pourquoi a-t-on besoin de croire a un sens de l'histoire ? Qu'a-t-on à y gagner ?
► Le sens de l'histoire, s'il en est un, semble ne pas pouvoir être tiré des événements historiques, ceux-ci apparaissant obscurs, voire contradictoires. Cependant un sens semble devoir être attribué à l'histoire, sans quoi se profile le risque de perdre l'intelligibilité des faits qui composent l'histoire. Il faut un fil directeur qui permette de se guider dans la multiplicité des faits et des événements, fil directeur qui ne soit pas pour autant arbitraire, gratuit. Il faut donc poser un sens à l'histoire, qui soit en mesure de la sauver. Ce sens qu'il faut supposer semble devoir être l'objet d'une croyance. Cette dernière n'est pas une foi aveugle, mais une croyance rationnelle justifiée par la nature de son objet, qui ne peut être celui d'une science positive. Loin de disqualifier l'histoire, la nécessaire croyance en son sens la justifie et la fonde.

«
ces derniers.
Ainsi le sens de l'histoire doit-il pouvoir être compris par les hommes et non seulement décrit del'extérieur.
Ce sens apparaît dès lors lié à une finalité, même si la réalité et la nature de celle-ci demeurentproblématiques, en suspens.
Cette finalité peut apparaître en tant que telle aux acteurs de l'histoire comme un motifqui les guide, ou au contraire ne se manifester qu'après coup comme une leçon de l'histoire à laquelle les hommesont contribué malgré eux.
C.
Histoires particulières et histoire universelle.
La tâche d'assigner une signification à un ensemble de faits historiques incombe avant tout à l'historien qui peut seprévaloir du recul et de la vision globale que lui procure sa position.
Un spécialiste de l'histoire des techniques peutainsi saisir plus facilement le sens du développement des productions humaines, qui peut ainsi être celui d'uneappropriation croissante par l'homme des ressources que lui offre la nature, que cette maîtrise croissante soit lesimple produit du progrès du savoir scientifique, qu'elle résulte d'abord de la multiplication des besoins humains ou dela nécessité pour les acteurs économiques de dépasser leurs concurrents.
Chaque histoire, celle des sciences, destechniques, des arts ou des religions, présente ainsi un sens particulier, et plutôt que de parler en général du sensde l'histoire, il conviendrait de préciser le sens de chacune des histoires particulières.
Au nombre de ces dernièresfigurent aussi les histoires régionales ou locales, comme celle d'un peuple, d'un État, d'une cité, d'un empire.
Le sensde ces histoires particulières, même s'il est plus facilement saisissable, ne doit pas pour autant être isolé du sens del'histoire universelle : le monde forme un tout fini dont l'histoire est, en dernière analyse, unique, ou tend à s'unifier.Poser la question du sens de l'histoire, c'est poser par excellence celle de l'histoire universelle, de l'histoire del'humanité, dont les histoires particulières ne sont pas des parties indépendantes ou autonomes.
2.
L'indéterminabilité du sens de l'histoire.
A.
Le travail de l'historien.
Le sens de l'histoire n'est pas univoque, c'est à l'historien de le dégager après avoir fourni une explication des faitshistoriques.
L'historien doit en effet, après avoir procédé à l'examen et au tri des sources et documents dont ildispose, chercher autant que possible à expliquer les faits qui lui sont soumis, autrement dit procéder à une analysecausale de ces faits.
La recherche des causes, ou des influences, des corrélations, des coïncidences, constitue ence sens le travail proprement scientifique de l'historien.
À cette tâche s'ajoute celle de l'interprétation de faitspréalablement expliqués.
L'interprétation devrait certes toujours suivre l'explication, mais souvent l'une et l'autresont inextricablement mêlées, au détriment de l'objectivité du travail historique.
Car l'interprétation de phénomèneshistoriques, qui couronne d'une certaine façon le travail de l'historien, laisse nécessairement une place à lasubjectivité.
On ne demande plus en effet seulement à l'historien d'expliquer, de rendre compte, mais de s'engager,de juger.
L'interprétation n'est pas condamnable pour autant, ou alors toute subjectivité, tout jugement, toute prisede position le seraient.
L'interprétation est en effet réflexion sur l'histoire, et non pas détermination de causesparticulières, ou, pour reprendre les termes de Kant dans la Critique de la faculté de juger, jugement réfléchissant(jugement de finalité) et non pas jugement déterminant (jugement de connaissance).
B.
Un sens qui échappe aux acteurs de l'histoire.
C'est pour cette raison que le sens de l'histoire n'apparaît qu'exceptionnellement à ceux qui en sont les acteurs.
Ilfaut en effet un sens historique rare pour se rendre compte à l'instant même de la portée d'actes que l'on est entrain d'accomplir.
Le sens de l'histoire n'apparaît que rétrospectivement.
Les acteurs sont privés pour ainsi dire deleurs actes.
Les hommes ne sont à ce titre que les dupes, les instruments de l'histoire.
Qui oserait par exempleproclamer aujourd'hui que le sens de toute l'histoire des sociétés industrielles est celui d'un progrès techniqueprofitant à tous, d'un plus grand bien-être social? Ce qui semblait vrai il y a vingt ou trente ans semble être devenufaux.
L'historien lui-même est pris dans le processus de l'histoire et le sens qu'il lui attribue dépend pour une largepart de l'histoire qui lui est contemporaine.
C.
L'inachèvement de l'histoire.
NOTE SUR HEGEL ET LA FIN DE L'HISTOIRE: De même que la mort de l'art n'interdit pas la création d'oeuvres ultérieures, la fin de l'Histoire ne signifie pas qu'il n'y aura plus aucun événement possibles (révolutions, guerres,etc.) Mais, cela veut dire qu'à partir du moment où le sens de l'Histoire a été découvert (l'universelle liberté etrationalité du monde), plus rien ne peut aller au-delà car aucun principe en effet ne saurait dépasser la Liberté et laRaison, qui ne sont autres que la vie et la vérité de l'Esprit.
L'histoire du XXe siècle est pleine de ces péripéties.
La Première Guerre mondiale devait être la «der des ders» et nel'est restée que vingt ans; la Seconde Guerre mondiale, suivie de la guerre froide, en a laissé craindre une troisièmependant près de cinquante ans, alors que les conflits sont restés géographiquement localisés.
Cette successiond'attentes et de craintes contradictoires semble inévitable puisque, par essence, l'histoire est inachevée et par làtoujours ouverte.
Nul sens définitif ne peut être attribué s'il n'y a pas de fin de l'histoire entendue comme son terme.Quand bien même une paix durable s'installerait sur le monde, nous ne serions jamais en état d'affirmer que le sensde l'histoire consiste en cette pacification définitive, puisque nous ne pouvons jamais prévoir l'avenir de façoncertaine.
L'histoire est pleine de coups de théâtre, de rebondissements qui interdisent de lui assigner un sensabsolu.
Il n'y a ainsi de sens de l'histoire définitivement établi que des nations ou des empires disparus ou vaincustel celui des Mèdes et Perses.
La seule signification assurée serait négative et conclurait à la fugacité de toute.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il croire que l'histoire a un sens ?
- Faut-il croire que l'histoire a un sens ?
- Faut il croire que l'histoire ait un sens ?
- Faut-il croire que l'histoire a un sens?
- Faut-il croire que l'histoire a un sens ?