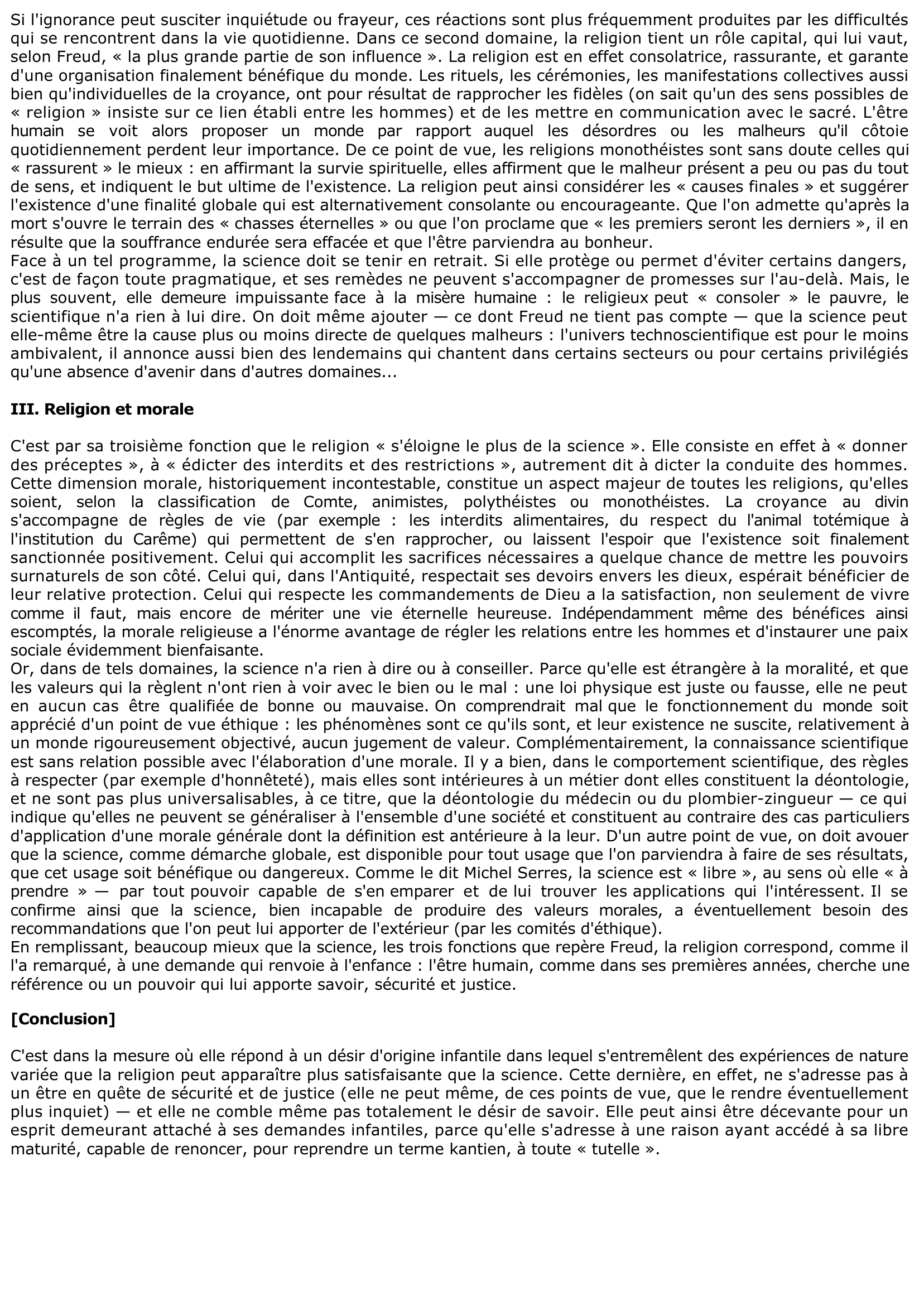FREUD: La religion s'éloigne le plus de la science.
Publié le 09/04/2005

Extrait du document
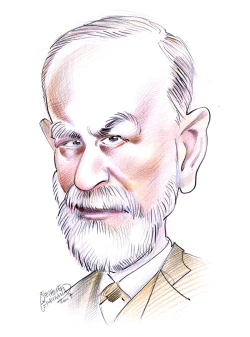
On peut donner de la religion différentes définitions, en soulignant par exemple la façon dont elle rassemble les hommes, son contenu doctrinal ou son organisation institutionnelle. Freud préfère ici mettre en valeur ses différentes fonctions, pour la comparer .à la science. Comparaison qui n'est guère inédite, mais qui est ici effectuée avec une efficacité certaine, puisqu'elle permet de comprendre que la religion comble de plus vastes attentes que la science, et d'en déduire qu'il y a sans doute là une des raisons qui la rendent peu perméable aux arguments scientifiques prétendant la critiquer.
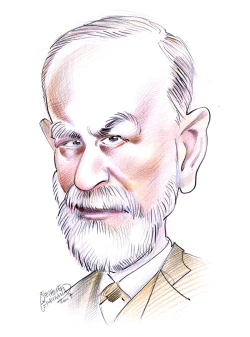
«
Si l'ignorance peut susciter inquiétude ou frayeur, ces réactions sont plus fréquemment produites par les difficultésqui se rencontrent dans la vie quotidienne.
Dans ce second domaine, la religion tient un rôle capital, qui lui vaut,selon Freud, « la plus grande partie de son influence ».
La religion est en effet consolatrice, rassurante, et garanted'une organisation finalement bénéfique du monde.
Les rituels, les cérémonies, les manifestations collectives aussibien qu'individuelles de la croyance, ont pour résultat de rapprocher les fidèles (on sait qu'un des sens possibles de« religion » insiste sur ce lien établi entre les hommes) et de les mettre en communication avec le sacré.
L'êtrehumain se voit alors proposer un monde par rapport auquel les désordres ou les malheurs qu'il côtoiequotidiennement perdent leur importance.
De ce point de vue, les religions monothéistes sont sans doute celles qui« rassurent » le mieux : en affirmant la survie spirituelle, elles affirment que le malheur présent a peu ou pas du toutde sens, et indiquent le but ultime de l'existence.
La religion peut ainsi considérer les « causes finales » et suggérerl'existence d'une finalité globale qui est alternativement consolante ou encourageante.
Que l'on admette qu'après lamort s'ouvre le terrain des « chasses éternelles » ou que l'on proclame que « les premiers seront les derniers », il enrésulte que la souffrance endurée sera effacée et que l'être parviendra au bonheur.Face à un tel programme, la science doit se tenir en retrait.
Si elle protège ou permet d'éviter certains dangers,c'est de façon toute pragmatique, et ses remèdes ne peuvent s'accompagner de promesses sur l'au-delà.
Mais, leplus souvent, elle demeure impuissante face à la misère humaine : le religieux peut « consoler » le pauvre, lescientifique n'a rien à lui dire.
On doit même ajouter — ce dont Freud ne tient pas compte — que la science peutelle-même être la cause plus ou moins directe de quelques malheurs : l'univers technoscientifique est pour le moinsambivalent, il annonce aussi bien des lendemains qui chantent dans certains secteurs ou pour certains privilégiésqu'une absence d'avenir dans d'autres domaines...
III.
Religion et morale
C'est par sa troisième fonction que le religion « s'éloigne le plus de la science ».
Elle consiste en effet à « donnerdes préceptes », à « édicter des interdits et des restrictions », autrement dit à dicter la conduite des hommes.Cette dimension morale, historiquement incontestable, constitue un aspect majeur de toutes les religions, qu'ellessoient, selon la classification de Comte, animistes, polythéistes ou monothéistes.
La croyance au divins'accompagne de règles de vie (par exemple : les interdits alimentaires, du respect du l'animal totémique àl'institution du Carême) qui permettent de s'en rapprocher, ou laissent l'espoir que l'existence soit finalementsanctionnée positivement.
Celui qui accomplit les sacrifices nécessaires a quelque chance de mettre les pouvoirssurnaturels de son côté.
Celui qui, dans l'Antiquité, respectait ses devoirs envers les dieux, espérait bénéficier deleur relative protection.
Celui qui respecte les commandements de Dieu a la satisfaction, non seulement de vivrecomme il faut, mais encore de mériter une vie éternelle heureuse.
Indépendamment même des bénéfices ainsiescomptés, la morale religieuse a l'énorme avantage de régler les relations entre les hommes et d'instaurer une paixsociale évidemment bienfaisante.Or, dans de tels domaines, la science n'a rien à dire ou à conseiller.
Parce qu'elle est étrangère à la moralité, et queles valeurs qui la règlent n'ont rien à voir avec le bien ou le mal : une loi physique est juste ou fausse, elle ne peuten aucun cas être qualifiée de bonne ou mauvaise.
On comprendrait mal que le fonctionnement du monde soitapprécié d'un point de vue éthique : les phénomènes sont ce qu'ils sont, et leur existence ne suscite, relativement àun monde rigoureusement objectivé, aucun jugement de valeur.
Complémentairement, la connaissance scientifiqueest sans relation possible avec l'élaboration d'une morale.
Il y a bien, dans le comportement scientifique, des règlesà respecter (par exemple d'honnêteté), mais elles sont intérieures à un métier dont elles constituent la déontologie,et ne sont pas plus universalisables, à ce titre, que la déontologie du médecin ou du plombier-zingueur — ce quiindique qu'elles ne peuvent se généraliser à l'ensemble d'une société et constituent au contraire des cas particuliersd'application d'une morale générale dont la définition est antérieure à la leur.
D'un autre point de vue, on doit avouerque la science, comme démarche globale, est disponible pour tout usage que l'on parviendra à faire de ses résultats,que cet usage soit bénéfique ou dangereux.
Comme le dit Michel Serres, la science est « libre », au sens où elle « àprendre » — par tout pouvoir capable de s'en emparer et de lui trouver les applications qui l'intéressent.
Il seconfirme ainsi que la science, bien incapable de produire des valeurs morales, a éventuellement besoin desrecommandations que l'on peut lui apporter de l'extérieur (par les comités d'éthique).En remplissant, beaucoup mieux que la science, les trois fonctions que repère Freud, la religion correspond, comme ill'a remarqué, à une demande qui renvoie à l'enfance : l'être humain, comme dans ses premières années, cherche uneréférence ou un pouvoir qui lui apporte savoir, sécurité et justice.
[Conclusion]
C'est dans la mesure où elle répond à un désir d'origine infantile dans lequel s'entremêlent des expériences de naturevariée que la religion peut apparaître plus satisfaisante que la science.
Cette dernière, en effet, ne s'adresse pas àun être en quête de sécurité et de justice (elle ne peut même, de ces points de vue, que le rendre éventuellementplus inquiet) — et elle ne comble même pas totalement le désir de savoir.
Elle peut ainsi être décevante pour unesprit demeurant attaché à ses demandes infantiles, parce qu'elle s'adresse à une raison ayant accédé à sa librematurité, capable de renoncer, pour reprendre un terme kantien, à toute « tutelle »..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Freud: la religion et la science
- FREUD: La religion est-elle comparable à la science ?
- « La philosophie n'est pas contraire à la science, elle se comporte elle-même comme une science, travaille en partie avec les mêmes méthodes, mais elle s'en éloigne dans la mesure où elle s'accroche à l'illusion de pouvoir livrer une image du monde cohérente et sans lacune. » Freud, Nouvelles Conférences sur la psychanalyse, 1933. Commentez cette citation.
- dissertation philo science et religion: Pourquoi le développement scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ?
- Russel science et religion