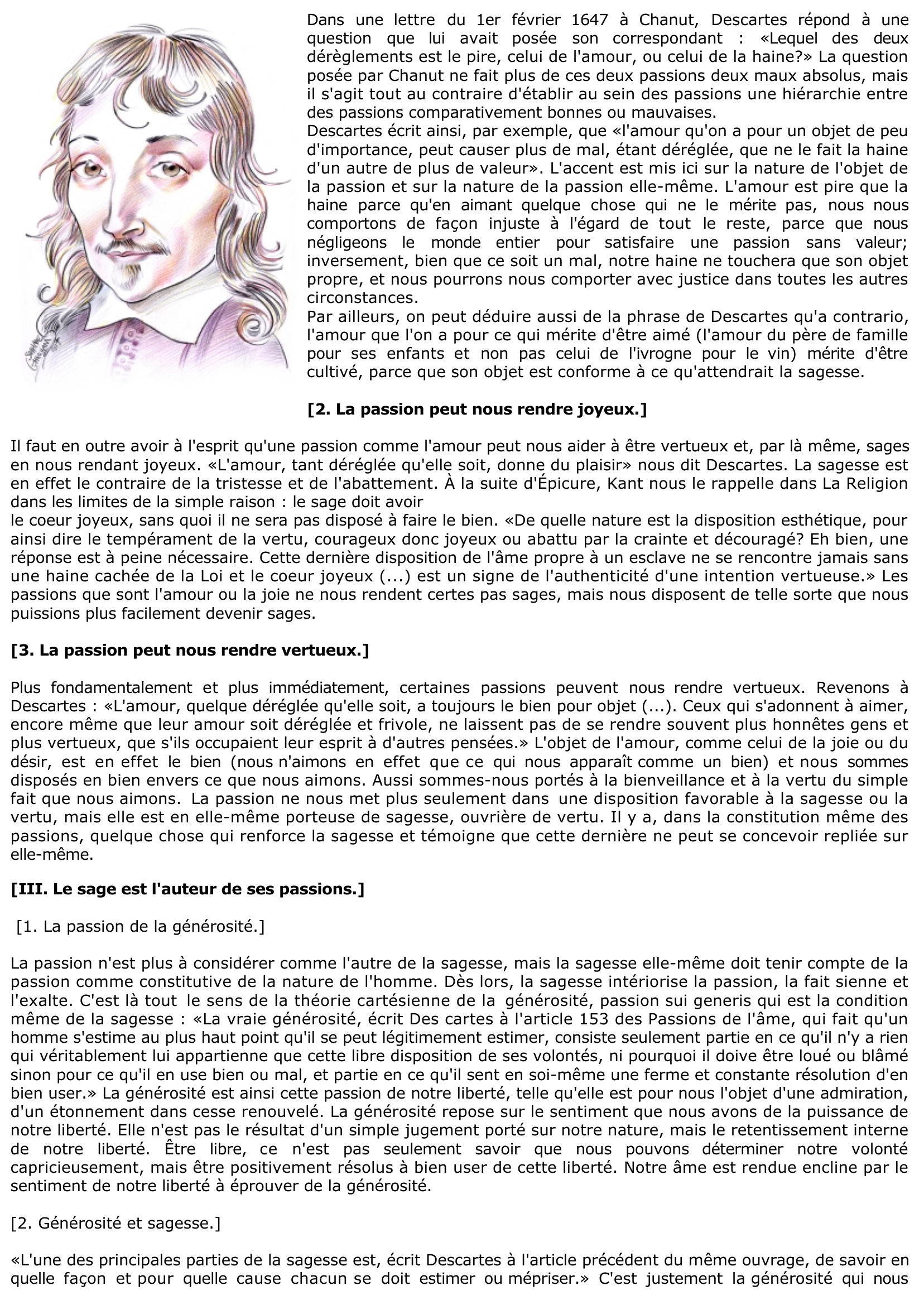La passion est-elle un obstacle à la sagesse ?
Publié le 03/03/2005

Extrait du document
- [I. Le sage ne peut être asservi à la passion.]
- [II. La sagesse comme bon usage des passions.]
- [III. Le sage est l'auteur de ses passions.]
«
Dans une lettre du 1er février 1647 à Chanut, Descartes répond à unequestion que lui avait posée son correspondant : «Lequel des deuxdérèglements est le pire, celui de l'amour, ou celui de la haine?» La questionposée par Chanut ne fait plus de ces deux passions deux maux absolus, maisil s'agit tout au contraire d'établir au sein des passions une hiérarchie entredes passions comparativement bonnes ou mauvaises.Descartes écrit ainsi, par exemple, que «l'amour qu'on a pour un objet de peud'importance, peut causer plus de mal, étant déréglée, que ne le fait la hained'un autre de plus de valeur».
L'accent est mis ici sur la nature de l'objet dela passion et sur la nature de la passion elle-même.
L'amour est pire que lahaine parce qu'en aimant quelque chose qui ne le mérite pas, nous nouscomportons de façon injuste à l'égard de tout le reste, parce que nousnégligeons le monde entier pour satisfaire une passion sans valeur;inversement, bien que ce soit un mal, notre haine ne touchera que son objetpropre, et nous pourrons nous comporter avec justice dans toutes les autrescirconstances.Par ailleurs, on peut déduire aussi de la phrase de Descartes qu'a contrario,l'amour que l'on a pour ce qui mérite d'être aimé (l'amour du père de famillepour ses enfants et non pas celui de l'ivrogne pour le vin) mérite d'êtrecultivé, parce que son objet est conforme à ce qu'attendrait la sagesse.
[2.
La passion peut nous rendre joyeux.]
Il faut en outre avoir à l'esprit qu'une passion comme l'amour peut nous aider à être vertueux et, par là même, sagesen nous rendant joyeux.
«L'amour, tant déréglée qu'elle soit, donne du plaisir» nous dit Descartes.
La sagesse esten effet le contraire de la tristesse et de l'abattement.
À la suite d'Épicure, Kant nous le rappelle dans La Religiondans les limites de la simple raison : le sage doit avoirle coeur joyeux, sans quoi il ne sera pas disposé à faire le bien.
«De quelle nature est la disposition esthétique, pourainsi dire le tempérament de la vertu, courageux donc joyeux ou abattu par la crainte et découragé? Eh bien, uneréponse est à peine nécessaire.
Cette dernière disposition de l'âme propre à un esclave ne se rencontre jamais sansune haine cachée de la Loi et le coeur joyeux (...) est un signe de l'authenticité d'une intention vertueuse.» Lespassions que sont l'amour ou la joie ne nous rendent certes pas sages, mais nous disposent de telle sorte que nouspuissions plus facilement devenir sages.
[3.
La passion peut nous rendre vertueux.]
Plus fondamentalement et plus immédiatement, certaines passions peuvent nous rendre vertueux.
Revenons àDescartes : «L'amour, quelque déréglée qu'elle soit, a toujours le bien pour objet (...).
Ceux qui s'adonnent à aimer,encore même que leur amour soit déréglée et frivole, ne laissent pas de se rendre souvent plus honnêtes gens etplus vertueux, que s'ils occupaient leur esprit à d'autres pensées.» L'objet de l'amour, comme celui de la joie ou dudésir, est en effet le bien (nous n'aimons en effet que ce qui nous apparaît comme un bien) et nous sommesdisposés en bien envers ce que nous aimons.
Aussi sommes-nous portés à la bienveillance et à la vertu du simplefait que nous aimons.
La passion ne nous met plus seulement dans une disposition favorable à la sagesse ou lavertu, mais elle est en elle-même porteuse de sagesse, ouvrière de vertu.
Il y a, dans la constitution même despassions, quelque chose qui renforce la sagesse et témoigne que cette dernière ne peut se concevoir repliée surelle-même.
[III.
Le sage est l'auteur de ses passions.]
[1.
La passion de la générosité.]
La passion n'est plus à considérer comme l'autre de la sagesse, mais la sagesse elle-même doit tenir compte de lapassion comme constitutive de la nature de l'homme.
Dès lors, la sagesse intériorise la passion, la fait sienne etl'exalte.
C'est là tout le sens de la théorie cartésienne de la générosité, passion sui generis qui est la conditionmême de la sagesse : «La vraie générosité, écrit Des cartes à l'article 153 des Passions de l'âme, qui fait qu'unhomme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce qu'il n'y a rienqui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi il doive être loué ou blâmésinon pour ce qu'il en use bien ou mal, et partie en ce qu'il sent en soi-même une ferme et constante résolution d'enbien user.» La générosité est ainsi cette passion de notre liberté, telle qu'elle est pour nous l'objet d'une admiration,d'un étonnement dans cesse renouvelé.
La générosité repose sur le sentiment que nous avons de la puissance denotre liberté.
Elle n'est pas le résultat d'un simple jugement porté sur notre nature, mais le retentissement internede notre liberté.
Être libre, ce n'est pas seulement savoir que nous pouvons déterminer notre volontécapricieusement, mais être positivement résolus à bien user de cette liberté.
Notre âme est rendue encline par lesentiment de notre liberté à éprouver de la générosité.
[2.
Générosité et sagesse.]
«L'une des principales parties de la sagesse est, écrit Descartes à l'article précédent du même ouvrage, de savoir enquelle façon et pour quelle cause chacun se doit estimer ou mépriser.» C'est justement la générosité qui nous.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La passion fait-elle obstacle à la connaissance de soi?
- La passion est-elle un obstacle à ma volonté?
- Les croyances religieuses : passion ou sagesse ?
- La sagesse est-elle compatible avec la passion ?
- La passion fait-elle toujours obstacle à la connaissance de soi ?