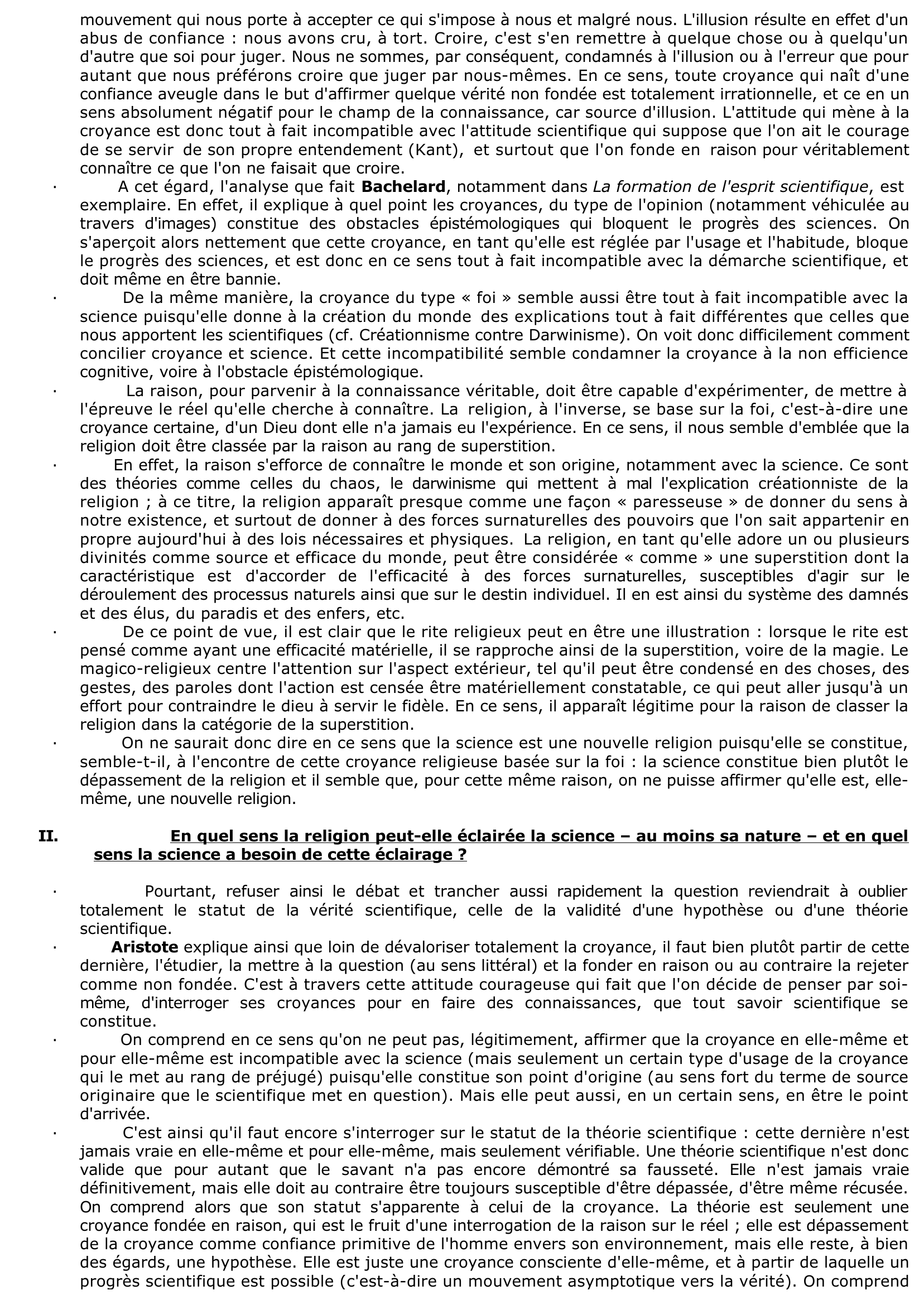La science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle. A. Einstein. Qu'en pensez-vous ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document

.../...
- Mettre en parallèle la science et la religion semble a priori illégitime puisqu’elles semblent opposées : en effet, si l’on reprend les différents âges établis par Auguste Comte, on s’aperçoit que l’âge scientifique se conçoit dans le dépassement de l’âge religieux.
- Pourtant, il est vrai que, dans nos sociétés contemporaines, on ne jure plus que par la science. D’où le poids des slogans estampillés « prouvé scientifiquement «. On comprend alors que la science et la validité qu’elle est sensée apporté est devenu dominant, comme ce pouvait être le cas, autrefois, des pratiques religieuses.
- Dire que la science sans la religion est boiteuse et que la religion sans la science est aveugle c’est affirmer que science et religion sont des domaines qui interagissent entre eux, ou du moins qui ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Or, a priori au moins, cette idée semble faire difficulté. Or, c’est précisément la nature de la science, notre conception de cette discipline, qui doit faire l’objet d’une analyse rigoureuse si l’on veut comprendre la formule d’Einstein.
Problématique
Science et religion entretiennent-elles un rapport et si oui, de quelle nature est ce lien ? La science élimine-t-elle toute possibilité de croire en un être divin ou au contraire, en donne-t-elle un témoignage ? Par ailleurs, la religion, en tant qu’estampillée du saut de la croyance, ne permet-elle pas à la science de tomber dans le dogmatisme ? En somme, il convient de se demander qu’elle bénéfice peut retirer la science de la religion et, réciproquement, la religion de la science ?
I. La science et la religion sont opposées, et aucune d’elle ne peut – et ne doit interférer dans le domaine de l’autre.
II. En quel sens la religion peut-elle éclairée la science – au moins sa nature – et en quel sens la science a besoin de cette éclairage ?
III. Le rapport science et religion nous invite à penser la nature de la vérité scientifique : une croyance reconnue de tous ?

«
mouvement qui nous porte à accepter ce qui s'impose à nous et malgré nous.
L'illusion résulte en effet d'unabus de confiance : nous avons cru, à tort.
Croire, c'est s'en remettre à quelque chose ou à quelqu'und'autre que soi pour juger.
Nous ne sommes, par conséquent, condamnés à l'illusion ou à l'erreur que pourautant que nous préférons croire que juger par nous-mêmes.
En ce sens, toute croyance qui naît d'uneconfiance aveugle dans le but d'affirmer quelque vérité non fondée est totalement irrationnelle, et ce en unsens absolument négatif pour le champ de la connaissance, car source d'illusion.
L'attitude qui mène à lacroyance est donc tout à fait incompatible avec l'attitude scientifique qui suppose que l'on ait le couragede se servir de son propre entendement (Kant), et surtout que l'on fonde en raison pour véritablementconnaître ce que l'on ne faisait que croire. · A cet égard, l'analyse que fait Bachelard , notamment dans La formation de l'esprit scientifique , est exemplaire.
En effet, il explique à quel point les croyances, du type de l'opinion (notamment véhiculée autravers d'images) constitue des obstacles épistémologiques qui bloquent le progrès des sciences.
Ons'aperçoit alors nettement que cette croyance, en tant qu'elle est réglée par l'usage et l'habitude, bloquele progrès des sciences, et est donc en ce sens tout à fait incompatible avec la démarche scientifique, etdoit même en être bannie. · De la même manière, la croyance du type « foi » semble aussi être tout à fait incompatible avec la science puisqu'elle donne à la création du monde des explications tout à fait différentes que celles quenous apportent les scientifiques (cf.
Créationnisme contre Darwinisme).
On voit donc difficilement commentconcilier croyance et science.
Et cette incompatibilité semble condamner la croyance à la non efficiencecognitive, voire à l'obstacle épistémologique. · La raison, pour parvenir à la connaissance véritable, doit être capable d'expérimenter, de mettre à l'épreuve le réel qu'elle cherche à connaître.
La religion, à l'inverse, se base sur la foi, c'est-à-dire unecroyance certaine, d'un Dieu dont elle n'a jamais eu l'expérience.
En ce sens, il nous semble d'emblée que lareligion doit être classée par la raison au rang de superstition. · En effet, la raison s'efforce de connaître le monde et son origine, notamment avec la science.
Ce sont des théories comme celles du chaos, le darwinisme qui mettent à mal l'explication créationniste de lareligion ; à ce titre, la religion apparaît presque comme une façon « paresseuse » de donner du sens ànotre existence, et surtout de donner à des forces surnaturelles des pouvoirs que l'on sait appartenir enpropre aujourd'hui à des lois nécessaires et physiques.
La religion, en tant qu'elle adore un ou plusieursdivinités comme source et efficace du monde, peut être considérée « comme » une superstition dont lacaractéristique est d'accorder de l'efficacité à des forces surnaturelles, susceptibles d'agir sur ledéroulement des processus naturels ainsi que sur le destin individuel.
Il en est ainsi du système des damnéset des élus, du paradis et des enfers, etc. · De ce point de vue, il est clair que le rite religieux peut en être une illustration : lorsque le rite est pensé comme ayant une efficacité matérielle, il se rapproche ainsi de la superstition, voire de la magie.
Lemagico-religieux centre l'attention sur l'aspect extérieur, tel qu'il peut être condensé en des choses, desgestes, des paroles dont l'action est censée être matériellement constatable, ce qui peut aller jusqu'à uneffort pour contraindre le dieu à servir le fidèle.
En ce sens, il apparaît légitime pour la raison de classer lareligion dans la catégorie de la superstition. · On ne saurait donc dire en ce sens que la science est une nouvelle religion puisqu'elle se constitue, semble-t-il, à l'encontre de cette croyance religieuse basée sur la foi : la science constitue bien plutôt ledépassement de la religion et il semble que, pour cette même raison, on ne puisse affirmer qu'elle est, elle-même, une nouvelle religion. II.
En quel sens la religion peut-elle éclairée la science – au moins sa nature – et en quel sens la science a besoin de cette éclairage ? · Pourtant, refuser ainsi le débat et trancher aussi rapidement la question reviendrait à oublier totalement le statut de la vérité scientifique, celle de la validité d'une hypothèse ou d'une théoriescientifique. · Aristote explique ainsi que loin de dévaloriser totalement la croyance, il faut bien plutôt partir de cette dernière, l'étudier, la mettre à la question (au sens littéral) et la fonder en raison ou au contraire la rejetercomme non fondée.
C'est à travers cette attitude courageuse qui fait que l'on décide de penser par soi-même, d'interroger ses croyances pour en faire des connaissances, que tout savoir scientifique seconstitue. · On comprend en ce sens qu'on ne peut pas, légitimement, affirmer que la croyance en elle-même et pour elle-même est incompatible avec la science (mais seulement un certain type d'usage de la croyancequi le met au rang de préjugé) puisqu'elle constitue son point d'origine (au sens fort du terme de sourceoriginaire que le scientifique met en question).
Mais elle peut aussi, en un certain sens, en être le pointd'arrivée. · C'est ainsi qu'il faut encore s'interroger sur le statut de la théorie scientifique : cette dernière n'est jamais vraie en elle-même et pour elle-même, mais seulement vérifiable.
Une théorie scientifique n'est doncvalide que pour autant que le savant n'a pas encore démontré sa fausseté.
Elle n'est jamais vraiedéfinitivement, mais elle doit au contraire être toujours susceptible d'être dépassée, d'être même récusée.On comprend alors que son statut s'apparente à celui de la croyance.
La théorie est seulement unecroyance fondée en raison, qui est le fruit d'une interrogation de la raison sur le réel ; elle est dépassementde la croyance comme confiance primitive de l'homme envers son environnement, mais elle reste, à biendes égards, une hypothèse.
Elle est juste une croyance consciente d'elle-même, et à partir de laquelle unprogrès scientifique est possible (c'est-à-dire un mouvement asymptotique vers la vérité).
On comprend.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissertation philo science et religion: Pourquoi le développement scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ?
- Russel science et religion
- Bertrand Russell, Science et religion (résumé et analyse)
- « On trouve des sociétés qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n'y a jamais eu de société qui n'a jamais eu de religion »
- Sujet : Dans la science et l’hypothèse p.250 Jules Henri Poincaré affirme : « les expériences sont délicates, et une conclusion définitive serait aujourd’hui prématurée ». Qu’en pensez-vous ?