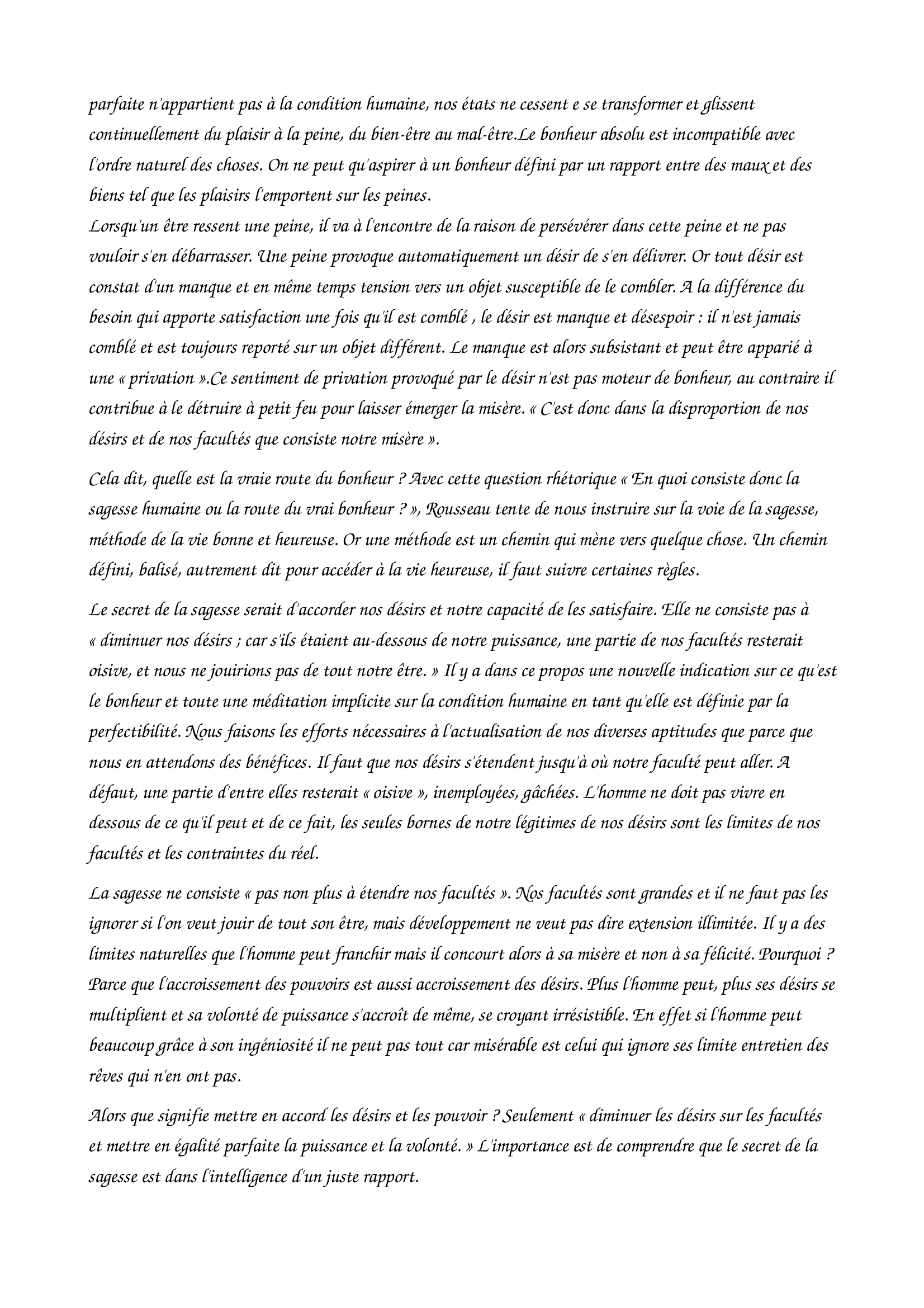Le bonheur
Publié le 20/12/2012

Extrait du document
«
parfaite n'appartient pas à la condition humaine, nos états ne cessent e se transformer et glissent
continuellement du plaisir
à la peine, du bien être au mal être.Le bonheur absolu est incompatible avec
l'ordre naturel des choses. On ne peut qu'aspirer
à un bonheur d éfini par un rapport entre des maux et des
biens tel que les plaisirs l'emportent sur les peines.
Lorsqu'un
être ressent une peine, il va à l'encontre de la raison de pers évérer dans cette peine et ne pas
vouloir s'en d
ébarrasser. Une peine provoque automatiquement un d ésir de s'en d élivrer. Or tout d ésir est
constat d'un manque et en m
ême temps tension vers un objet susceptible de le combler. A la diff érence du
besoin qui apporte satisfaction une fois qu'il est combl
é , le d ésir est manque et d ésespoir : il n'est jamais
combl
é et est toujours report é sur un objet diff érent. Le manque est alors subsistant et peut être appari é à
une « privation ».Ce sentiment de privation provoqu
é par le d ésir n'est pas moteur de bonheur, au contraire il
contribue
à le d étruire à petit feu pour laisser émerger la mis ère. « C'est donc dans la disproportion de nos
d
ésirs et de nos facult és que consiste notre mis ère ».
Cela dit, quelle est la vraie route du bonheur ? Avec cette question rh
étorique « En quoi consiste donc la
sagesse humaine ou la route du vrai bonheur ? », Rousseau tente de nous instruire sur la voie de la sagesse,
m
éthode de la vie bonne et heureuse. Or une m éthode est un chemin qui m ène vers quelque chose. Un chemin
d
éfini, balis é, autrement dit pour acc éder à la vie heureuse, il faut suivre certaines r ègles.
Le secret de la sagesse serait d'accorder nos d
ésirs et notre capacit é de les satisfaire. Elle ne consiste pas à
« diminuer nos d
ésirs ; car s'ils étaient audessous de notre puissance, une partie de nos facult és resterait
oisive, et nous ne jouirions pas de tout notre
être.
» Il y a dans ce propos une nouvelle indication sur ce qu'est
le bonheur et toute une m
éditation implicite sur la condition humaine en tant qu'elle est d éfinie par la
perfectibilit
é. Nous faisons les efforts n écessaires à l'actualisation de nos diverses aptitudes que parce que
nous en attendons des b
énéfices. Il faut que nos d ésirs s' étendent jusqu' à où notre facult é peut aller. A
d
éfaut, une partie d'entre elles resterait « oisive », inemploy ées, g âchées. L'homme ne doit pas vivre en
dessous de ce qu'il peut et de ce fait, les seules bornes de notre l
égitimes de nos d ésirs sont les limites de nos
facult
és et les contraintes du r éel.
La sagesse ne consiste « pas non plus
à étendre nos facult és ». Nos facult és sont grandes et il ne faut pas les
ignorer si l'on veut jouir de tout son
être, mais d éveloppement ne veut pas dire extension illimit ée. Il y a des
limites naturelles que l'homme peut franchir mais il concourt alors
à sa mis ère et non à sa f élicit é. Pourquoi ?
Parce que l'accroissement des pouvoirs est aussi accroissement des d
ésirs. Plus l'homme peut, plus ses d ésirs se
multiplient et sa volont
é de puissance s'accro ît de m ême, se croyant irr ésistible. En effet si l'homme peut
beaucoup gr
âce à son ing éniosit é il ne peut pas tout car mis érable est celui qui ignore ses limite entretien des
r
êves qui n'en ont pas.
Alors que signifie mettre en accord les d
ésirs et les pouvoir ? Seulement « diminuer les d ésirs sur les facult és
et mettre en
égalit é parfaite la puissance et la volont é.
» L'importance est de comprendre que le secret de la
sagesse est dans l'intelligence d'un juste rapport. .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- AU BONHEUR DES DAMES
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames
- sujet de réflexion au bonheur des dames
- DISSERTATION : AU BONHEUR DES DAMES: Comment Zola applique-t-il le naturalisme dans une œuvre romanesque ?
- Le bonheur(notes de cours)